index.md 379KB
title: Thèse « De la revue au collectif » : La revue format
url: https://these.nicolassauret.net/1.0/revueformat.html#du-fragment-au-cristal
hash_url: b323b51287
Introduction
Qu’est-ce qu’une revue scientifique ? D’où vient ce format et comment a-t-il émergé ? Comment se positionne aujourd’hui la revue dans un écosystème du savoir bouleversé par la mutation des supports de connaissance ? Son histoire et sa mission originale peuvent-elles nous guider pour mieux opérer cette transformation numérique ? Peut-on, enfin, considérer que cette dernière procède d’une « remédiation » ainsi que l’on qualifie, dans la théorie des media, le processus de transformation, de mutation et d’adaptation d’un media face à l’émergence d’un nouvel environnement technique ?
La revue media
Un premier élément de réponse à ces questions consiste en effet à considérer que la revue est un media, défini d’abord comme un artefact éditorial de transmission du savoir parmi d’autres artefacts tels que la monographie, la thèse, la conférence, ou encore la notice encyclopédique. Mon champ d’étude, la revue scientifique en lettres et sciences humaines, est donc celui d’un media tel qu’il est travaillé par l’avènement de l’environnement et de la culture numériques. Or, à travers la revue comme media et artefact communicationnel, ma réflexion s’élargit de manière à penser la façon ou les façons dont le numérique remodèle la communication scientifique, et plus largement l’épistémologie sous-jacente.
En préambule d’un article de synthèse redessinant les passerelles théoriques entre les différentes études médiatiques« Cet article propose une perspective sur la théorie des media à la croisée des approches de l’écologie médiatique – inspirée des travaux fondateurs d’Harold Innis, Marshall McLuhan et Neil Postman, mais aussi de la médiologie française de Régis Debray et Daniel Bougnoux – et de l’archéologie médiatique – inspirée de Friedrich Kittler, Jussi Parrika et Erkki Huhtamo. » (2016, sur Hypothesis)
(Bardini 2016), Thierry Bardini insiste pour distinguer le medium et son pluriel media, des « médias » ou encore du « médium ». Le medium/media désigne pour l’auteur « les milieux, intermédiaires ou moyens de la communication, les opérateurs de médiation » (2016, sur Hypothesis), tandis que les « médias » se rapportent « aux “moyens de diffusion, de distribution ou de transmission de signaux porteurs de messages écrits, sonores ou visuels” destinés à un public de masse » (2016, sur Hypothesis). Le « médium » quant à lui communique avec les esprits. Je reprends cette terminologie à mon compte, en apportant peut-être une nuance supplémentaire entre medium et media. Dans un contexte médiatique, j’associe le medium au support d’inscription, qu’il soit papier, pellicule argentique, bande magnétique. Le media constitue alors l’opérateur de médiation, c’est-à-dire encore l’instance qui assure la·les fonction·s de médiation. Pour mieux comprendre cette nuance, appliquons-la à mon sujet, la revue scientifique en lettres et sciences humaines : la revue scientifique est une instance éditoriale assurant à ce titre plusieurs fonctions dont la sélection, la validation, la production et la diffusion d’articles scientifiques. Actrice du secteur de la communication scientifique, la revue est un media en cela qu’elle assure l’enregistrement et la transmission de connaissances scientifiques auprès d’une communauté, dans une forme et une temporalité particulière. Depuis l’apparition des premières revues « électroniques » désormais qualifiées de « numériques », le medium des revues scientifiques peut être soit le papier, soit un support numérique décliné en différents formats. Si certaines revues se révèlent spirituelles, aucune n’est médium, et aucune ne s’est distinguée comme média de masse. Ce qui me semble essentiel avec la notion de media réside dans la relation du media à son milieu. Je reviendrai sur la notion de milieu dans le troisième chapitre de la thèse, en lien avec une approche écologique de l’écriture.
Comme tout media, la revue a tendance à s’ignorer en tant que tel : le media se fait transparent en focalisant l’attention sur un élément qui lui est propre. En l’occurrence, dans le cas de la revue, cette réduction s’opère au profit du format. C’est donc par le biais de la notion de format que j’aborderai la revue dans ce premier chapitre, dans une perspective résolument info-communicationnelle où seront discutées les dimensions historique, technique et matérielle, sociologique et épistémologique de la revue media.
Comme je le montrerai, le format de la revue périodique, indissociable de son unité éditoriale, l’article, est né de pratiques d’écriture spécifiques à une époque : l’écriture épistolaire. Celle-ci constituait la forme de production et d’échange de connaissances la plus efficace lors de la République des lettres. Or l’innovation éditoriale qu’a été la création des périodiques a donné lieu à une double dynamique, d’une part de formalisation des modes d’écriture et de lecture, et d’autre part d’institutionnalisation des formats article et revue comme formes essentielles de la communication scientifique. Cette dynamique a été jusqu’à aujourd’hui constitutive de la production de l’autorité et de la légitimation dans la publication scientifique. Je montrerai en quoi cette dynamique s’est désormais grippée, aussi bien sur le plan scientifique (en raison, notamment, des travers de l’économie de la publication scientifique) que sur le plan de l’innovation et de la pluralité éditoriale, comme en témoignent par exemple les modèles éditoriaux très contraignants des plateformes de diffusion.
En effet, la marchandisation qui était déjà à l’œuvre dès les premiers périodiques savants s’est brusquement intensifiée dans la seconde moitié du siècle dernier. Elle a conduit à la concentration éditoriale et a introduit dans la vie académique une injonction croissante à la publication, modifiant les enjeux et la nature même de la publication. Or l’avènement du numérique a fait émerger de nouvelles pratiques de lecture et d’écriture, notamment dans le monde académique, mettant à jour le déphasage croissant du format de la revue avec ces pratiques émergentes. Je montrerai que ce déphasage est autant éditorial qu’institutionnel, et constitutif d’un biais épistémologique dans le champ des lettres et sciences humaines.
De fait, n’y a-t-il pas là matière à poser l’hypothèse d’un moment similaire à celui qui a vu l’apparition des périodiques savants ? Comment repenser alors la revue à la lumière de son histoire médiatique ? Comment la revue se remédiatise-t-elle dans ce moment caractérisé par l’environnement et la culture numérique ? Enfin, comment cette remédiation vient finalement questionner une certaine conception récente de la revue, engluée dans son format ?
Prendre soin de la chaine de production de l’écrit
Au moment où le support d’écriture et de lecture est si radicalement transformé, je soutiens qu’il relève de la responsabilité de l’institution de « prendre soin » de la chaine de production de l’écrit. Les institutions en général existent par et pour les inscriptions qu’elles sont censées garantir : registres, rapports, mémoires, archives, catalogues, index, inventaires, nomenclatures, formulaires, etc. L’écrit est au cœur du fonctionnement de l’institution, c’est à la fois ce sur quoi elle repose (sa condition d’existence), et ce qu’elle certifie (sa raison d’être). À cela s’ajoute, pour l’institution scientifique, ce qu’elle étudie.
Là où certaines institutions trouvent leur stabilité et leur pérennité dans une nécessaire inertie vis-à-vis de ses écrits et de ses inscriptions, l’institution académique a cette particularité de devoir adopter une position réflexive sur ses écrits, mais aussi sur la chaîne de production de l’écrit, dont les processus contribuent à la légitimation. On retrouve ce projet scientifique dans les approches de certaines disciplines dont l’épistémologie des sciences, l’archéologie des savoirs, ou encore l’histoire du livre. Mais pourquoi reléguer à certaines spécialités un aspect aussi primordial de la légitimité des savoirs ?
Assumer cette réflexivité participe à la consolidation de la légitimité des écrits, et par conséquent de l’institution qui les produit. Au contraire, abandonner cette dernière préoccupation équivaut en quelque sorte à couper son cordon d’alimentation. En tant que garante des écrits et de l’écrit, l’institution ne peut légitimement exister que si elle accompagne les pratiques et les techniques d’écritures, les analyse et en prescrit de nouvelles.
Plus que pour toute autre institution, la recherche sur la chaîne de production de l’écrit scientifique constitue ensemble sa mission, sa raison d’être et la condition de sa survie.
C’est ainsi, en tout cas, que nous considérerons l’institution, dans cette vision idéale et paradoxale d’une institution garante des écrits qu’elle assure en les stabilisant, en les analysant et en les interprétant, mais qui dans le même temps ne peut exister que dans la dynamique d’une remise en question de l’écrit, de sa chaîne de production et des techniques intellectuelles qui lui sont associées. C’est la condition pour ne pas confondre la conservation des écrits avec la conservation de l’écrit.
Certes, notre outillage intellectuel se nourrit des interrogations que l’on porte à son sujet : l’analyse, explicite ou non, de la façon dont l’écriture agit sur elle-même accroît de façon surprenante nos capacités à comparer, imaginer, synthétiser. Mais, étudier cette réflexivité, profiter de sa dynamique, c’est évidemment aussi s’y engager soi-même: adopter une posture de recul face à l’instrument essentiel à la construction de notre pensée transforme notre représentation du monde, l’organisation de nos raisonnements. (Guichard 2002, Introduction)
La réflexivité intrinsèque de cette démarche est nécessairement une mise en danger de l’institution, dans la mesure où elle se doit de constamment réévaluer ce qui la structure. Cela nécessite la cohabitation complexe de deux approches antagonistes, une approche conservatrice de protectionConservation qui tend parfois à l’enclosure des écrits et de leurs techniques intellectuelles, comme le montre Guichard en conclusion de la seconde partie de sa thèse (2002, sur Hypothesis).
, et une vision basée sur le soin (« prendre soin »), le doute, la remise en cause. Cette vision tend nécessairement à l’évolution et à l’innovation de l’écrit, de son milieu et de ses techniques.
Cela constitue donc pour l’institution un projet continu, autrement dit un champ de recherche, qui ne peut se réaliser que dans l’expérimentation et la conception de nouveaux processus de production. Confronté à l’introduction de l’informatique au prestigieux département de Lettres de l’ENSl’École Normale Supérieure.
, Éric Guichard considère l’expérimentation – dans son cas d’étude, la conception et l’édition d’un site web scientifique – comme le moyen de « rapprocher le document [l’écrit] des outils et méthodes qui en ont permis la conception ». Pénétrant péniblement l’ENS en 1998, Internet, en tant que milieu technique numérique, venait en effet « réhabilite[r] les aspects obscurs, non-dits, de la production scientifique que sont les outils et méthodes ». (Guichard 2002)
Finalement, c’est dans cet effort de réflexion et de conception d’une « chaine de production de l’écrit » que pourra s’esquisser l’élaboration d’un modèle épistémologique articulant l’édition, la publication, la recommandation (légitimation, certification), l’évaluation, l’écriture et la consultation. Il conviendrait ainsi d’accompagner des innovations éditoriales susceptibles de faire émerger de nouveaux formats de communication scientifique, plutôt que de consolider des formats anciens dans des schémas contraints qui ne souffrent que des évolutions à la marge. De même que la pratique épistolaire au 17ème siècle a été le terreau de l’émergence d’un format éditorial de communication scientifique entièrement nouveau, peut-on envisager l’hypothèse d’un format conversationnel se basant sur les pratiques conversationnelles émergentes dans l’espace numérique ? Les revues ont-elles la latitude nécessaire pour renouer avec l’innovation éditoriale qui les caractérisait et pour réinventer les formes de la communication savante ?
Pour aborder ces problématiques, ce premier chapitre propose un premier parcours en quatre parties. La première décrit la naissance historique de la revue et établit comment l’article et la revue se sont formalisés tout en instituant les bases de la légitimation propres à l’édition scientifique moderne. La seconde partie confronte l’édition scientifique au moment numérique, pour en examiner les déphasages et pour poser les enjeux et les défis qu’elle doit relever. Je proposerai ensuite le cadre théorique dans lequel je m’inscris, invoquant notamment la pensée intermédiale pour envisager le renouvellement de la revue comme une « remédiation ». La dernière partie s’appuiera sur le cas d’un dispositif d’éditorialisation utilisé dans le cadre d’une conférence scientifique, dont l’analyse laisse entrevoir une forme nouvelle de communication scientifique. Sur la base des réflexions proposées par Louise Merzeau à l’aune de la théorie de l’éditorialisation de Marcello Vitali-Rosati, je poserai les premiers éléments d’un format conversationnel pour l’édition scientifique.
Au 17ème siècle, la naissance d’un format éditorial
S’imposant en quelques dizaines d’années comme un pilier essentiel de la communication scientifique, l’émergence du périodique savant constitue un tournant épistémologique majeur pour la science moderne (Peiffer et Vittu 2008, 281). J’appuie mon analyse sur les travaux approfondis que Jean-Pierre Vittu a réalisés à propos du Journal des savants, à partir desquels il met en évidence l’impact épistémologique du périodique« Notre problématique envisage le Journal des savants comme une forme éditoriale dont les conditions de production et la matérialité même suscitèrent des positions stratégiques nouvelles dans les champs du savoir et induisirent des recompositions de leur configuration. » (Vittu 2002a, 181)
, en tant que forme éditoriale innovante.
Cette étude nous éclaire sur ce moment de l’histoire, crucial pour la science moderne, où la communauté savante se dote d’un nouveau mode de communication. En tant que media, c’est-à-dire en tant qu’« opérateur de médiation » (Bardini 2016, sur Hypothesis) et de communication – ici scientifique – la revue se définit d’abord par son format éditorial : une compilation de textes courts rassemblés en un feuillet, diffusée de manière périodique selon une temporalité plus ou moins rapprochée. Cette forme, expérimentale en premier lieu, va progressivement se normaliser et adopter des pratiques communes d’un éditeur à l’autre. Quels ont été les enjeux notamment épistémologiques de ce processus de formalisation qui a façonné la revue et son corollaire, l’article ? Comment ces deux formats ont-ils servi les fonctions originales que s’étaient données les fondateurs, et quelles en ont été les implications en matière de diffusion des connaissances, mais aussi du point de vue de leur production ?
Dans cette partie, je chercherai à mettre en évidence la conjonction entre les processus de formalisation éditoriale, de légitimation et d’institutionnalisation. Partant de la forme originale du premier périodique savant, la revue media subsiste et s’impose par un format, c’est-à-dire par la formalisation des formes périodiques qui émergent de manière concomitante à la fin du 17ème siècle. Ce processus, relativement rapide dans le contexte technique et matériel pré-industriel, est habité de tensions systématiques entre la dimension formaliste de la revue, de ses contenus et finalement des savoirs qu’elle véhicule, et la dimension expérimentale et créative, dont l’un des premiers enjeux fut de favoriser et d’élargir la « grande conversation scientifique »Jean-Claude Guédon s’appuie sur ce terme à plusieurs reprises pour parler de la science « globalement et mondialement » comme d’une « Grande Conversation » (Kauffmann 2010). Je reprends à mon compte cette idée de la grande conversation comme image de la « communication scientifique […] qui, à travers le temps et l’espace, noue et structure le territoire mondial de la recherche » (Guédon 2014, sur Hypothesis).
assurée jusqu’alors par la République des lettres.
Cette histoire essentielle nous permet de mieux comprendre les protocoles éditoriaux actuels et les modalités de l’autorité et de la légitimation scientifique. Mais ce moment particulier du 17ème siècle laisse également transparaître une certaine similitude avec notre moment contemporain. En effet, l’explosion des pratiques d’écriture et des formes de communication actuelle se traduit, comme à l’époque, par une innovation éditoriale mettant en tension à la fois la diversification des formes et leur institutionnalisation. Or, on peut observer cette innovation éditoriale dans les différents formats nés sur le web depuis une vingtaine d’années, mais finalement assez peu dans les revues savantes. Quelque 350 ans après la naissance du Journal des Savants, la revue reste-t-elle un lieu de prédilection pour l’innovation éditoriale ? À l’heure de l’édition en réseau, existe-t-il d’autres espaces et instances susceptibles d’accueillir et de formaliser les pratiques communicationnelles émergentes ?
le Journal des Savants : les fondements de la communication savante périodique
En 1665 naît le premier périodique scientifique, le Journal des Savants, lancé par Denis de Sallo (1926-1969). L’entreprise voit le jour dans le contexte intellectuel hérité de la République des lettres dont la communauté de savants et de lettrés s’attachait à cultiver le savoir, mais aussi à le communiquer, le transmettre et le diffuser (Volpe et Schopfel 2013). Jusqu’à la seconde moitié du 17ème, la République perdure en Europe grâce à une intense correspondance personnelle entre les membres des cercles savants. Dans l’esprit de partage et d’ouverture caractéristique de cette communauté, l’information scientifique transitait alors essentiellement par voie postale, au travers des frontières linguistiques et géographiques, transgressant ainsi les frontières sociales, politiques et religieusesCette transgression n’est pas sans rappeler une certaine contamination des disciplines et des communautés de savoir entre elles, y compris hors du monde académique, contamination favorisée également par une plus grande circulation des connaissances à l’ère numérique. J’y reviendrai d’ailleurs dans le dernier chapitre.
.
L’initiative de Denis de Sallo est d’abord l’entreprise privée d’un magistrat et homme d’affaires évoluant « à la confluence des cercles administratifs, mondains et savants » (Vittu 2002a, 181‑82). L’initiative personnelle va rapidement s’émanciper de son créateur et adopter un fonctionnement plus collégial, à partir duquel le format périodique savant pourra progressivement s’institutionnaliser au fil des années, parallèlement à l’essor de la légitimité du Journal.
Le pendant anglophone du Journal des Savants est lancé quelques mois plus tard au sein de la Royal Society de Londres par Henry Oldenburg (1619-1677), diplomate et homme de sciences d’origine allemande. Le Philosophical Transactions institue dès sa création, dans le prologue du premier numéro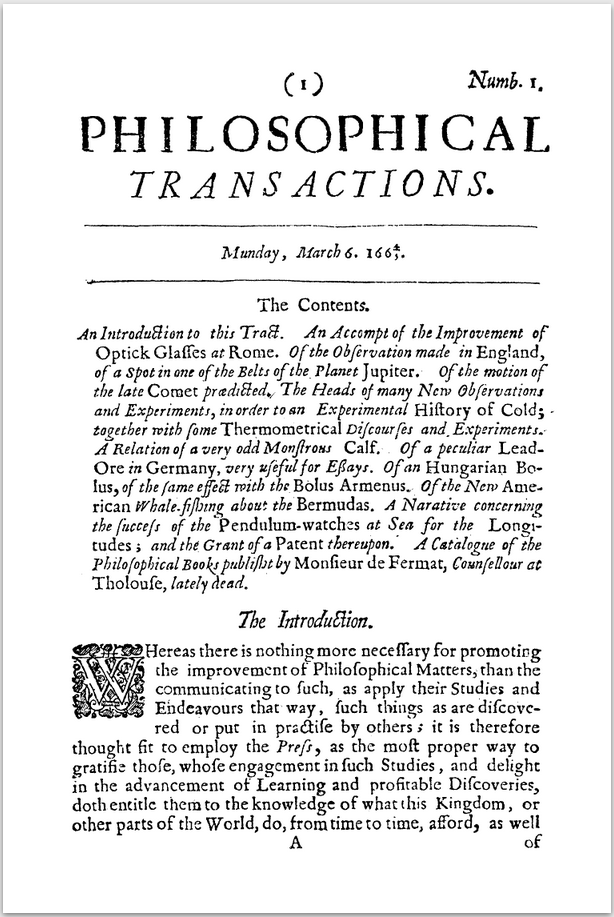 Aperçu de l’introduction au premier numéro du Philosophical Transactions (« The Introduction » 1665)
Aperçu de l’introduction au premier numéro du Philosophical Transactions (« The Introduction » 1665)
, quatre missions dont les modalités évolueront avec le temps, mais qui resteront jusqu’à aujourd’hui les principales fonctions éditoriales des revues scientifiques dans l’élaboration des connaissances : l’enregistrement, la certification, la diffusion et l’archivage (Volpe et Schopfel 2013). Ces fonctions médiatrices de l’instance revue sont-elles encore d’actualité ? Que deviennent-elles une fois la revue devenue numérique ? Comment le changement de medium bouleverse-t-il les fonctions du media ?
Vittu souligne l’émergence progressive, « par touches successives », de la forme éditoriale du périodique, et la caractérise « par une publication régulière d’éléments, les articles, destinés à constituer un recueil enrichi de diverses annexes qui en facilitaient l’utilisation »« Les rédacteurs qui se succédèrent à la tête du Journal des savants de 1665 jusqu’à la retraite de Jean-Paul Bignon, mirent en place par touches successives une nouvelle forme éditoriale, celle du journal savant qui se caractérise par une publication régulière d’éléments, les articles, destinés à constituer un recueil enrichi de diverses annexes qui en facilitaient l’utilisation. » (Vittu 2002a, 189)
(Vittu 2002a, 189).
À ses débuts, c’est-à-dire avant que sa forme éditoriale ne soit établie et ne s’institutionnalise, le périodique apparait dans un premier temps à la communauté de la République comme le moyen d’élargir ses correspondances privées à de très nombreux lecteurs. Mais la fonction du périodique ne s’arrête pas à la seule communication des travaux récents, elle devient un instrument de savoir au cœur des pratiques d’écriture et de lecture.
L’organisation du Journal comme chambre d’écho des lettrés et des savants, la multiplication des périodiques inspirés de son modèle, enfin la création d’outils facilitant sa consultation, témoignent de la construction d’un instrument nouveau dont l’utilisation bouleversa sensiblement les usages de la République des Lettres. (Vittu 2002b, 349)
Conformément aux objectifs des fondateurs, la revue devient aussi le moyen de s’assurer et de protéger la primeur d’une découverte ou d’une invention, et ce bien plus efficacement que les actes des académies, dont la temporalité ne peut rivaliser avec la fréquence de publication des périodiques.
Il y a alors un double mouvement à l’œuvre dans les missions que se sont données les revues scientifiques. En effet, que ce soit l’élargissement du lectorat ou l’enregistrement et la certification des contenus, la revue devient une instance de légitimation des connaissances au sein de la communauté des savants.
Au-delà de ces activités de cabinet, le développement des journaux savants suscita de nouveaux usages au sein de la République des Lettres. Nouveaux instruments de divulgation des découvertes les périodiques devinrent bientôt l’un des moyens d’acquérir une position dans la communauté savante, ce que les académies constituées envisagèrent avec une certaine réserve. Productions éphémères, volantes, au contenu mélangé, ils se transformèrent en instruments privilégiés du travail savant grâce à des prolongements, qui eux-mêmes induisirent des réorganisations des bibliothèques et de recompositions du savoir. (Vittu 2002b, 367)
Le rôle de la revue n’est pas celui d’un simple intermédiaire. Elle est le vecteur matériel d’un contenu certes, mais plus important, elle en est le vecteur symbolique, car elle y adjoint la légitimité nécessaire à sa réception. En ce sens, la revue scientifique acquiert bien le statut media. Comme on le verra, cette légitimité s’est construite de concert avec le format de l’article de revue, et plus largement avec le format de la revue. En formalisant un modèle éditorial de communication scientifique, les revues se sont dotées d’une matérialité concrétisant le processus d’institutionnalisation, tant des contenus qu’elle est chargée de véhiculer que de la revue comme modèle éditorial. On le voit notamment avec l’adoption du terme article désignant une forme éditoriale de plus en plus normalisée comme en témoigne l’étude menée encore une fois par Vittu (2001, 137) sur l’évolution des titres des articles. L’institutionnalisation se manifeste également dans la reconfiguration des disciplines« [E]n soulignant la démarche d’un groupe de savants, en créant des liens entre divers problèmes résolus par les mêmes méthodes et en nommant ses membres, les journaux font aussi émerger de nouvelles disciplines — l’analyse dans les Acta eruditorum de la fin du 17eme siècle — dont la reconfiguration, tel qu’on peut la suivre dans les index annuels, change sans cesse. » (Peiffer et Vittu 2008, 299)
telle qu’elle s’est exercée corrélativement à la spécialisation des périodiques, pendant laquelle ceux-ci se sont dotés d’index et d’éléments de repérage pour permettre au lecteur de s’orienter.
La fabrique de l’autorité
F facilement attaquable (et donc régulièrement attaqué) pour ses positions critiques jugées trop personnelles, le rédacteur du Journal se voit épaulé en 1687 suite à la décision du Chancelier par un « bureau de rédacteurs », composé de lettrés et de savants, pour répondre aux critiques de partialité dont faisait l’objet le Journal. Ce bureau tente alors d’attribuer au périodique d’un côté une position plus neutre et moins controversée que celle du rédacteur unique et, de l’autre, une responsabilité éditoriale plus engagée et moins diffuse que celle de la « compagnie des gens de lettres » qui venait cautionner les contributions par l’intermédiaire d’un membre reconnu de la République des lettres. Neutralité et responsabilité : les ingrédients de la fonction éditoriale scientifique se mettent en place et s’inscrivent dans le dispositif de la revue (Vittu 2002b).
Avec la formalisation de l’article comme objet éditorial à travers la normalisation de la référence bibliographique, mais aussi à travers l’engagement de la responsabilité éditoriale, on assiste à une évolution de l’autorité. Viendra d’abord la légitimation du travail de rédacteur et du journal lui-même puis, une fois cette légitimité reconnue, celle des auteurs et enfin des articles eux-mêmes. On le voit, le processus de normalisation va de pair avec celui de l’institutionnalisation. Cette imbrication très fine des processus permet aux marqueurs éditoriaux de faire dispositif. L’édition devient alors le lieu de fabrique d’une autorité, incarnée par les normes éditoriales et figurée par la fonction éditoriale. Grâce à son dispositif éditorial, le Journal des savants acquiert un statut d’autorité, en tant qu’acteur central dans le paysage savant de l’époque. Cette autorité est celle d’un format et d’une inscription normalisée, ayant démontré l’efficacité et la légitimité du périodique comme nouvel objet éditorial. Elle peut alors s’appliquer par extension à toute revue adoptant les mêmes principes éditoriaux.
À la fin du 17ème siècle, le nombre de revues scientifiques explose. En 1684, vingt ans seulement après les premiers numéros du Journal des Savants, Pierre Bayle écrit dans la préface de la première édition du périodique les Nouvelles de la république des lettresPierre Bayle (1647-1704) est philosophe et écrivain. Il crée les Nouvelles de la république des lettres en 1684.
:
« On a trouvé si commode & si agréable le dessein de faire sçavoir au Public, par une espèce de Journal, ce qui se passe de curieux dans la République des Lettres, qu’aussitôt que Monsieur Sallo, Conseiller au Parlement de Paris, eut fait paroître les premiers essais de ce Projet au commencement de l’année 1665, plusieurs Nations en témoignèrent leur joye, soit en traduisant le Journal qu’il faisoit imprimer tous les huit jours, soit en publiant quelque chose de semblable. Cette émulation s’est augmentée de plus en plus depuis ce temps-là ; de sorte qu’elle s’est étendue non seulement d’une Nation à une autre, mais aussi d’une science à une autre science. Les Physiciens, & les Chymistes ont publié leurs Relations particulières ; la Jurisprudence, & la Médecine ont eu leur Journal ; la Musique aussi a eu le sien ; les Nouvelles Galantes diversifiées par celles de Religion, de Guerre, & de Politique ont eu leur Mercure. Enfin on a vu le premier dessein de Monsieur Sallo executé presque par tout en une infinité de manières. » (Pierre Bayle, Nouvelles de la République des Lettres. Préface. mars 1684) (Vittu 2002a)
Le succès des premières initiatives éditoriales, bien que poursuivant des ambitions parfois personnelles, atteste du vide qu’il y avait alors à combler au sein de la communauté des lettrés. Car en densifiant les échanges et en les structurant en un format éditorial, les périodiques n’ont pas seulement prescrit de nouvelles pratiques d’écriture, ils ont aménagé un nouvel espace dont la communauté s’est emparée pour s’organiser. Parce qu’ils répondaient parfaitement à l’économie et aux pratiques de communication de l’époque, les formats du périodique et de l’article ont fourni une structure spatiale viable et opérante au service d’un collectif.
De la correspondance à l’article : première formalisation
L’apparition du terme article pour identifier les parties de texte de périodique date du milieu des années 1680, lorsque Pierre Bayle intitula « article » chacun des segments numérotés de ses Nouvelles de la République des Lettres. Les libraires d’Amsterdam l’imitèrent rapidement pour parfaire leur contrefaçon du Journal des savants. Les rédacteurs du Journal vont progressivement adopter une formalisation de l’article, mais sans en adopter le terme. Il faut cependant attendre 1711 pour que l’« article » rentre dans le langage courant et désigne une partie de périodique scientifique (Vittu 2001, 148).
Dans un premier temps, les contributions aux périodiques sont définies par leur structure et leur composition, que ce soit un extraitL’extrait désigne un résumé ou une recension d’un ouvrage.
ou un mémoire, et sont adossées à une « autorité » venant cautionner la contribution de l’auteur. Les éléments éditoriaux qui accompagnent les contributions sont minimaux. Le périodique est alors une simple suite continue de textes, de segments simplement séparés par un titre lui-même non normalisé.
L’étude des titres de segments dans le Journal des savants est éloquente sur la progression vers un formalisme et une professionnalisation de la référence, intégrant par étapes tout ce qui constitue aujourd’hui une notice bibliographique : auteur de l’extrait, mention du lieu et de la date d’édition, indication du nombre de pages de l’ouvrage recensé, son format et le nom de son éditeur. D’un titre souvent accrocheur imprimé sur trois lignes en 1665 et reflétant les pratiques épistolaires entre lettrés, il passe à huit lignes en moyenne en 1714. Une première explication est d’ordre commercial, le rédacteur essayant de s’attirer les faveurs des libraires pour obtenir les derniers ouvrages. Une autre explication est d’ordre éditorial tant la formalisation des titres participe à la construction sur le temps long d’une matière scientifique mieux référencée et donc plus exploitable.
Le format « article » s’accompagne par ailleurs d’éléments éditoriaux outillant la lecture« Du point de vue éditorial, un tel article se caractérise comme un segment d’un imprimé rapidement produit, soumis à la loi de la nouveauté et qui accède au marché de long terme par l’adjonction de plusieurs appareils d’indexation, grâce auxquels cet ouvrage clos se transforme alors en un magasin de matériaux ouvert au choix du lecteur. » (Vittu 2001, 148)
. Les index, les tables des matières – dont les Tables annuelles – ou les références bibliographiques, constituant l’appareil critique propre à l’édition scientifique, se normalisent dans leurs formes et sont progressivement adoptés par l’ensemble de l’édition savante de l’époque. Ces marques de repérage et de navigation deviennent « les moyens d’une quête parmi les savoirs et les observations accumulées au fil des semaines, puis des mois » (Vittu 2002b, 377).
L’art de la contrefaçon : l’éternel enjeu de la diffusion
Témoin du succès des tout premiers titres, la contrefaçon, en particulier hollandaisePar Daniel Elzevier (1626-1680), de la célèbre famille de typographes et d’imprimeurs néerlandais.
, permit notamment au Journal des savants d’élargir considérablement sa diffusion en Europe centrale et en Europe de l’Est, dès la première année de parution. L’histoire de cette contrefaçon est intéressante à plus d’un titre.
Premièrement sur le plan juridique, où l’on comprend que le privilège royal accordé au rédacteur et au libraire ne pouvait protéger ces derniers que sur un territoire limité, puisque des contrefaçons apparaissent également en Aquitaine. Hors de la juridiction du Roi, à Amsterdam par exemple, tout contrefacteur était considéré dans son bon droit lorsqu’il entreprenait la réimpression et la vente de nouveaux textes. À tel point que le premier contrefacteur s’emparant d’une œuvre ou d’un périodique s’en assurait l’exclusivité, absolument respectée par ses confrères.
Une édition hollandaise copiant une édition parisienne avec privilège peut ainsi, selon l’extension que l’on donne au concept de contrefaçon, être réputée soit contrefaite soit seulement réédition, puisque le droit de copie français n’est pas opposable aux autorités des Pays-Bas. Une convention signée en 1710 par cinquante-quatre libraires hollandais accordait même au premier contrefacteur d’un ouvrage étranger une espèce de droit de copie moral reconnu par ses confrères ! (Moureau et Darnton 2006, 141‑42)
Deuxièmement sur le plan économique, les limites matérielles et financières de l’imprimeurL’imprimeur Cusson du Journal des Savants ne possède alors qu’un petit nombre de presses.
empêchent une plus large circulation, alors limitée aux grands centres universitaires d’Europe de l’Ouest et du Sud et aux canaux diplomatiques. Ainsi, l’impression contrefaite du Journal dans une ville marchande comme Amsterdam entraîne sa circulation sur des réseaux marchands bien plus vastes, moins érudits et à moindre coût. Cet aspect économique reflète en passant les enjeux de pouvoir et d’occupation qui émergent en même temps qu’un nouveau territoire symbolique se met en place.
Sur le plan éditorial, le monopole (limité matériellement) de l’impression fait également obstacle à la diversification des formes éditoriales telle que la pratiquait l’imprimeur hollandais. C’est ainsi que le format adopté pour la contrefaçon consistait en des recueils annuels, dans une édition plus petite (in-douze habituellement au lieu des coûteuses éditions parisiennes in-quarto), transformant l’instrument d’information éphémère qu’était le périodique dans le Royaume en un ouvrage de référence à l’extérieur (Vittu 2002a).
Cependant, la conversion éditoriale du format périodique en recueil annuel n’est pas le simple fait d’une contrefaçon différée. Elle vient s’inscrire dans le projet initial des fondateurs des revues pour une véritable construction de connaissances. Les travaux de Vittu montrent ainsi comment le Journal des savants avait dès le début adopté une pagination continue d’un numéro à l’autre, préfigurant la constitution de recueils de numéros. Vittu décrit également l’instauration progressive d’instruments éditoriaux entièrement tournés vers la structuration des connaissances facilitant la recherche et la découverte : index, différentes tables des matières, sommaires, formalisation des références. À ce propos, les méthodes d’indexation utilisées par l’éditeur parisien et les contrefacteurs hollandais divergent, le premier élaborant des tables analytiques reflétant une vision davantage encyclopédique d’accès aux savoirs, les seconds adoptant une approche bibliographique (Vittu 2001, 148). Vittu va d’ailleurs montrer que la réception du Journal et des périodiques en général s’accompagne d’un renouvellement des pratiques savantes, de la lecture à l’écriture, outillées par ces nouveaux instruments (Vittu 2001, 142), et d’un élargissement à de nouveaux publics (Peiffer et Vittu 2008, 299).
À ce stade, une citation de Vittu fait ressortir des éléments de continuité entre la naissance au 17ème d’un nouveau format de communication scientifique, et l’émergence aujourd’hui de nouvelles formes d’écriture et d’édition :
« D’un point de vue éditorial, l’article est un segment d’un imprimé. Il est produit rapidement, soumis à la loi de la nouveauté, accède au marché de long terme par l’adjonction de plusieurs appareils d’indexation. L’ouvrage clos se transforme alors en un magasin de matériaux ouvert au choix du lecteur. Par ses origines juridiques, le mot article rend bien compte de cette articulation d’une rhétorique acceptée par la communauté savante et d’un appareil offrant la possibilité d’une lecture aléatoire du journal savant en plus de sa lecture séquentielle. » (Vittu 2001, 148)
On a dans cette formulation tous les éléments d’une maîtrise des flux informationnels par l’indexation et le traitement de l’information : la fragmentation, les métadonnées, la diversification des parcours de lecture jusqu’à l’intégration de la longue traîne. L’analogie avec les pratiques éditoriales actuelles est frappante et l’on pourrait rapprocher l’émergence de ces nouveaux objets éditoriaux que sont l’article et la revue au 17ème siècle comme une réponse à la saturation attentionnelle consécutive de l’imprimerie. Alors qu’émergent aujourd’hui de nouvelles pratiques et de nouveaux formats éditoriaux, dans le sens notamment d’une fragmentation des artefacts institués, on peut raisonnablement envisager une institutionnalisation de ces formats, de la même manière que le périodique s’est imposé, a légitimé et institutionnalisé le format épistolaire caractéristique de la République des lettres.
Les appropriations du périodique par la communauté savante
Comment l’article et le périodique ont-ils transformé le travail des savants, et notamment l’écriture ? L’étude de Peiffer et Vittu (2008) décrit la façon dont les savants et les lettrés se sont approprié les revues savantes de multiples manières, pour leur travail de recherche, pour résoudre des controverses ou pour construire leur légitimité« Du côté des savants, ils sont nombreux à se saisir de la nouvelle forme de communication qui s’est mise en place à la fin du 17eme siècle. Ils ont recours aux journaux savants pour y puiser des informations, pour faire connaître les résultats de leurs recherches, ou pour commenter, étendre et critiquer ceux de leurs collègues. » (Peiffer et Vittu 2008, 289)
. Que les journaux soient considérés « comme des moyens d’information, des sites de production des savoirs ou des instruments stratégiques », la communauté savante se les ait appropriés au point de modifier ses pratiques d’écriture, voire les modalités de la preuveC’est le cas par exemple en mathématiques où, progressivement, les éléments de démonstration sont systématiquement intégrés pour « énoncer explicitement la solution d’un problème » (2008, 298).
.
Sur le plan communicationnel, les périodiques savants se sont imposés comme un élément central dans la constitution des communautés scientifiques. En effet, les périodiques ne publient pas seulement des productions scientifiques telles que « des observations, des récits d’expérience scientifique, des réflexions théoriques », mais aussi « des débats et nouvelles du monde savant, comme de ses institutions ». Les auteur·e·s de l’étude affirment ainsi que, au-delà du travail de recherche lui-même, les périodiques constituent « une forme de communication qui prospéra au point de devenir, dès le 19ème siècle, dominante pour les sciences » (2008, 281).
Sur le plan intellectuel, l’étude montre que les revues sont devenues un véritable outil de travail, aux nombreux usages« Qu’ils les utilisent pour publier leur recherche, pour s’informer ou pour des raisons stratégiques, dès la fin du 17eme siècle, les savants, même si certains prétendent honnir les journaux, s’approprient pleinement ce nouvel outil de communication scientifique — bien qu’il en fassent des usages différents. Ainsi, la richesse des multiples manières dont les savants se sont approprié les possibilités offertes par la forme périodique est considérable. » (2008, 290)
. Les témoignages de fébrilité de certains savants pour se procurer les dernières livraisons démontrent à quel point les périodiques sont devenus indispensables – « un véritable enjeu scientifique » – à l’activité du lettré. L’étude pointe par exemple la « pratique assez courante de collecte plus ou moins systématique d’une information spécialisée dans des journaux savants comme en témoignent les recueils réalisés à la fin du 17ème siècle » (2008, 291). Ces recueils d’extraits sont utilisés pour l’étude privée, mais dépassent aussi la table du chercheur en s’invitant dans les cours d’université sous forme de compilations« Comme le suggère le témoignage de Bodenhausen qui apprenait l’analyse leibnizienne pour son propre plaisir, [les compilations] nourrissaient l’étude privée des savants. Ou leur enseignement, comme c’est le cas pour Antonio Vallisnieri qui utilisait systématiquement des extraits tirés de plusieurs journaux savants (qui pourtant ne se trouvaient pas à la bibliothèque universitaire), pour enrichir ses cours de médecine à l’université de Padoue. » (2008, 291)
.
Les périodiques sont également appréciés pour leur fonction de sélection, remède à l’abondance des publications qui caractérise (déjà) l’époque. C’est d’ailleurs sur cette fonction éditoriale nouvelle que s’établira bientôt une partie de la légitimation des savants.
La périodicité rapide des publications confère enfin aux savants la capacité nouvelle de se répondre publiquement les uns les autres, de s’appuyer sur les précédents, de réinterpréter un texte à la lecture d’un autre, etc. Peiffer et Vittu identifient là « le cœur du travail que la forme périodique permet » (2008, 294). On le voit par exemple avec les recueils d’extraits, véritable « matériau » pour la recherche, quand, recopiés à la main et annotés, ils font l’objet d’une nouvelle publication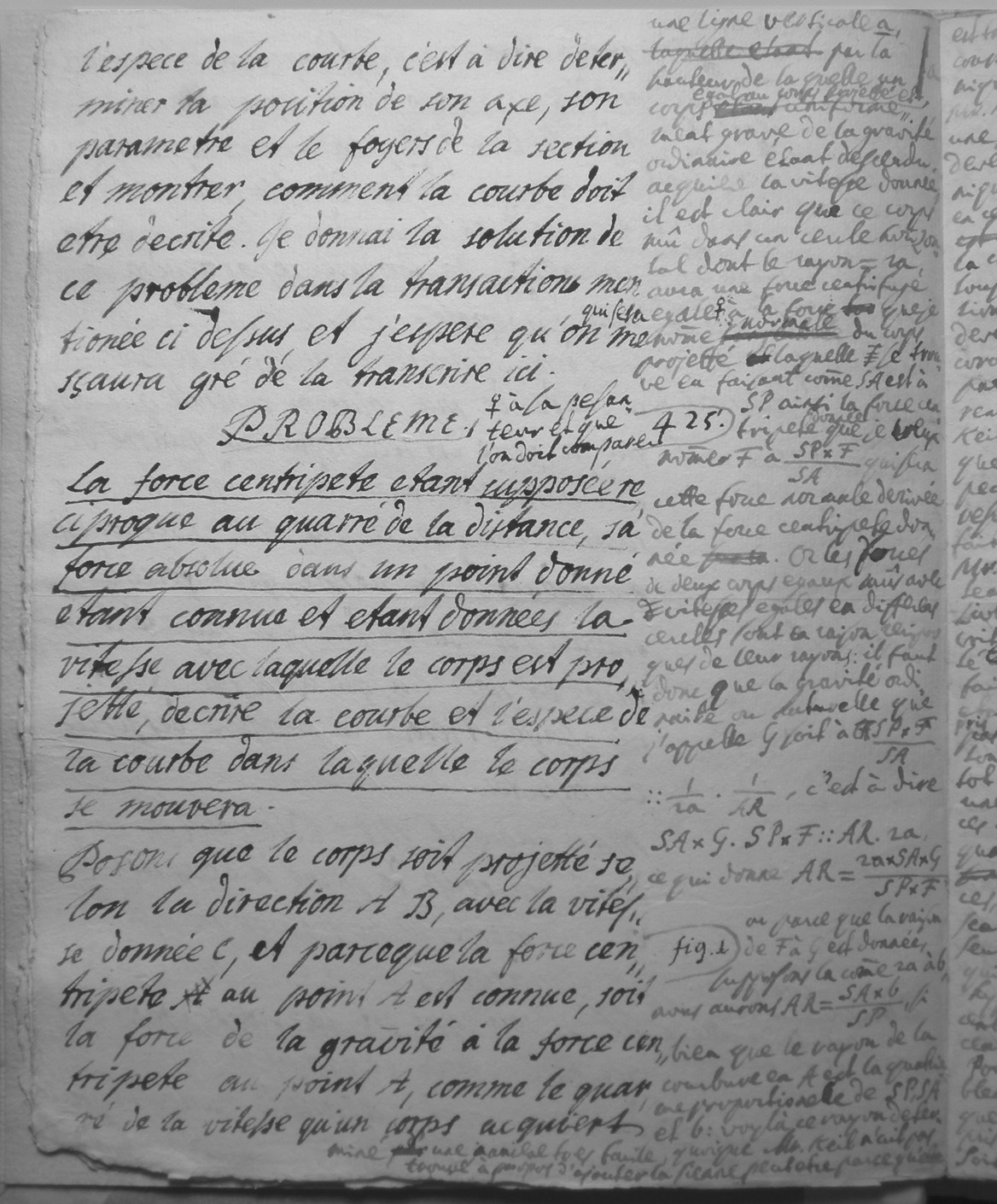 Annotations par Johann Bernoulli d’une copie manuscrite de l’article de John Keill, « Défense du Chevalier Newton » paru dans le Journal littéraire 8 (1716), p. 418-433. [Bibliothèque universitaire de Bâle, LI a 14, fol. 5 V o ] (Peiffer et Vittu 2008, 293).
Annotations par Johann Bernoulli d’une copie manuscrite de l’article de John Keill, « Défense du Chevalier Newton » paru dans le Journal littéraire 8 (1716), p. 418-433. [Bibliothèque universitaire de Bâle, LI a 14, fol. 5 V o ] (Peiffer et Vittu 2008, 293).
.
Ainsi, une méthode est élaborée et publiée dans un journal, le mémoire est repris et critiqué, cette critique elle-même étant soumise à une nouvelle critique à laquelle d’ailleurs il y aura réplique. (2008, 295)
Or le périodique, en tant que format, n’est pas neutre. Les auteur·e·s relèvent ainsi à propos de la relation entre la conversation scientifique et les modalités éditoriales de la production scientifique, que « la publicité des débats, lorsqu’il y a désaccord, voire controverse, change les termes de ces débats » (2008, 298). Cela vient suggérer une certaine performativité de la revue scientifique et de sa fonction de médiation sur les connaissances et les controverses qu’elle véhicule. Le périodique semble produire une unité, une consistance et un contexte favorables pour établir la conversation scientifique dans le temps long.
Bilan et perspective du format
L’histoire de la naissance de la revue savante nous montre ainsi que les innovations de support s’accompagnent d’innovations éditoriales, non sans effets sur les modes production et de circulation des connaissances. Ainsi, la démocratisation de l’imprimé à la fin du 17ème siècle a permis la refonte de la pratique épistolaire dans un format éditorial inédit dans le champ scientifique. Intimement liés, l’article et la revue sont nés en effet de la mécanisation et de la commercialisation du dispositif épistolaire. Leur institutionnalisation rapide a favorisé l’instauration d’un modèle épistémologique propre qui n’a cessé de se préciser au cours des siècles.
On peut voir l’article et le périodique au prisme du format en cela que ce dernier matérialise les règles communes, normalise les pratiques et permet au texte court et éphémère de s’ancrer dans le temps long en le structurant. Il participe enfin à la légitimité du texte en lui adossant finalement une énonciation éditoriale. La formidable innovation éditoriale qu’a été le périodique savant initie une nouvelle économie du savoir, élargissant la communauté de savoir et favorisant les échanges et la circulation.
Cela étant, en raison même du processus de normalisation qu’il suppose, le format s’accompagne d’une moindre diversité dans les pratiques, qu’elles soient éditoriales ou scripturales. À l’aube la science moderne, cette normalisation s’est sans conteste révélée vertueuse, établissant une communication scientifique bien plus fluide et efficace que la monographie académique, et dans le même temps échafaudant les règles d’autorité permettant de s’orienter dans le foisonnement d’écrits scientifiques.
Cette histoire est importante, car elle montre que la revue n’est pas seulement un artefact éditorial. Elle s’est également révélée le lieu d’une innovation institutionnelle et épistémologique. En effet, elle constitue d’un côté un dispositif institutionnel, au sens où elle focalise les formes de légitimation et de certification reconnues par les institutions académiques. D’un autre côté, sa fonction de médiation joue un rôle primordial dans la constitution des communautés scientifiques.
Ainsi, l’émergence de la revue format suggère d’élargir notre perspective sur la revue et de considérer en particulier sa fonction communicationnelle consistant à favoriser la conversation scientifique afin d’établir de nouvelles passerelles entre savants, lettrés, curieux et amateurs.
Après ce moment particulier qui a vu l’émergence des périodiques savants, je propose maintenant d’aborder le moment numérique – digital turn – que connait la revue scientifique. Ce tournant globalisé confronte tout media, quel qu’il soit, à une profonde remise en question de son modèle, de son économie et de ses acteurs. Caractérisé notamment par cette tension entre explosion des formes d’écritures et leur intense normalisation liée aux outils et langages informatiques, le moment numérique impose aux revues une profonde mutation. Dans quelle mesure la revue scientifique peut-elle encore constituer un lieu d’innovation éditoriale, institutionnelle et épistémologique ?
Le moment numérique des revues : enjeux, défis et déphasages
L’émergence de la culture numérique depuis une trentaine d’années est sans conteste un tournant historique. Considérant l’impact de l’écriture et de ses supports matériels d’inscription sur les civilisations, on peut considérer que ce tournant est également un tournant anthropologiqueLa « raison graphique » de Jack Goody rend compte du tournant anthropologique qu’a été l’écriture (Goody 1979). C’est en tant que techniques qu’il faut d’ailleurs considérer le caractère anthropologique des supports (stèle, parchemin, bande magnétique), des systèmes d’inscription (stylet, plume, caractère mobile) et des systèmes d’écriture eux-mêmes (alphabet, glyphes), ainsi que nous le rappelle Pierre Steiner dans son article de synthèse (Steiner 2010).
. Dans le champ scientifique, cette révolution numérique de l’écrit s’est manifestée de multiples manières. Dans la lignée de la mathématisation du monde déjà à l’œuvre depuis le 19ème siècle, l’informatique a entraîné un irrépressible mouvement de modélisation du réel, débordant logiquement sur le langage et le symbolique. En lien avec la modélisation du texte et du métatexte propre à l’édition, le numérique a entraîné une normalisation sans précédent des artefacts et des formats éditoriaux. Les conventions éditoriales notamment se sont uniformisées pour répondre aux exigences de la diffusion numérique. Cette normalisation est d’ailleurs allée de pair avec une institutionnalisation de la diffusion. L’apparition de nouveaux intermédiaires, coïncidant avec l’avènement de la diffusion numérique à la fin des années 1990, s’est traduite par une intense concentration de l’édition et de la diffusion dans les mains d’une poignée de plateformes et d’acteurs (Larivière, Haustein, et Mongeon 2015), avec pour conséquence la prescription de conventions éditoriales de plus en plus strictes et uniformisées. Il est intéressant de comprendre le paradoxe liant l’uniformisation des contenus et leur accessibilité, tant la première travaille à rendre les contenus plus accessibles, car mieux adaptés aux algorithmes régissant leurs accès. Ce paradoxe est éloquent quant à la problématique que je vais développer.
Mais cette institutionnalisation de la revue et de l’article touche également à leur fonction symbolique dans le champ scientifique. Le numérique a ainsi favorisé un mouvement plus ancien de professionnalisation du chercheur, dont la carrière se mesure désormais au nombre de publications et au prestige des revues les publiantJe développe cet aspect lié directement à l’introduction du Citation index, en abordant le déphasage institutionnel de l’édition scientifique.
. De ce point de vue, la représentation ou l’imaginaire de l’article et de la revue ont subi un glissement qu’il conviendra d’analyser. En creux, ce glissement explique en partie le mouvement d’émancipation des pratiques d’écritures vers des formats émergents comme le blogue, le micro-blogging, ou même les listes de diffusion.
Les tensions sont grandes au sein de la communauté savante, tiraillée entre d’une part une édition de plus en plus institutionnalisée sur le plan éditorial et marchandisée sur le plan économique, et d’autre part des pratiques d’écriture et de lecture ancrées dans la culture numérique, mais inadaptées aux contraintes institutionnelles. Car les formes nouvelles témoignent d’une certaine dissidence par rapport aux formats de l’article et de la revue, qui ne répondent plus nécessairement aux enjeux de recherche : la temporalité de publication, l’accès à l’accès – formule caricaturant à peine la résistance de certains éditeurs à l’accès ouvert et l’incohérence du principe de la barrière mobile dans l’environnement numérique –, ou encore les règles strictes de publication, tant au plan du format que des protocoles. Manifestement, le formalisme de l’édition scientifique, exacerbé par les modèles et les systèmes d’information numériques, est venu congestionner autant la diffusion des connaissances que leur production. Le succès des formats plus courts, émancipés des contraintes institutionnelles, ne peut que questionner le modèle institué de la communication scientifique.
Je voudrais ainsi dresser dans cette partie un premier constat au sujet de ce moment numérique de l’édition scientifique, en défendant l’idée d’un double déphasage, institutionnel et éditorial, entre d’une part les formes institutionnalisées de communication scientifique et d’autre part la diversification des pratiques d’écriture dans la communauté scientifique, notamment en LSH. Il me semble en effet que l’on retrouve parmi les formes d’écriture émergentes un certain idéal conversationnel que l’édition scientifique a quelque peu perdu de vue. Alors que le périodique savant imprimé avait permis à la conversation épistolaire de s’élargir et se fluidifier, je soutiens que la remédiation de la revue passera par sa capacité à recréer de la conversation au sein de la communauté savante, en s’inspirant des écritures culturellement numériques et de leurs modalités de médiation.
Écritures, techniques, savoirs : le malentendu numérique des LSH
En quelques dizaines d’années, les pratiques de lecture et d’écriture des chercheurs se sont progressivement installées dans l’environnement numérique, au point que ce nouvel environnement de travail s’est largement substitué au support papier dans le quotidien des chercheurs. Les écrans, que ce soient l’ordinateur, la tablette ou encore le smartphone, sont en effet devenus les supports majoritaires pour rechercher, lire ou étudier, référencer, collectionner ou archiver, écrire ou éditer, communiquer et échanger. Un exemple emblématique de cette mutation des usages est celui du logiciel Word, utilisé à l’université comme outil d’écriture, de note de lecture et finalement pour toute création de document, amalgamant la rédaction et l’édition des articles, des thèses et des mémoires, tout aussi bien que celles des documents pédagogiques, des exercices d’étudiants, des appels à communication, des programmes de colloque, ou encore des formulaires administratifs. Les investissements parfois colossaux des institutions académiques dans la suite Office de Microsoft illustrent bien quant à eux l’étendue de ses usages à tous les secteurs d’activité de l’Université.
L’université, en tant qu’institution du savoir par excellence où l’écriture constitue la principale activité et l’écrit le principal produit, n’aurait-elle pas intérêt à davantage contrôler son outil de travail ? N’est-il pas problématique, au regard de la relation étroite qu’entretiennent support et pensée, que les experts de la connaissance aient pu ainsi abandonner à une poignée d’entreprises privées l’expertise de leurs supports ?
Car au-delà de la suite Office, emblématique de ce paradoxe, c’est une grande part de l’écosystème d’écriture, de partage et de communication qui est ainsi laissée aux bons soins de dispositifs propriétaires, certes parfois efficaces et performants, mais dont le fonctionnement est délibérément opaque et inaccessible. Cette fermeture – ou enclosure – sur les logiciels de travail entretiennent une dynamique d’incapacitation des usagers, au moment même où les enjeux de littératie numérique appellent à la dynamique inverse. D’autant qu’à la culture de l’incompétence s’ajoute, à l’heure du cloud et du big data, une captation systématique des données elles-mêmes dans la plus grande opacité de contrats que seuls quelques administrateurs et juristes de l’institution ont le loisir de consulter.
L’enjeu de la littératie : résistances et illettrisme
Il est vrai, malgré tout, que le numérique a finalement modifié les usages et les pratiques au sein de l’université. Dans les lettres et sciences humaines, cette lente mutation est relativement récente. La thèse d’Éric Guichard (2002) nous rappelle que l’introduction du numérique chez les chercheurs et les étudiants ne s’est pas faite sans difficultés. Dans cette thèse consacrée à l’adoption – plus exactement sur la non-adoption – de l’Internet dans les rangs de l’ENS au tournant du millénaire, Guichard s’intéresse aux chercheurs et étudiants en lettres, car « ils ont cette particularité de valoriser et de commenter abondamment les effets secondaires de l’écriture (culture, histoire, patrimoine, identités, etc.) tout en affichant souvent un mépris pour la technique et un faible intérêt pour l’explicitation des relations entre écriture, outil et pensée » (Guichard 2002, Introduction). Son constat est éloquent :
L’acquisition d’un ordinateur, souvent pensé comme une machine à écrire, signifie une perte de standing, puisque qu’il [sic] témoigne de l’absence d’un ou d’une secrétaire. Et même une fois dépassée cette première attitude de rejet, il est difficile d’admettre qu’une machine puisse s’intégrer dans une quelconque panoplie de techniques intellectuelles.
Outre une ignorance frisant à son sens l’« illettrisme »« [L]a très grande majorité des personnes qui découvraient [sic] les ordinateurs [en 1996] et en acceptaient [sic] l’image commune de machine à écrire améliorée ne pouvaient concevoir que ces machines à produire du signe avec du signe puissent transformer un tant soit peu leurs pratiques. Elles s’inféodaient à des codages abscons, ne connaissaient pas l’internet, disposaient d’une très faible culture informatique, restaient — souvent isolées — dans leurs laboratoires traditionnels, et prenaient le risque de devenir rapidement illettrées. » (Guichard 2002, Situation en 1996)
, Guichard analyse cette attitude vis-à-vis de l’outil informatique comme un acte de résistance, citant à ce propos le rapport de Christine Ducourtieux :
[Q]ue l’ordinateur soit une machine à écrire performante, cela est parfait. Qu’il permette l’accès à d’autres sources de savoir, cela ne peut être toléré. Il ne s’agit pas de ‘blocage’ mais bien plus d’une volonté de résistance. (Ducourtieux 1998)
Si les sciences dures, ou certaines humanités à l’ENS comme la géographie, la sociologie ou la philosophie, avaient d’ores et déjà largement adopté l’informatique pour la recherche ou l’édition, l’usage du numérique pour les départements d’histoire, de littérature et des langages ne s’est véritablement répandu qu’avec la démocratisation au grand public de l’ordinateur personnel et du web dans la seconde moitié des années 2000.
Une telle méfiance, souvent mal réfléchie, voire réactionnaire, a pu quelques années plus tard se voir confortée par des critiques plus documentées comme celle de Nicholas Carr qui pointe un profond changement dans les modes de lectures :
Depuis toujours, nous survolons plus les journaux que nous ne les lisons, et nous parcourons les livres et les magazines pour en saisir l’essentiel et décider s’ils méritent d’être lus plus avant. Il est tout aussi important d’être capable de lire en diagonale que de lire en profondeur. Mais ce qui est différent, et qui dérange, c’est que le survol est en train de devenir notre principal mode de lecture. C’était naguère un moyen pour arriver à une fin, une façon d’identifier les informations à lire en profondeur ; maintenant, cela devient une fin en soi –, c’est notre méthode préférée pour recueillir et comprendre les informations de toutes sortes. (Carr 2011)
Pourtant, depuis la diffusion très médiatique des idées de Nicholas Carr, le point de vue de ce dernier a été relativisé par des conceptions moins déterministes de la techniqueNotons tout de même la réception très médiatisée de l’ouvrage de Michel Desmurget La Fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants (2019), qui dénonce les conséquences de la consommation excessive des écrans chez les enfants. Une telle réception démontre l’inquiétude latente de la société face à un univers numérique mal maîtrisé.
. Alain Giffard remarque notamment que Carr « n’envisage pas la possibilité que le lecteur, par un régime d’exercices appropriés, puisse conquérir son autonomie par rapport au dispositif technique, voire le détourner » (Giffard 2011). Il affine la thèse de Carr en proposant la notion de « lectures industrielles » (Giffard et al. 2009), dont l’élément déterministe sur la cognition ne réside pas dans la technique elle-même, à savoir l’environnement numérique qu’est Internet comme le prétend Carr, mais dans un (et plusieurs en fait) projet industriel « qui cantonne la lecture à une activité de communication, et nuit à l’association de la lecture et de la réflexion ». Il appelle d’ailleurs à un nouveau projet industriel de la lecture, que nous pourrions étendre à toute technique intellectuelle.
Finalement, ce que pointent ensemble ces auteurs confirme un changement profond des modalités de production des connaissances dont l’enjeu réside bien dans l’acquisition d’une nouvelle littératie. Ce qu’on appelle la littératie numérique ne concerne pas seulement les usages experts des logiciels, des formats d’indexation, des modélisations ou des algorithmes. La littératie numérique relève en fait bien plus de la culture numérique telle qu’elle s’est répandue dans les usages et la vie quotidienne de tout à chacun. Le tronc commun institutionnel de l’éducation divulguant le savoir-lire-et-écrire s’étend désormais à un savoir-lire-et-écrire dans le numérique qui intègre une connaissance générale de l’écosystème numérique, dans laquelle peuvent prétendre s’inscrire les pratiques expertes des chercheurs, y compris celles de l’édition scientifique. Ainsi, au-delà de projets industriels particuliers façonnant il est vrai l’écosystème numérique, la question est de saisir la nature de ce changement et de préfigurer les modalités nouvelles de production et de diffusion de la connaissance dans l’environnement numérique.
L’enjeu de l’accessibilité : les politiques du libre accès
L’histoire longue de l’écriture, qui est aussi celle de ses supports, nous montre que tout changement de propriété du support d’inscription induit un changement des modalités d’écriture, de lecture et finalement une évolution dans les modes de pensée (Goody 1979; Jacob 2014) et de formation des savoirs.
Les institutions directement impliquées dans la formation des savoirs, leur pérennisation ou leur transmission, ont toujours été des lieux d’innovation quant aux modalités de la production des connaissances. Que l’on pense, du côté des bibliothèques, aux différents systèmes de classement et de catégorisation, ou du côté des académies, à l’établissement de normes d’évaluation des connaissances, les institutions ont en effet joué un rôle important dans l’élaboration des modèles épistémologiques qui régissent les sciences aujourd’hui. C’est ce qu’a permis de montrer l’approche anthropologique de Christian Jacob (2014) lorsque celui-ci situe le développement de pratiques et de gestes caractéristiques de l’activité savante, au sein des institutions académiques (mais pas seulement). En tant que « lieu de savoir », l’université s’est naturellement confrontée aux effets induits par l’évolution des supports d’écriture et de lecture. Mais en a-t-elle été l’instigatrice ou le moteur ?
Face au nouvel environnement numérique, certaines institutions du savoir ont amorcé des adaptations conséquentes. Du côté des institutions para-académiques d’édition et de diffusion de la production scientifique, les éditeurs scientifiques, les librairies et les bibliothèques universitaires ont mis en route plusieurs chantiers dans le sens d’une plus grande accessibilité aux connaissances. Dans la continuité de l’informatisation des catalogues de bibliothèque, de la numérisation des imprimés ou encore de l’adoption de formats numériques standardisés, le mouvement de l’Open Access a pu se développer et gagner progressivement un terrain technologiquement plus favorable (Guédon 2014). Plus précisément, le terrain technologique s’est développé conjointement avec des pratiques juridiques plus propices à l’ouverture des contenus, selon les principes du copyleft déjà en cours dans d’autres communautés d’écriture. Les mouvements Open source ou Free Software, nés peu avant l’explosion de l’Internet, se sont rassemblés autour du principe de partage des codes sources informatiques. Afin de se prémunir des effets de clôtureLa langue anglaise propose le terme d’enclosure pour désigner l’établissement de barrières autour d’un bien, matériel ou informationnel. Utilisé notamment dans le contexte des communs, je reviendrai à cette notion dans le dernier chapitre.
de la propriété intellectuelle et de ses restrictions d’accès et de partage de ces écritures programmatiques, ces communautés de développeurs ont su inverser le principe du copyright en associant aux sources une licence d’utilisation particulière, imposant à la fois le partage et la viralité de la licence. Ainsi, en jouant du droit de la propriété intellectuelle, ces licences en inversent le sens et la nature, transformant le copyright, c’est-à-dire le droit de reproduction, en un copyleft, c’est-à-dire la cession de ce droit de copie à tout à chacun à la seule condition de propager cette cession aux nouvelles copies. Les licences Creative Commons ont appliqué ce principe du copyleft aux contenus culturels, libérant ainsi tout un pan de la production culturelle à partir des années 2000. Il est important de noter ainsi que l’émergence du Libre Accès dans la communauté scientifique hérite d’un ensemble de valeurs culturelles apparues avec le développement de l’Internet et du Web. Il ne faut pas s’y tromper, ce n’est pas fondamentalement le numérique qui a permis l’apparition de ces valeurs, mais bien des communautés de pratiques engagées dans le développement informatique, puis dans l’établissement des normes et des standards du web et de l’internet, et finalement dans la libre circulation des contenus culturels. Si la technique n’est pas déterministe ici, il faut noter l’aspect récursif de ces valeurs, d’abord appliquées aux logiciels informatiques et à leurs infrastructures, puis aux contenus culturels qui y circulent. L’application de l’ouverture et du partage à la production académique n’en est que la suite logique, dans une communauté scientifique traversée, on le verra, par des courants et des pratiques souvent antagonistes.
En France, la plateforme HAL, lancée par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) du CNRS, a pour objectif le dépôt et la diffusion d’articles, de thèses et plus largement de documents liés à la recherche. Ce type de plateformes, destinées au partage des connaissances et associées aux injonctions émises par les organismes subventionnaires pour contraindre ou encourager – selon les points de vue – les chercheurs dont les projets sont subventionnés à publier leurs résultats et leurs données en libre accès, ont certainement amélioré l’accès et la diffusion. Cependant, de telles mesures à l’initiative d’institutions publiques restent de l’ordre de l’ajustement au regard des potentialités réelles de l’environnement numérique d’une part, et des pratiques émergentes de la communauté académique d’autre part. C’est le constat que faisaient également Pierre Mounier et Marin Dacos en décrivant le secteur de l’« édition numérique » : « Dans l’édition numérique, le réseau n’intervient qu’en fin de chaîne, au niveau de la diffusion des contenus. Il n’y est utilisé que marginalement et dans un seul sens : afin de les faire parvenir à ses lecteurs. » (Mounier et Dacos 2011, sur Hypothesis)
Ce constat est partagé dans des termes similaires par Joanna Drucker, citée par Janneke AdemaPrécédant la citation de Drucker, Janneke Adema commente ainsi la persistance des pratiques de l’imprimé dans l’édition scientifique : “One of the ongoing issues in this respect is how the design of online scholarship continues to mirror and reproduce print-based forms of communication instead of experimenting with the possibilities that the digital medium offers us.” Cet extrait est tiré d’une conversation sur Hypothesis en marge du texte introductif à une édition numérique particulièrement inspirante d’un ouvrage collectif expérimental. (voir sur Hypothesis)
:
In spite of the networked condition of textual production, the design of digital platforms for daily use has hardly begun to accommodate the imaginative possibilities of constellationary composition, graphic interpretation, and diagrammatic writing… Very few acts of composition are diagrammatic, constellationary, or associative. Fewer still are visual or spatial. The predominant modes of composition in digital displays have remained quite linear, even when they have combinatoric or modular underpinnings (Drucker 2014, 183).
La vision de Drucker anticipant les « possibilités imaginatives » pour des « compositions diagrammatiques, constellationnaires ou associatives » n’est pas sans lien avec les principes du Knowledge Design de Jeffrey Schnapp grâce auxquels il envisage des dispositifs de représentation des connaissances susceptibles de « tisser ensemble des donnéesSchnapp utilise le terme “forms of evidence”, associant à la donnée la notion de preuve ou d’unité de preuve.
visuelles et verbales (et – pourquoi pas – acoustiques, tactiles, et olfactives) » (Schnapp 2013, 5‑6). Ces intuitions font désormais l’objet de multiples expérimentations éditoriales et théorisations (Zacklad 2019), mais l’institution n’a pas encore été en mesure d’absorber les formes les plus innovantes d’édition numérique.
Finalement, les acteurs de l’édition et de la diffusion ont en quelque sorte mécanisé et automatisé des services qui existaient déjà. La normalisation des contenus, l’indexation de document, et par conséquent la recherche d’information, se sont améliorées, conjointement à leur accès et leur ouverture. Les acteurs se sont ainsi ajustés au nouvel espace de diffusion qu’est le web, assurant la mission qui leur incombait déjà, mais sans investir le numérique comme une véritable révolution de l’écriture. Outre les expérimentations éditoriales de certains milieux académiques, les années 2000 et 2010 ont pourtant témoigné d’une extraordinaire explosion des formes d’écriture et de communication, dont on a vu l’impact sur le plan social, politique, économique, et ce tant sur un plan horizontal – touchant le monde entier – que sur un plan vertical – touchant toute la société.
Désintermédiation des institutions et nouveaux acteurs
De nouveaux acteurs se sont ainsi progressivement institués dans le champ de la production, de la légitimation et de la diffusion de contenus, en proposant des outils et appareils numériques d’écriture, d’édition et de publication susceptibles de supplanter les canaux institutionnels. Ces acteurs viennent directement du secteur privé et plus particulièrement de la Silicon Valley, dominante sur le marché des OSOperating System, ou système d’exploitation « qui dirige l’utilisation des ressources d’un ordinateur par des logiciels applicatifs » (Wikipédia.fr).
, des logiciels et des algorithmes (Mounier et Dacos 2011; Vitali-Rosati 2016). Or, si les GAFAMDu nom des cinq principales entreprises Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
ont pu fournir au monde un écosystème d’écriture, d’édition, de publication et de communication, c’est qu’elles ont pleinement exploité les potentialités du numérique, c’est-à-dire tout à la fois celles du processeur comme technologie de calcul, celles du réseau comme technologie de communication, et celles du web comme technologie de publication.
À titre d’exemple, un service comme Google Documents témoigne de l’extrême agilité de ces sociétés pour continuellement améliorer leurs logiciels au plan ergonomique comme au plan systémique, avec une intégration extrêmement poussée techniquement dans l’écosystème numérique, qu’ils ont par ailleurs largement contribué à façonner. Google Documents a ainsi été un des premiers éditeurs de texte à fonctionner en édition collaborative synchrone, à proposer le partage de documents, à intégrer un moteur de recherche permettant de récupérer du contenu issu du web, à proposer un service de suivi de modifications et de commentaires avec notifications par courriel en temps réel, ou encore la publication continue vers des urls pérennes. La technicité qui entoure le document exploite tout à la fois le calcul, la communication et la publication, et l’implante dans un écosystème d’« édition en réseau ». Elle concrétise finalement ce qu’anticipaient Mounier et Dacos (2011) avec « des formes d’écriture, de coopération et de construction du savoir qui sont susceptibles de dépasser certaines des apories auxquelles mènent les formes traditionnelles de rapport au savoir ».
Hybridation des pratiques et rhétorique « barbare »
Or le monde académique a largement adopté cet écosystème dans ses pratiques scientifiques, que ce soit pour la recherche d’information et de contenus savants (Google Search, Google Scholar), la consultation de ces contenus (tablettes sous IOS, Android, Windows, navigateurs Chrome, Safari), mais aussi pour la publication et la diffusion des travaux (réseaux sociaux spécialisés ResearchGate, Academia), ainsi que pour la communication (Gmail, Facebook) et la collaboration (Google Drive, Microsoft Office 360).
Les réseaux sociaux sont ainsi utilisés par les chercheurs pour communiquer sur leurs travaux, partager leur veille scientifique, commenter et annoter les travaux de pairs, voire pour nourrir quelques controverses. C’est aussi un moyen d’élargir son cercle d’échange et de s’ouvrir à des communautés non-académiquesComme l’initiative de @EnDirectDuLabo sur Twitter.
. Les blogues de chercheurs se sont également multipliés dans une démarche de publication continue des travaux et des réflexions d’un chercheur ou d’une équipe. Cette mise en circulation génère des cercles particulièrement vertueux tant pour la communication, la visibilité que pour la recherche elle-même (Blanchard 2010). Cette pratique s’est d’ailleurs institutionnalisée en sciences humaines avec la plateforme HypothèsesBasée sur le moteur de blogues Wordpress, Hypothèses.org est lancée en 2009 par OpenEditions.
qui accueille essentiellement des carnets de recherche, des carnets de projets, des blogues de laboratoire, de chercheurs, de séminaire, et auxquels la BNF attribue un numéro ISBNEn tant que numéro d’identification unique, l’ISBN est un marqueur important de l’institutionnalisation d’un document, dans la mesure où il est délivré par une institution dont l’autorité vient légitimer l’entrée du document dans l’écosystème professionnel des publications
. La correspondance par courriel et sur les listes de diffusions est un autre exemple d’écrits parfaitement intégrés au travail de recherche, mais relevant malgré tout d’une hybridation des pratiques des chercheurs, dont une large production échappe ainsi à l’institution. En effet, ces écrits ne constituent pas aux yeux de l’institution des connaissances certifiées, c’est-à-dire issues d’un processus de production soumis au jugement des pairs. Parce que ces écrits ne relèvent pas d’un format éditorial institutionnalisé, comme l’article scientifique ou la monographie, l’institution n’est pas en mesure de les intégrer dans ses protocoles d’évaluation.
On pourrait penser que la première victime de ce système est la conversation scientifique. Pourtant c’est bien l’institution qui en pâtit le plus puisque la conversation, elle, se porte bien, mais hors de la sphère institutionnelle. Qu’une partie de la communication existe de façon plus informelle est en soi bénéfique. Le problème survient lorsque d’un côté les pratiques alternatives se généralisent et que de l’autre la pratique institutionnelle perd en légitimité (Ertzscheid 2016; Vitali-Rosati 2015). Finalement, les lieux et les formes de la controverse et du consensus échappent de plus en plus à cette institution.
On peut relever un exemple relativement emblématique de ces conversations dans la discussion intitulée « Projet “carrière” »Voir en annexe les données de la discussion (CSV).
qui s’est tenue sur la « Liste francophone de discussion autour des Digital Humanities (DH) », rapidement relayée et développée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et qui donna lieu, dans le temps de la discussion, à plusieurs posts de blogues. La conversation est partie d’une requête anodine d’un étudiant à la recherche d’un emploi, s’interrogeant sur la pertinence de son profil auprès de la communauté des humanités numériques. Sa question a mobilisé trente-six intervenants et un échange de soixante-huit messages autour d’une problématique bien plus large que la question initiale. La vigueur des discussions témoigne du contexte de questionnement que traverse le champ des humanités numériques, champ encore en gestation sur le plan institutionnel, et qui ne cesse de travailler son autocritique, comme le montrent plusieurs auteurs d’articles (Citton 2015; Granjon et Magis 2016) et de blogues (Ruiz 2019; Bertrand 2019a, 2019b).
Pour certains, ces écrits relèvent d’un registre de discours qui ne peut être considéré comme de la connaissance scientifique. Comme nous le verrons dans la prochaine partie, les éditeurs et éditrices de revues insistent pour distinguer les textes dits scientifiques des débats pourtant parfois très spécialisés qui discutent ces textes lors du processus éditorial. En quoi ces discussions ne sont-elles pas également scientifiques ?
Je propose une autre façon d’aborder cette question : les écrits conversationnels, dont le registre de discours est en effet différent, peuvent-ils participer d’une autre science ? N’y aurait-il pas ici un paradigme à changer ?
La question du registre peut être rapprochée de la question de la vulgarisation, mode de communication scientifique tout à fait essentiel dans la relation sciences & sociétés. Le Web, du fait de son extrême accessibilité, avant que les portails, les pay-walls ou les DRMLes DRM (Digital Rights Management) ou la gestion des droits numériques sont un ensemble de dispositifs de contrôle et de restriction des accès à des contenus numériques.
ne prolifèrent, a d’ailleurs pu être considéré dans ses premières années comme un espace de publication pour une édition amateur et de vulgarisation. La remarque n’est peut-être pas tout à fait fausse, tant les années pionnières du Web ont certainement renoué avec l’esprit des curieux et la figure de l’amateur. Pour autant, ce que ses détracteurs n’avaient pas encore compris, c’est que ces amateurs fourbissaient alors leurs armes pour devenir bientôt les nouveaux acteurs de l’édition (ou du commerce). Contrairement au lieu commun du début des années 2000, le Web n’était pas une machine de désintermédiation des éditeurs traditionnels, quel que soit le champ culturel. Au contraire, un formidable mouvement de réintermédiation était déjà en cours, court-circuitant il est vrai les acteurs de l’analogique, mais redistribuant en fait les cartes de l’économie, de la recommandation et de l’autorité. Avec toute la fascination et la sidération qu’ont laissées derrière eux les Huns dans la mémoire collective, Alessandro Baricco consacrait en 2006 une chronique dans La Repubblica, publiée dans un ouvrage intitulé Les barbares. Essai sur la mutation – traduit en 2014, où il tentait, en observateur impuissant, de saisir le basculement de l’ancien monde auquel il appartenait (Baricco 2014).
Car ces nouveaux acteurs ont su en effet s’emparer plus vite que les autres de l’espace numérique. En en maîtrisant le code, le protocole et les langages, ils ont su installer de nouveaux paradigmes qui définissent encore aujourd’hui certaines bases de l’écosystème numérique de publication dans lequel on vit. Que ces bases soient actuellement bousculées par des forces économiques et industrielles telles que les GAFAM, qui ont pu d’ailleurs un temps œuvrer à la montée du Web dans ses débuts, il n’en demeure pas moins que l’écosystème du savoir et des connaissances a radicalement changé de nature, y compris dans ses langages et ses protocoles. Aussi, si le registre de la conversation peut heurter les tenants de la scientificité liée au registre de l’article par exemple, il est peut-être nécessaire d’envisager que c’est la langue même du savoir qui s’est déplacée, jusqu’à s’installer pourquoi pas dans la pratique conversationnelle. L’hypothèse est radicale, bien entendu, mais la fin des thèses écrites en latin au 19ème siècle n’avait-elle pas suscité également la confrontation classique entre conservatisme et réformisme ? La pensée théorique en avait-elle pâti, ou s’était-elle au contraire libérée ?
J’aborderai la question de la pensée et de son support par la notion de milieu, qui définit sans doute le mieux l’écosystème numérique, notamment des connaissances. Des registres de discours qui ont émergé avec ce milieu, certains ont pu parler d’« écrits d’écran » (Souchier 1996), d’« écrits de réseaux » (Davallon et al., s. d.; Cotte 2004), d’autres de « rhétorique dispositive » (Merzeau 2016). Si le milieu numérique est capable de supporter l’ancien paradigme régissant l’édition scientifique traditionnelle, il est aussi plausible que ce même milieu soit susceptible de porter de nouvelles formes éditoriales reprenant l’énonciation de ses propres registres et rhétoriques, et inspirant finalement une communication scientifique inédite.
Les artefacts académiques contemporains : du déphasage institutionnel au déphasage éditorial
La transformation radicale du support d’écriture et de lecture a bouleversé tant les processus que les artefacts (Jacob 2014), au cœur d’un modèle épistémologique ancien remontant aux fondements de la science moderne qui se met en place au 17ème et au 18ème siècle.
Roger Chartier rappelle comment les préceptes du paradigme de cette « science moderne » s’ancrent dans la culture naissante de l’imprimé à travers une série de conventions collectivement partagées, constitutives d’un modèle éditorial.
« En établissant, non sans conflits ni divergences, des règles partagées, mobilisables pour repérer les textes corrompus et les faux savoirs, les gens du livre tentent de répondre au discrédit durablement attaché tant aux livres imprimés qu’à ceux qui les publient.
L’attention portée aux pratiques collectives qui donnent autorité à l’imprimé inscrit l’histoire de la « print culture » dans le paradigme qui a régi la nouvelle histoire des sciences. Celle-ci, comme on le sait, privilégie trois objets : les négociations qui fixent les conditions de réplication des expériences, permettant ainsi de comparer ou cumuler leurs résultats ; les conventions qui définissent le crédit que l’on peut attribuer, ou refuser, à la certification des découvertes en fonction de la condition des témoins et de leur compétence à dire le vrai ; les controverses qui font s’affronter non seulement des théories antagonistes, mais plus encore des conceptions opposées quant aux conditions sociales et épistémologiques qui doivent gouverner la production des énoncés scientifiques sur le monde naturel. Ce modèle d’intelligibilité rend compte avec pertinence des multiples transactions qui donnent, ou tentent de donner autorité à tous les textes et à tous les livres qui proposent des discours inscrits dans le régime du vrai et du faux. » (Chartier 2016)
Le tournant numérique a favorisé dans le même temps l’émergence et la diversification de pratiques d’écriture et de publication. Il y a donc un déphasage grandissant entre les artefacts de communication académique et la réalité des pratiques de communication. Ce déphasage se manifeste sur deux plans simultanés, l’un institutionnel, l’autre éditorial.
Un déphasage institutionnel
Des échanges épistolaires aux premiers périodiques, la mécanisation de la communication scientifique a été contingente de sa marchandisation (Guédon et Loute 2017). Les modalités juridiques et économiques de la publication savante ont ainsi toujours négocié entre les idéaux de transmission et de partage qui caractérisaient la communauté savante de la République des lettres, et une nécessaire rémunération des métiers de l’édition et de l’imprimé.
Accompagnant une marchandisation croissante du monde au cours du 20ème siècle, l’édition scientifique prend véritablement un tournant avec l’adoption par les institutions universitaires du Science Citation Index d’Eugene Garfield (1955, 2007). En rapportant l’essentiel de l’évaluation de la recherche à une évaluation quantitative des revues, Jean-Claude Guédon (2017) associe ce tournant à une dérive institutionnelle de la communication scientifique, progressivement soumise à des contraintes et à des motivations de natures diverses, mais surtout de plus en plus éloignées de sa mission première, l’élévation des connaissances.
D’un côté, les grands éditeurs qui détiennent notamment les core journals ont rapidement saisi l’enjeu économique d’une telle hiérarchisation des revues, surtout lorsque celle-ci est légitimée par les institutions. Les éditeurs vont alors redoubler d’efforts pour propriétariser les connaissances. Paradoxalement, alors même que l’essor de l’Internet et du web s’accompagne d’un vent nouveau, porteur des valeurs d’ouverture et de partage, le numérique va permettre d’accentuer cette mainmise des éditeurs sur les connaissances, à travers « une révolution silencieuse du cadre légal » associé aux revues (Guédon et Loute 2017). Les éditeurs font définitivement entrer les publications scientifiques dans l’âge de l’accès (Rifkin et Saint-Upéry 2000) en introduisant la licence comme principale modalité juridique et économique de transaction avec les bibliothèques universitaires. Les Big Deals qui lient contractuellement les éditeurs aux bibliothèques ont véritablement privé celles-ci de leur catalogue, n’en maîtrisant plus ni le contenu ni les conditions d’usage.
Cette situation est aujourd’hui largement décriée, comme en témoignent les désengagements souvent médiatisés de bibliothèques universitaires emblématiques pour dénoncer les accords passés. On peut citer à titre d’exemple les annulations d’abonnements de périodiques Springer et Taylor and Francis par l’Université de Montréal à l’été 2019 (Veillette-Péclet 2019b, 2019c, 2019a), ou les initiatives en faveur de l’Open Access, comme celle de l’Université de Liège qui a décidé en 2015 de tenir compte uniquement des publications diffusées en libre accès pour les évaluations de ses professeurs (Dumont 2015), ou encore simplement les pratiques des chercheurs pour libérer certaines publications.
De l’autre côté, c’est l’évaluation de la recherche elle-même qui a été bouleversée avec la marchandisation de l’édition scientifique. Avec l’injonction faite aux chercheurs et aux laboratoires de publier dans les core journals, identifiés par Garfield sur des bases aujourd’hui critiquéesL’universalisme scientifique, sur lequel Garfield légitime la hiérarchisation des revues, repose sur « une sorte de convergence tacite universelle entre scientifiques où s’exprimerait l’ensemble des questions importantes en science à un moment de son histoire » (Guédon et Loute 2017), principe séduisant mais qui ne résiste pas à l’épreuve de l’influence des plus puissants.
, l’institution a directement indexé les carrières personnelles et les financements de recherche sur le rang des revues dans lesquelles ces recherches sont publiées, et non sur la qualité des recherches. À ce propos, je présenterai dans le second chapitre le résultat des entretiens menés auprès d’éditeurs et éditrices de revues. Ces entretiens illustrent notamment le fait que l’évaluation par les pairs est un concept très relatif d’une revue à une autre. Cela suggère qu’une bonne part de la fonction de légitimation scientifique se joue ailleurs que dans l’évaluation pourtant censée garantir une certaine rigueur et scientificité.
C’est bien l’institution qui est en cause, puisqu’elle continue de légitimer et de soutenir un modèle pervers basé sur un leitmotiv : “publish or perish” et sur une métrique : l’impact factor, devenu de fait l’alpha et l’oméga de tout chercheur. Dans ce système, la fonction des revues revient à un simple vecteur de capital symbolique (Larivière, Haustein, et Mongeon 2015) au service d’une évaluation quantitative de la recherche.
Au-delà du régime d’autorité institutionnalisé, le déphasage institutionnel s’illustre également dans sa démission vis-à-vis de la chaîne de production de l’écrit.
Les travaux scientifiques sur le document numérique (Pédauque 2011; Broudoux et al. 2007), sur la communication scientifique (Beaudry 2010, 2011; Oswald 2015) et ses évolutions (Bourassa, Haute, et Rouffineau 2018), ou encore sur les nouvelles chaines de publications (Fauchié et Parisot 2018; Kembellec 2017; Mourat 2018) – TEI, markdown, R-notebook, python-notebook – ne manquent pas, et se sont encore intensifiés avec le champ des humanités numériques.
Pourtant, malgré la diversité des initiatives et la multiplicité des outils à disposition, force est de constater que l’éditeur de texte Microsoft Word demeure l’outil majoritaire dans les pratiques d’écriture des chercheurs et des étudiants, en particulier dans les sciences humaines (Kembellec 2013). De surcroît, de l’administration à l’enseignement, en passant par la prise de note des étudiants ou à l’évaluation de la recherche, tous les aspects de la vie universitaire sont concernés par cette situation de quasi-monopole.
On ne peut que s’étonner d’un tel paradoxe où une institution publique, experte dans l’écrit, a pour principal support d’écriture un outil grand public, dont la conception, la réalisation et la maintenance sont l’œuvre d’une entreprise commerciale, qui plus est un des cinq GAFAM.
Ce paradoxe nous révèle en fait qu’en abandonnant (aux GAFAM) la réflexion sur les supports et les techniques de l’écriture et de la lecture, au moment même où les pratiques des chercheurs se transforment et s’adaptent au nouvel écosystème, l’institution s’est écartée de sa mission première, à savoir prendre autant soin de l’écrit que de la chaîne de production de l’écrit.
Pour autant, l’institution académique n’est pas complètement démissionnaire, et plusieurs initiatives sont engagées dans l’évolution de l’édition scientifique, ou plus largement dans la construction de l’écosystème numérique qui héberge les savoirs et leur circulation. Des chercheurs ou des laboratoires sont souvent parties prenantes, aux côtés de l’industrie, des instances décisionnaires sur l’innovation et l’évolution des protocoles et des formats qui régissent Internet et le webEn premier lieu le W3C qui définit les standards du web, véritable entreprise de normalisation de l’écrit, de ses formats et de ses langages.
. Il n’est pas inintéressant de noter à ce stade que la nature des échanges et des décisions dépasse la simple question technique et s’engage en fait sur les terrains politique, éthique, sociétal parfois, confirmant la dimension écologique du milieu numérique qu’ils travaillent à structurer.
Cependant, malgré ces initiatives, qu’elles soient expérimentales ou en voie d’institutionnalisation, les retards accumulés en matière de production et d’édition laissent penser que dans cette phase de transition où les modèles papier et numérique cohabitent et s’hybrident, l’inertie institutionnelle empêche les différents acteurs de prendre la mesure du changement de paradigme déjà à l’œuvre dans l’édition. Par méconnaissance, méfiance ou résistance active, les processus de légitimation demeurent les mêmes, ne permettant de faire évoluer les processus et les formats traditionnels de communication scientifique, quand bien même ceux-là ralentissent la production et la circulation des idées. Plus problématique encore qu’un simple ralentissement, en délaissant des pratiques d’écriture relevant de la communication scientifique, l’Université accentue une crise d’autorité déjà bien réelle. La théorie de l’éditorialisation de Marcello Vitali-Rosati (2018a) nous est précieuse pour comprendre la nature de l’autorité dans un monde façonné par le numérique. Les structures spatiales se sont transformées, et avec elles les structures de l’autorité. Sans rendre complètement caducs les principes sur lesquels reposent l’activité et la légitimité scientifique, ces transformations engagent une évolution radicale de la production des connaissances et de ses mécanismes de légitimation. Dans sa capacité à adopter ces nouveaux mécanismes, se joue en effet la pérennité des institutions de savoir.
Depuis la thèse d’Éric Guichard rendant compte en 2001 des résistances actives de l’institution – l’ENS – à un renouvellement de l’« ordre des discours » (Chartier 2014), de nombreuses réflexions et initiatives poussent de l’intérieur les universités dans le sens d’une évolution nécessaire. C’est d’ailleurs l’un des objectifs motivant explicitement la constitution du champ des humanités numériques que de repenser les modalités de l’enseignement et de la recherche (Allouche 2014; Lebrun 2015). Pourtant, force est de constater que l’écriture des chercheurs elle-même, tout comme l’édition et la publication de leurs écrits, sont restées quelque peu figées dans des formats et des pratiques qui ne sont plus en adéquation avec les nouvelles pratiques d’écriture et de communication que l’on peut observer par ailleurs.
Finalement, le fait que les lieux et les formes de la controverse et du consensus échappent de plus en plus à cette institution nous questionne sur la nature et les lieux mêmes du savoir. L’université peut-elle élargir son champ de validation et de légitimation ? Peut-on envisager qu’elle se nourrisse et contribue à des formes alternatives de savoir ? Entre le savoir autorisé et stabilisé dans les formes traditionnelles de l’édition scientifique, et les échanges non-institutionnalisés de communication et de collaboration propres à l’environnement numérique, on peut à juste titre se demander si, d’une plus grande fluidité dans les échanges, ne résultent pas une hybridation et une diversité susceptibles de mieux adresser la complexité du monde.
Un déphasage éditorial
Malgré la multiplication et l’hybridation des pratiques des chercheurs, les circuits de légitimation de l’institution académique reposent encore principalement sur les formes les plus traditionnelles de la publication et de la communication, à savoir : la monographie, la communication de colloque et de conférence, et bien entendu l’article publié dans une revue scientifique.
Nous aurons l’occasion de mesurer les conséquences de ces paradoxes éditoriaux dans le chapitre suivant de la thèse, qui rend compte d’une enquête menée pendant deux ans auprès d’un échantillon de revues savantes. Lors de cette enquête et de nos entretiens avec les directeur·rice·s de revues savantes, l’une d’elles assurait demander à ses auteurs de ne pas mettre en ligne les versions preprint de leur texte sur leur site ou sur les espaces institutionnels prévus à cet effet, qu’ils soient universitaires comme Papyrus pour l’Université de Montréal par exemple, ou nationaux comme HAL centralisant l’ensemble du dépôt institutionnel en France. Elle justifiait cette demande par le fait que les consultations du preprint pénaliseraient les statistiques de consultation sur Érudit, la plateforme de diffusion officielle, et mettraient en péril l’évaluation de la revue auprès de ses financeurs, le FRQSC et le CRSH, deux organismes pourtant promoteurs du Libre Accès depuis plusieurs années.
– M.T. : Une chose aussi qu’on va refuser c’est que les auteurs rendent disponibles leurs pdf sur Academia par exemple, parce que nous il faut qu’on récolte les clics dans Érudit pour les demandes de bourse, donc il faut une centralisation de la lecture qui soit faite sur Érudit, mais en même temps on fournit des pdfs, donc ça c’est un peu difficile à contrôler.
– M.F. : Et ça voudrait dire qu’il faudrait quelqu’un qui prenne la peine de surveiller tous les profils Academia de tous nos auteurs pour voir la diffusion de tous nos auteurs, c’est trop compliqué.Entretien avec Marion Frogier, directrice de la revue Intermédialités et Maude Trottier, secrétaire de rédaction, Montréal, 2 mai 2019
.
Ce paradoxe est intéressant à plusieurs niveaux. D’une part, il montre que l’injonction institutionnelle peut s’avérer à double tranchant et desservir l’objectif initial d’ouverture des connaissances. D’autre part, il montre la méconnaissance des éditeurs sur les flux de circulation, qui indiquent que plus un contenu circule, plus il circule , c’est-à-dire que plus un texte est lu et cité, plus ses différents artefacts seront également lus et cités, notamment sa version “officielle”. Cette méfiance face à des circulations non maîtrisées révèle enfin qu’une circulation libre et étendue de la connaissance n’est pas nécessairement une fin en soi pour les éditeursPour répondre aux inquiétudes concernant la diffusion non institutionnelle, des outils de mesures alternatifs ont émergé, comme les Altmetrics. Si les organismes financeurs ne leur accordent pas encore la même place que les statistiques de consultation du diffuseur officiel, il faut noter que les formulaires de demande de financement du FRQSC et du CRSH permettent aujourd’hui de rendre compte d’autres formes d’impact de la revue, comme les statistiques du site de la revue, ou ses données altmetrics si elle en dispose.
. Ils restent en effet attachés à une diffusion institutionnelle, mesurée statistiquement et supposée être seule porteuse de légitimité pour la revue elle-même.
La même éditrice déclarait à ce propos regretter la diffusion papier au motif qu’elle lui permettait de connaître précisément son lectorat à travers les commandes et les abonnements. Ces données permettaient en effet de connaitre la répartition géographique des lecteurs, mais surtout, selon ses dires, de savoir quelles institutions étaient abonnées.
– M.F. : Surtout qu’à ce moment-là je pense que la FRQ obligeait les revues à se numériser entièrement, et qu’on ait commencé à voir l’impact de cette transformation sur nos lecteurs. À la fois il y a eu de la contrainte, et à la fois il y avait cette découverte, cet espoir que la numérisation allait nous ouvrir un champ incroyable de nouveaux lecteurs. La seule chose c’est que c’est arrivé à un moment où la revue commençait à se faire bien connaître avec des tas d’abonnements, individuels, avec des bibliothèques, partout dans le monde, Philippe avait fait un travail extraordinaire là-dessus, il y avait beaucoup de bibliothèques et d’universités américaines, européennes qui avaient répondu à nos démarches, et ça, dans le passage au numérique, à Érudit, c’est tout tombé à l’eau. Parce qu’Érudit ne fait que des paniers d’abonnements et ne gère pas des abonnements de revues, d’institutions directement. Donc à la fois on a eu beaucoup plus de lecteurs, mais en termes d’institutions on a eu une perte. On est plus qu’avec Érudit maintenant, ou avec quelques rares bibliothèques qui continuent à nous suivre. Et cette économie-là nous est rentrée dans le corps aussi, parce qu’on voit maintenant qu’on est reliés à des logiques qui nous dépassent, en termes d’abonnement, de coût, de rayonnement, tout passe par Érudit, on s’est relié dans le rayonnement d’Érudit elle-même. On a perdu la maîtrise de ça tout en ayant gagné beaucoup de lecteurs. Au niveau de notre rayonnement purement institutionnel on y a perdu.Entretien avec Marion Frogier, directrice de la revue Intermédialités et Maude Trottier, secrétaire de rédaction, Montréal, 2 mai 2019
Ainsi, le prestige de telle ou telle bibliothèque nord-américaine ou de tel institut européen s’abonnant à la revue constitue pour ses éditeurs une « assise institutionnelle » légitimante pour la revue. C’est cette assise institutionnelle qu’ont perdue les revues avec le passage à une diffusion numérique sur Érudit. En effet, l’accès institutionnel aux revues se faisant désormais à travers des bouquets de périodiques, les diffuseurs ou les éditeurs ne sont pas en mesure de distinguer l’attachement intellectuel d’une institution pour tel ou tel titre.
On peut reconnaître à cet endroit une certaine perte de valeur symbolique. Cependant, ce constat doit être relativisé. Dans le modèle papier dont l’abonnement était maîtrisé par l’éditeur, il n’est pas évident qu’une fois achetée et disposée dans une bibliothèque, aussi prestigieuse soit-elle, la revue soit effectivement consultée de manière certaine et soutenue. Les bibliothèques n’auront d’ailleurs pas nécessairement de données de consultation, et ne seront pas supposées les rendre publiques en vertu de la protection des données personnelles de leurs usagers. Par ailleurs, il faut noter que la diffusion numérique, si elle a changé les modes de lecture et de consultation des revues, par exemple en favorisant un accès plus granulaire à l’article aux dépens du dossier ou du numéro, a également permis un élargissement très conséquent du lectorat tant sur le plan sociologique, géographique que temporel. En effet, l’indexation des articles par les plateformes grand public de recherche comme Google les a fait sortir du cadre universitaire, leur a ouvert des zones géographiques qui n’avaient pas ou peu accès aux versions papiers, ou encore leur a donné une nouvelle visibilité dans le temps long, selon le principe de la longue traine (Anderson 2004). Tout cela laisse penser que la diffusion numérique assure sa fonction de circulation plus finement et efficacement que ce qu’une diffusion papier le permet.
Les processus institutionnels de circulation et de légitimation sont ainsi déterminés par les préceptes techniques, juridiques et économiques des chaînes de production de l’ère pré-numérique. En effet les maisons d’édition perpétuent des pratiques et des savoirs fondés sur les paradigmes du papier et de l’imprimé, ignorant la nature même du texte numérique et les potentialités de son support.
Un exemple de ce déphasage réside dans le dossier de revue, qui continue d’être la forme éditoriale majoritaire dans les revues scientifiques. Ils jalonnent ainsi la vie éditoriale des revues, naissant soit d’un colloque dont les organisateurs souhaitent rendre compte des communications, soit d’une démarche exploratoire de la part d’un chercheur pour avancer sur une question ou pour dresser un état de l’art d’un champ, soit encore de la part des rédacteurs de la revue qui souhaitent pousser en avant une problématique. Pourtant, cette pratique de production ne correspond plus aux pratiques de lecture, comme le constatent l’ensemble des acteurs de l’édition scientifique. En effet, la publication numérique des revues a contribué à l’éclatement de l’unité éditoriale qu’offrait le numéro en rassemblant une série d’articles dans un imprimé papier. Pour les éditeurs, le numéro, présenté par un sommaire et une introduction, inscrit ces derniers dans une intention théorique nécessaire, établit un parcours de lecture justifiant l’ordre séquentiel de présentation des articles, et assure ainsi une cohérence de discours. Or les statistiques de consultation des articles montrent que l’accès aux revues se fait désormais essentiellement par le biais des articles. La granularité éditoriale des revues en ligne a en effet été réduite à l’article, qui possède sa propre URL et ses propres métadonnées. Sa circulation est donc autonome, au contraire de l’article imprimé auquel on accédait en attrapant le numéro sur un rayonnage. Cela est d’autant plus vrai que le principal mode d’accès aux articles scientifiques se révèle être les moteurs de recherche.
Ce dernier aspect nous amène à un autre déphasage éditorial dans les pratiques des éditeurs. Illustrant leur méconnaissance de l’environnement numérique et de son “fonctionnement”, les éditeurs ne produisent que très peu de données, censées pourtant alimenter les moteurs de recherche et permettre une meilleure accessibilité de leurs articles. Je détaillerai cet aspect dans le second chapitre en abordant spécifiquement le manque de littératie et la déprise des éditeurs (au profit des diffuseurs) sur les modalités de diffusion et de circulation dans l’environnement numérique. De la production de contenus qualitatifs pour le lecteur humain à la production de données structurées qualitatives pour les robots et les algorithmes, il n’y a qu’un pas que les éditeurs se doivent de faire s’ils veulent conserver la légitimité dont ils se targuent. La production de l’autorité s’est en effet déplacée des mains de l’éditeur, caractérisé par sa fonction de sélection des contenus, à celle des algorithmes, caractérisés par une fonction de recommandation. Ce qui se joue dans ce déphasage éditorial n’est donc pas simplement l’aptitude à adresser des pratiques de lecture nouvelles, mais la perte d’autorité soit de légitimation des revues scientifiques face à d’autres contenus ou éditeurs dont la production aura su s’intégrer dans l’environnement.
Les éditeurs avec lesquels nous nous sommes entretenus sont très clairs à ce sujet : le numérique n’est perçu que dans sa fonction de diffusion des contenus, sans que ses mécanismes soient bien compris, encore moins assimilés. S’ils reconnaissent que le numérique a transformé les pratiques d’accès et de lecture, celui-ci n’aurait affecté ni le modèle ni le travail éditorial. Autrement dit, le numérique n’aurait eu aucun impact sur la production des revues. La directrice de la revue Études françaises, très attachée à l’idée « qu’écrire avec précision et élégance garantie notre rigueur scientifique », déclare ainsi :
– E.N. : « Mais je ne crois pas que la qualité du travail soit différente. C’est beaucoup rentré dans les mœurs. On a été amenés à réfléchir à la différence quand les organismes subventionnaires ont sous-entendu de toutes sortes de manières que le numérique demanderait moins de travail. Nous, on a toujours soutenu que non. La somme de travail d’un article papier ou sur Érudit, c’est la même somme. »
[…]
– E.N. : « Que les textes soient papiers ou distribués sur la plateforme Érudit, notre travail est le même. »Entretien avec Élisabeth Nardout-Lafarge, directrice de la revue Études françaises, et Jean-Benoît Cormier Landry, secrétaire de rédaction, Montréal, 7 mai 2019.
.
Ces propos sont révélateurs d’une certaine inertie, notamment institutionnelle, sur la production et les formes de la communication scientifique. Ainsi, la directrice d’Études françaises fait cette remarque très juste dans la suite de l’entretien :
– E.N. : « Cette somme de travail [le travail d’édition numérique et de diffusion d’Érudit] est reconnue par le FRQ, alors que la somme de travail sur le contenu n’est pas reconnue par le FRQ. Il reconnaît la somme de travail sur le contenant et fait comme si le contenu était gratuit à produire. En cinq ans on a eu le temps de s’habituer, ça a cessé d’être une découverte. »Entretien avec Élisabeth Nardout-Lafarge, directrice de la revue Études françaises, et Jean-Benoît Cormier Landry, secrétaire de rédaction, Montréal, 7 mai 2019.
.
Pourtant, nous l’avons déjà évoqué, les effets du support d’écriture et de lecture sur les modes de pensée ne sont plus à démontrer. Les quarante ou cinquante années d’écriture sur ordinateur personnel, et les 25 années d’écriture en réseau depuis l’avènement du web ont nécessairement eu un impact sur les modalités de rédaction et d’édition des auteurs et des éditeurs. Pourtant les formes éditoriales de l’article ou de l’ouvrage, c’est-à-dire les préceptes de production et de structuration des textes, sont supposées être restées les mêmes.
Et de fait, l’article, l’ouvrage, les actes, et même les colloques, ne sont pas pleinement passés au numérique. De manière très naturelle, les savoir-faire de l’édition papier ont continué à structurer les artefacts numériques de l’article ou de l’ouvrage.
Un déphasage épistémologique
Ces deux déphasages institutionnel et éditorial en amènent un troisième, d’ordre épistémologique. Il existe un lien étroit entre les processus 1) de formalisation des connaissances, matérialisée dans le modèle éditorial, 2) d’institutionnalisation, signifiée par la reconnaissance par l’institution, qui prend forme dans les critères de financement et d’évaluation de la recherche, et 3) de légitimation. Cette dernière résulte en grande partie des deux autres processus. Elle s’y inscrit sous différentes formes qui en retour ont valeur de prescription établissant alors un modèle épistémologique. L’adoption institutionnelle de ce modèle ne peut se faire sans une adoption communautaire. Malgré tout, une fois le modèle institutionnalisé, il est difficile pour la communauté de le faire évoluer dans une direction nouvelle. Les trois processus de formalisation, d’institutionnalisation et de légitimation se nourrissent les uns les autres renforçant la rigidité du modèle.
C’est le cas du protocole éditorial qui régit l’édition des articles scientifiques et qui assure aux yeux des auteurs et de l’institution les préceptes de la scientificité. À titre d’exemple, les consignes aux auteurs pour citer et référencer leurs écrits contraignent les auteurs dans un format de citation, que la communauté adopte moins pour sa praticité ou sa lisibilité que comme un signe d’appartenance à un cercle initié. Le tout vient à la fois légitimer le texte, dont l’article est correctement formaté, mais aussi la revue qui véhicule l’article et qui s’est portée garante de son formatage. Cette légitimation du texte et de la revue opère tant au sein de la communauté qu’aux yeux de l’institution.
Les travaux de Vittu sur la genèse et la formalisation du modèle éditorial de l’article dans le Journal des Savants à la fin du 17ème sont encore une fois éloquents à ce sujet. Vittu remarque ainsi à plusieurs reprises que les modalités éditoriales de l’article telles qu’elles se sont formalisées dans les premières années du Journal ont marqué l’activité savante, associant aux périodiques un modèle épistémologique propre, articulant une « rhétorique acceptée par la communauté savante » et un « appareil offrant la possibilité d’une lecture aléatoire » (Vittu 2001, 148).
Nous avons vu précédemmentVoir la partie De la correspondance à l’article : première formalisation.
comment les aspects éditoriaux tels que la formalisation du titre, la pagination, la façon de référencer les ouvrages, se sont développés conjointement avec des pratiques reflétant parfois des besoins de légitimation par une autorité savante, parfois des besoins d’indexation pour faire du Journal un véritable outil de recherche, ou encore des besoins institutionnels.
Dans le cas des titres de mémoires du Journal des Savants, leur normalisation a pu être motivée par l’aspect économique, tout en reflétant un certain jeu d’autorité entre les acteurs de l’édition savante. Par exemple, pour les extraits publiés dans le Journal, l’allongement et la formalisation des titres (entre 1665 et 1714 selon son étude), Vittu conclut:
« La présentation des titres des extraits, d’abord inspirée des habitudes propres aux échanges épistolaires entre lettrés informés évolua donc, d’une part, sous l’influence d’un souci bibliographique - celui qui animait à la même époque les Garnier, les Boulliau, les Clément, ou les Marchant-, et d’autre part selon la perspective commerciale qui conduisait les rédacteurs à insérer des avis suggérant aux libraires de leur confier leurs nouveautés. » (Vittu 2001, 139)
Mais la norme éditoriale introduira également dans le titre des indicateurs de légitimation, en formalisant la présence de garants du texte, autorisant celui-ci de fait.
« Des titres informatifs. Le premier élément de l’appareil éditorial est constitué par titres qui précèdent et présentent les extraits ou les mémoires. Pour ces derniers, la majeure partie du titre indique leur sujet: « expérience singulière », « machines rares et surprenantes », « expérience curieuse », « extrait d’une lettre », « invention », « description et figure ». Mais comme le montrent ces exemples empruntés aux premiers numéros du Journal de l’année 1682, il s’agit à la fois de désigner un sujet, et de mettre en valeur un texte en jouant sur la curiosité et sur l’attrait pour l’extraordinaire. Le plus souvent ce titre désigne aussi un auteur, qui en général est accompagné d’une garantie savante, comme le nom d’un intermédiaire établi dans la République des Lettres (« Extrait d’une lettre écrite (…) par M. l’Abbé Boisot à M. l’Abbé Nicaise… »), ou l’indication d’une position lettrée (« Extrait d’une lettre écrite (…) par M. Bohn Professeur en l’Université de Leipsich ») ; soit le recours à des garants ou à des autorités que nous avons déjà noté pour les intermédiaires composant le « bureau informel ». » (Vittu 2001, 137)
Il est intéressant de noter le rôle de ce « bureau informel » qui a été créé sous la pression du lectorat – la communauté de pairs se plaignant auprès du Chancelier ayant autorité sur le privilège d’une trop grande partialité de l’éditeur. Ce dernier s’est vu contraint, on l’a dit, de s’entourer d’un « bureau » indépendant pour légitimer la sélection éditoriale du Journal et les commentaires critiques publiés. On y décèle les prémisses de l’évaluation par les pairs qui deviendra un pilier de l’épistémologie des revues savantes, et de surcroît de la science moderne.
Considérée comme garante de scientificité, l’évaluation par les pairs s’est formalisée au travers des protocoles éditoriaux, et institutionnalisée en devenant pour les instances de financement un critère d’évaluation des revues, et pour les instances de recrutement un critère d’évaluation des chercheurs publiés. Lire et commenter les travaux de ses pairs demeure une activité importante du chercheur. Le principe de cette relecture des articles – ou revue pour reprendre le terme anglais, s’inscrit dans une tradition plus ancienne de la critiqueLe physicien Antoine Parent, créateur du périodique Recherches de physique et de mathématique (1703-1713), défend le principe du commentaire critique et s’en fait une spécialité. Peiffer et Vittu écrivent à son propos : « Pourtant, Parent trouve des mots très justes pour parler de la critique, qu’il juge nécessaire, c’est un “excellent antidote contre la negligence, et contre l’ignorance, et on peut même assurer que ny les mœurs, ny les sciences ne pourroient arriver à leur perfection sans son secours”. » (Peiffer et Vittu 2008, 295)
et de la collégialité. Ce n’est pas ce principe-là qui est remis en question dans le constat de déphasage éditorial et institutionnel. Il s’agit davantage de ses modalités prescrites par les instances décisionnelles (financement, recrutement) et appliquées par les instances éditoriales. En premier lieu, l’anonymat des auteurs et/ou des évaluateurs qui consiste à ne pas révéler l’identité des uns aux autres pendant le processus de relecture. Cette modalité est censée garantir l’objectivité et la liberté critique du commentateur. L’anonymat de l’auteur protégerait ainsi du biais de bienveillance ou de malveillance en permettant au relecteur, que l’on dit pour l’occasion aveugle, de ne se concentrer que sur la qualité scientifique intrinsèque du texte, indépendamment de son contexte de production et de l’identité des auteurs. Dans le cas d’une évaluation en double aveugle où l’auteur non plus ne connaît pas l’identité de ses relecteurs, ces derniers peuvent produire librement une critique sans craindre de pressions de la part des auteurs. On le comprend, cette cécité organisée installe entre les individus des garde-fous nécessaires lorsque les enjeux sont importants : financement d’un projet ou d’un poste. Mais qu’en est-il pour la publication d’un article ? Une première critique que l’on peut faire à cette modalité consiste à considérer que les acteurs ne sont aveugles que s’ils le veulent bien, puisqu’il est relativement aisé pour un évaluateur d’identifier sur la base d’un écrit un auteur appartenant logiquement à un réseau disciplinaire restreint. Une seconde critique concerne la liberté critique acquise par les évaluateurs. Sans en faire une généralité, l’anonymat devient parfois un refuge confortable pour des évaluations cassantes, non-argumentées, ou encore minimales. Les revues ne s’y trompent pas, puisque certaines tiennent à jour des listes de bons et de mauvais évaluateurs. Ainsi, en cherchant l’objectivité, l’anonymat aboutit à l’exact opposé de son objectif, à savoir la réintroduction d’un biais de subjectivité. Or la subjectivité de l’évaluateur isolé ou masqué n’est problématique que parce qu’elle n’a pas à se justifier aux yeux de son lecteur et de la communauté. En y réfléchissant de plus près, la relecture et le commentaire critique peuvent-ils être réellement objectifs dans les domaines des lettres et sciences humaines ? Les humanités ne reposent-elles pas sur des modèles conceptuels en mouvement permanent ? Car malgré toute la logique ou la systématicité de certains de ces modèles, il n’en demeure pas moins que les concepts, les catégories et les relations qui les définissent sont pétris de la subjectivité des sujets qui les ont forgés. La validation de ces modèles, c’est-à-dire leur adoption momentanée par une communauté, ne se fait pas par l’intervention objective de figure d’autorité, mais par les multiples conversations qui y ont lieu, dont la richesse prend sa source dans les subjectivités engagées.
Ainsi, la mise en œuvre d’une relecture collégiale dans des protocoles formalisés rigides a fini par vider la lecture critique de son sens, à savoir de la conversation subjective propre aux disciplines discursives.
Pourquoi alors ne pas s’appuyer davantage sur la conversation pour la validation éditoriale des textes en lettres et sciences humaines ? Le cloisonnement des individus acteurs du processus éditorial ne va-t-il pas à l’encontre d’une conversation éclairée ? De quelle collégialité parle-t-on si la parole est aveugle ?
Ce paradoxe s’est accentué avec l’avènement des pratiques d’écriture et de publication propre à la culture numérique. Le Web, en tant qu’espace de publication émancipé des instances de validation traditionnelles, a favorisé des usages spécifiques avec une temporalité de publication très courte, l’ouverture des contenus et la transparence de leurs modalités de publication. Ces caractéristiques se matérialisent dans les protocoles techniques qui régissent le Web et l’Internet. Associées au régime social apparues avec l’arrivée massive des réseaux sociaux, elles ont contribué à dessiner un tout autre régime d’autorité.
C’est là sans doute que le déphasage épistémologique de l’édition scientifique est le plus flagrant. Matérialisé notamment dans le protocole éditorial des revues, le régime d’autorité maintenu par l’édition savante ne répond plus aux attentes et aux usages d’une communauté savante qui a largement investi l’écosystème numérique.
Au terme de ces analyses, le terme de déphasage me semble particulièrement pertinent pour décrire la situation des revues. Certes, il constate une fissure en mettant à jour un décalage entre deux réalités, mais ce faisant, il dévoile aussi la direction à prendre pour combler la faille. Les pratiques émergentes propres à la culture numérique ne montrent-elles pas la voie pour rompre avec l’appauvrissement institutionnalisé de la conversation ? Les revues peuvent-elles s’inspirer de modèles éditoriaux vertueux déjà présents sur le Web ? Par quels éléments de continuité et de rupture doit-on envisager la remédiation des revues dans le milieu numérique ?
La revue à l’heure de sa remédiation : pour une théorie médiatique de l’écriture savante
Dans leur transition numérique entamée depuis une vingtaine d’années, les revues se sont engagées dans la formalisation de leurs protocoles éditoriaux et dans la normalisation de leur format de diffusion tout en négligeant leur propre littératie numérique. Ce double processus, largement soutenu par les institutions académiques et par les plateformes de diffusion, a accentué les déphasages entre l’édition scientifique et les pratiques d’écriture et de lecture issues de la culture numérique. La crise de l’autorité que traverse le monde scientifique en général se joue précisément ici. Les pratiques éditoriales nées de l’imprimé et encore instituées dans les protocoles éditoriaux des revues maintiennent un régime de vérité largement bousculé aujourd’hui par le régime de la culture numérique, dont les préceptes économiques et juridiques ne concordent plus avec le modèle imprimé. Cela suggère une certaine rupture épistémologique qu’il est nécessaire de comprendre pour repenser la revue scientifique et les modalités de production des connaissances.
Dans cette partie, j’aborderai cette réflexion au prisme du concept de remédiation tel que l’approche intermédiale a pu le formaliser et le travailler ces dernières années au sein de ce qu’on appelle désormais l’« école de Montréal ».
Je poserai pour cela quelques repères qui m’ont permis d’asseoir ma réflexion et ma pratique. Du fragment comme unité éditoriale à part entière au « cristal », qui le reconfigure, ces notions suggèrent une vision consistante avec le milieu numérique. Or, comme je le montrerai, cette relation entre le fragment et le cristal est déjà décrite par le concept d’éditorialisation, qui, par son caractère ouvert, processuel et performatif notamment, balise cet horizon de remédiation. La théorie de l’éditorialisation pose les bases du régime d’autorité de l’espace numérique, ce que je tenterai d’étudier spécifiquement pour la revue scientifique remédiée par le numérique.
Penser la remédiation des revues : l’approche de l’intermédialité
La remédiation est un concept forgé par Bolter et Grusin qui désigne la représentation d’un media dans un autre. Les auteurs en font une caractéristique du milieu numérique, point de convergence des médias qui lui préexiste.
We call the representation of one medium in another remediation, and we will argue that remediation is a defining characteristic of the new digital media. What might seem at first to be an esoteric practice is so widespread that we can identify a spectrum of different ways in which digital media remediate their predecessors, a spectrum depending on the degree of perceived competition or rivalry between the new media and the old. (Bolter et Grusin 2000, 45)
Selon la définition qu’en font Bolter et Grusin, on peut considérer que la revue numérique s’est effectivement instituée depuis une vingtaine d’années comme une représentation de la revue imprimée, principalement à l’aune de son format. Or on ne peut concevoir la revue scientifique comme un simple artefact ou objet éditorial. La transition numérique de l’édition scientifique n’est ni une question technique, ni même une question de modélisation de son format. Cette seule approche est celle qui a mené au déphasage croissant de l’édition scientifique avec la culture numérique.
Il faut donc élargir notre vision de la revue, mais élargir aussi le champ des possibles afin d’envisager pour l’édition scientifique une refonte épistémologique et institutionnelle au-delà de la revue format. Approcher la revue scientifique comme un media suppose d’abord de remédier sa fonction de médiation et le processus de communication dans lequel la revue s’inscrit.
Pour cela, l’approche intermédiale ouvre une voie théorique particulièrement intéressante. Dans son chapitre introductif à l’ouvrage collectif Théatre et intermédialité, Jean-Marc Larrue retrace l’évolution de la pensée intermédiale et distingue une première période dite médiatique, associée à l’idée traditionnelle du média qui domine entre les années 1970 et 1990, d’une période post-médiatique qui cherchera à désessentialiser les médias comme unités discrètes.
Je m’inscrirai dans le modèle postmédiatique, c’est-à-dire dans une pensée de l’entre, où la revue numérique ne doit pas être pensée comme un media essentialisé, mais toujours comme une dynamique se nourrissant autant des modalités techniques de médias antérieurs ou contemporains que de pratiques éditoriales, scripturales, sociales, communautaires, qu’elles soient anciennes comme contemporaines. Cette idée est notamment à l’origine du concept de « conjoncture médiatrices » forgé par Jean-Marc Larrue et Marcello Vitali-Rosati (2019) pour s’émanciper d’« une vision essentialisée du phénomène de médiation » (2019, 52) et considérer au contraire les médiations comme des « combinaisons mouvantes », conjoncturelles aux interrelations médiatiques.
C’est en suivant cette pensée que l’on pourra se dégager des logiques réactionnaires que Larrue désigne comme « résistance médiatique » :
« [L]es processus de remédiation entraînent parfois – mais pas toujours – des réactions plus ou moins violentes qui relèvent du principe général de “résistance médiatique” qu’on peut comprendre comme une tentative de contre-remédiation et qui est totalement absent, lui aussi, du champ d’analyse de Bolter et Grusin. Cette résistance est un mécanisme de défense qui se déclenche lorsque des fondements de la médiation sont ou, plus exactement, semblent mis en danger par l’intrusion d’un nouvel élément. Le mécanisme de résistance a pour effet d’empêcher, d’éviter, de retarder l’introduction de ce nouvel élément ou de le rejeter après qu’il se soit introduit. » (Larrue 2015 , p.34)
Dans le cas du numérique et de ses effets profonds sur les pratiques scripturales des chercheurs ou éditoriales des revues savantes, on peut relier les résistances médiatiques que ces effets suscitent avec la lutte entre « dominants » et « prétendants » que décrit Bourdieu lorsqu’il étudie le champ scientifique en 1976, bien avant que le numérique ne s’introduise dans l’édition.
Dans la lutte qui les oppose, les dominants et les prétendants, c’est-à-dire les nouveaux entrants, comme disent les économistes, recourent à des stratégies antagonistes, profondément opposées dans leur logique et dans leur principe : les intérêts (au double sens) qui les animent et les moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre pour les satisfaire dépendent en effet très étroitement de leur position dans le champ, c’est-à-dire de leur capital scientifique et du pouvoir qu’il leur donne sur le champ de production et de circulation scientifique et sur les profits qu’il produit. Les dominants sont voués à des stratégies de conservation visant à assurer la perpétuation de l’ordre scientifique établi avec lequel ils ont partie liée. (Bourdieu 1976, 96)
Bourdieu associe très spécifiquement l’« ordre établi » à « l’ensemble des institutions chargées d’assurer la production et la circulation des biens scientifiques en même temps que la reproduction et la circulation des producteurs (ou des reproducteurs) et des consommateurs de ces biens » (1976, 96), comprenant le système d’enseignement d’une part comme transmetteur de la science officielle dans ses deux états, objectivé (les artefacts produits) et incorporé (les habitus scientifiques), et d’autre part les revues scientifiques.
« Outre les instances spécifiquement chargées de la consécration (académies, prix, etc.), il comprend aussi les instruments de diffusion, et en particulier les revues scientifiques qui, par la sélection qu’elles opèrent en fonction des critères dominants, consacrent les productions conformes aux principes de la science officielle, offrant ainsi continûment l’exemple de ce qui mérite le nom de science, et exercent une censure de fait sur les productions hérétiques soit en les rejetant expressément, soit en décourageant purement l’intention de publication par la définition du publiable qu’elles proposent. » (1976, 96)
L’analyse de Bourdieu sur le rôle de la revue dans la perpétuation d’un ordre établi insiste sur l’une des fonctions éditoriales classiques, à savoir la fonction de sélection, ici sous forme de filtre conceptuel et thématique. Comme le montrent nos entretiens, les éditeurs se targuent le plus souvent d’une certaine innovation conceptuelle, en particulier chez les jeunes éditeurs ou les jeunes revues, innovation mise en avant de manière assumée pour justement se démarquer des anciens et de l’ordre établi :
– M.N. : « je pensais qu’Itinéraires était une bonne revue pour faire évoluer les études littéraires et que c’était quand même un outil d’agentivité des esprits. C’est-à-dire que même si c’est des petits articles, même si c’est des petits volumes, 3 par an, que ça pouvait peut-être changer progressivement l’idée qu’on se faisait des études littéraires et de ce que ça peut apporter globalement à la connaissance. »
– M.N. : « Historiquement, les revues [numériques] ont toujours été un espace exploratoire, plus que les éditions papier où il y a quelque chose de presque patrimonial. Il y a un côté expérimental dans la revue [numérique] qui est possible. »
Mais si certaines revues se sont donné dans leur mission une volonté d’explorer des territoires conceptuels nouveaux, l’analyse de Bourdieu redevient pertinente lorsque l’on regarde de plus près le conservatisme éditorial de certaines revues, qui semble voir dans le modèle épistémologique établi celui qui leur donnera la plus grande légitimité auprès de la communauté scientifique. Ainsi, la directrice de la revue Mémoires du livre avançait lors de son entretien :
– M.P. : « Quand on a fondé la revue en 2009, il y avait encore un préjugé très fort à l’encontre des revues électroniques. Ce n’était pas un processus aussi rigoureux qu’une revue scientifique papier. Pour se battre contre ça, notre stratégie a été d’appliquer une grande rigidité, beaucoup de rigueur, et c’est pour ça que les évaluations sont au cœur de notre processus. Je pense qu’elles le sont en réalité, parce qu’il y a deux moments d’évaluation, la sélection des propositions d’abord puis la sélection des articles par deux membres externes et un membre interne, la revue a été pensée pour avoir toute cette rigueur et placer l’évaluation au cœur de son processus. »
– M.N. : « Ça a voulu dire dans un premier temps reproduire les mêmes manières de faire que les revues papier les plus exigeantes, mais le faire dans un contexte numérique, pour justement lutter contre ces préjugés. Ce n’était pas très original au début. Faire la même chose que ce que les revues papier font, sauf que c’est en ligne, c’est gratuit il n’y a pas d’abonnement, mais c’est les mêmes processus de sélection, les mêmes appels de texte, les mêmes comités scientifiques qui viennent donner du capital symbolique, c’est les mêmes pratiques. J’imagine que dans l’avenir il faudra évoluer. »
Il faut remarquer que cet attachement n’est pas sans lien avec la pression institutionnelle des financeurs.
– M.P. : « On est limités à reproduire les exigences que les pourvoyeurs de fonds nous demandent. Au niveau du processus d’évaluation, le CRSH va valoriser cette évaluation-là avec au moins deux experts externes à l’aveugle. À moins qu’eux changent leurs règles, on ne pourra pas les changer non plus. La question du libre-accès a toujours été fondamentale, nous n’avons jamais voulu être une revue sous abonnement, et la conséquence c’est que de faire ce que le patron, en l’occurrence le CRSH, nous dit de faire. »
Pour autant, cette éditrice qui se trouvait être au moment de l’entretien en pleine passation de ses fonctions de directrice, semble suggérer une piste d’évolution et de renouveau pour la revue.
MP: Il y a ce paradoxe avec lequel on vit et peut-être que l’équipe va devoir se poser des questions et voir ce qu’ils veulent faire avec ça. Cette nouvelle idéologie que les revues peuvent établir un meilleur dialogue entre les auteurs, les évaluateurs, animer la recherche est peut être une deuxième étape dans la vie de la revue, mais je dirais que les 10 premières années on a surtout été occupés à avoir l’air crédible aux yeux des autres.
On sent dans ces propos une tension intéressante faite à la fois de méfiance et d’espoir, méfiance pour un modèle qualifié de « nouvelle idéologie », mais espoir tout de même, avec la prise de conscience qu’il y aurait là pour les revues l’opportunité d’« animer la recherche » et de faire ainsi évoluer une mission souvent réduite à la « fonction symbolique [d’]allouer du capital académique »Ma traduction. La suite de la citation originale est éloquente : “Unfortunately, researchers are still dependent on one essentially symbolic function of publishers, which is to allocate academic capital, thereby explaining why the scientific community is so dependent on ‘The Most Profitable Obsolete Technology in History’ (Schmitt 2014)”.
(Larivière, Haustein, et Mongeon 2015). Cette fonction étant d’ailleurs coincée dans ce que Bourdieu décrivait comme « une stratégie de conservation » (1976, 94) de ce même capital.
C’est en considérant la revue comme l’intersection toujours dynamique d’un faisceau de techniques et de pratiques que l’on pourra la penser dans la continuité, et non dans la rupture, et dépasser ainsi les résistances naturelles à toute disruption (Stiegler 2016).
En ce sens, l’approche intermédiale telle que la défend un groupe de chercheurs à l’université de Montréal, est pertinente à plusieurs titres. Concevoir la revue numérique comme une remédiation de la revue papier est une première piste à explorer pour inscrire l’édition savante numérique dans la continuité de l’histoire humaine (Chartier 2014) – et non-humaine (Vitali-Rosati 2018b , s. d.) – des techniques et des pratiques d’écriture, d’édition, de publication et de diffusion. Mais il faudra concevoir cette remédiation au-delà de la théorie de Bolter et Grusin et du modèle remédiant, dont Larrue (2015) pointe les limites. Ce modèle occultait ainsi les échecs pour ne considérer que les remédiations réussies, c’est-à-dire supposées améliorer de média en média le principe d’« immédiateté ». Il ne s’attachait qu’aux médias les plus visibles (le cinéma, la télévision, la radio, la vidéo numérique) et à leur généalogie « darwinienne » jugée trop « linéaire ».
« Cette vision optimiste et linéaire de l’évolution des médias est cependant contredite par la réalité. Si nous allons vers une fidélité – ou une transparence sans cesse plus accrue, comme le répète d’ailleurs l’industrie, comment expliquer le succès de médiations en basse fidélité tels les webdocumentaires réalisé[e]s à partir de téléphones portables ou les enregistrements en format MP3 ? » […] « La réalité intermédiale [est] faite d’entrelacs, d’enchevêtrements, de retours en arrière, d’accidents – dont la généalogie des médias, forcément linéaire, qui inspire les premiers intermédialistes, pouvait difficilement rendre compte. » (2015, 37‑38)
L’approche intermédiale présente l’intérêt de considérer la remédiation qu’est l’entreprise de revue numérique comme une opportunité pour y intégrer des pratiques éditoriales plus contemporaines. Si le point de départ d’un tel parcours est la « culture de l’imprimé » (Chartier 2016), l’horizon doit s’inspirer du milieu de communication et de l’écosystème d’écriture dans lesquels la revue remédiée habite désormais. Sur quels aspects et quelles propriétés de ce milieu peut-on s’appuyer pour repenser l’édition scientifique dans « l’ordre des discours » (Chartier 2014) du numérique ?
Les matérialités de l’écriture numérique
Afin d’être en mesure d’engager la réflexion vers une désessentialisation de la revue en tant qu’artefact éditorial, il convient de mieux saisir le milieu et la culture dans lesquels la revue s’installe désormais. Quelles en sont les caractéristiques ? Quelles sont les pratiques spécifiques qui s’y sont développées ? Peut-on parler de rupture ou de continuité ? L’approche intermédiale nous oriente nécessairement dans une posture de continuité, mais dont les traits de jointure sont parfois trop évidents et méritent une analyse plus poussée« [C]’est en inscrivant l’écriture numérique dans la continuité de l’écriture qu’il est possible de mieux comprendre les discontinuités. Inscrire l’écriture numérique dans l’histoire longue de l’écriture, c’est non seulement étudier attentivement les médiations, techniques et politiques, propres à toute “énonciation éditoriale”, mais c’est aussi bien dégager les médiations propres à l’écriture numérique, comme celle de la “trace d’usage”. » (Petit et Bouchardon 2017, sur Hypothesis)
. Pensons à l’alphabet par exemple, effectivement partagé dans chacun des milieux, mais dont la matérialité d’inscription a radicalement changé. Outre la matérialité des supports et des dispositifs d’écriture et de lecture, ce sont souvent les valeurs politiques, sociales et communicationnelles qui sont aussi à réévaluer. Je parle volontiers de glissement pour définir le passage d’un état à un autre. Cette notion rend bien compte d’une certaine continuité qui peut se traduire par exemple par la redistribution ou la dissémination d’une valeur ou d’une fonction. C’est le cas des différentes fonctions éditoriales, y compris dans l’édition scientifique qui, loin de disparaître avec le numérique, se voient redistribuées aux différents acteurs en présence, tant humains que non-humains (algorithmes par exemple)Je développe le glissement de la fonction éditoriale dans différentes parties de la présente thèse.
.
Je souhaite donc ici m’arrêter plus particulièrement sur quelques éléments qui me semblent primordiaux pour comprendre la remédiation de la revue scientifique. Pour y parvenir, je prends volontairement un peu de distance par rapport à l’édition scientifique proprement dite – comme nous y encourage l’approche intermédiale –, afin d’identifier ce qui du milieu et de la culture numérique se révélera signifiant pour comprendre la remédiation de la revue. Mais, nous le verrons, cet inventaire évidemment lacunaire vis-à-vis du numérique échafaudera une certaine cohérence, puisque chaque élément identifié s’agence avec les autres, confirmant au passage leur nature écologique. Mon objectif est ainsi de traduire – de remédier – ces éléments dans ce qui nous intéresse, à savoir la revue comme media de communication scientifique et la conversation comme horizon des possibles.
Texte et écriture
Un premier élément qui marque la spécificité du milieu numérique se joue dans la nature du texte numérique, devenu à la fois support, dispositif et milieu.
Pour Kittler (s. d.), les inscriptions numériques se distinguent des inscriptions sur support physique par le fait qu’elles ne sont plus perceptibles par la vue humaine. Du visible, elles sont passées à un ordre de grandeur nanométrique hors d’atteinte des capacités sensibles de l’être pensant. Nous pouvons interpréter ce phénomène selon un point de vue médiologique en disant que le texte s’est simplement dissout dans son milieu, se confondant avec les autres écritures qui produisent ce même milieu, à savoir les codes, les protocoles, les inscriptions sur silicone – circuits imprimés et puces, qui sont en fait des instructions.
Du caractère d’imprimerie à l’encodage 8 bits de l’UTF-8 (par exemple), la matérialité du texte s’est en effet doublement dénaturée, une première fois sur le plan symbolique, du signe alphabétique au système de signes binaires, et une seconde fois dans l’équivalence du binaire aux impulsions électriques. Cette déconstruction radicale du texte (Kittler, s. d.) revient à une dissolution de l’unité d’inscription (la lettre) en unités plus petites, le bit. Ces bits de nature binaire supporte à la fois le texte inscrit, le code qui le manipule, la puce qui traite (process) le code. Le bit, et son équivalent physique (l’impulsion électrique) constituent finalement les briques élémentaires du milieu numérique.

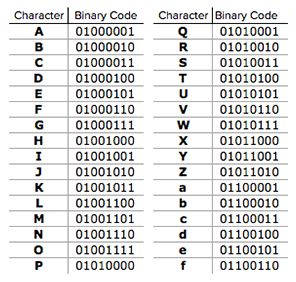

Matérialité de l’alphabet : du caractère mobile à l’impulsion électrique
Pour autant, si l’inscription sort du domaine du visible, l’intelligibilité du texte n’est pas perdue. Sa dissolution est à tout moment réversible grâce au calcul, tant que les conditions sont réunies pour opérer ce calcul. C’est justement le milieu qui assure la faisabilité de ce dernier, où l’on voit bien ici comment le milieu est coproduit à la fois par les couches matérielles (à commencer par la présence d’énergie électrique), logicielles et environnementalesOn peut penser aux protocoles du réseau lorsque le calcul fait appel à des ressources externes
. Cette faisabilité est également dépendante des multiples standards sous-jacents à la production de texte : de l’encodage de caractère à l’encodage du texte, mais aussi de la police d’affichage, des feuilles de styles, etc. C’est l’ensemble de ces éléments qui permet au texte numérique, doublement inintelligible, car encodé et imperceptible, de se laisser voir et lire par l’être humain alphabétisé« Entre la trace écrite et la trace lue, il y a une continuité physique qui existe dans les cas de l’écriture de la langue et de l’écriture des nombres, mais qui n’existe plus dans le cas de l’écriture numérique, dans la mesure où celle-ci nécessite le recours à un programme informatique pour pouvoir faire sens. Une donnée analogique est représentée par la variation d’une grandeur physique ; une donnée numérique est représentée par une suite formelle que seule la machine sait traduire en grandeur physique. » (Petit et Bouchardon 2017, sur Hypothesis)
.
Tous ces éléments constituent en effet d’après Bachimont (2007) une étape d’« interprétation » qui se glisse entre l’inscription et son intelligibilité par le lecteur. Cette interprétation calculée de l’inscription numérique – qui relève de la médiation technique – échappe au lecteur, et révèle une autre conséquence directe du caractère computationnel du milieu numérique : ces écritures ou inscriptions sont capables de « lire et d’écrire par elles-mêmes » (Kittler, s. d., 30). Plus exactement, le milieu est susceptible de produire de nouvelles écritures à partir d’écritures existantes. On peut se demander alors s’il est possible (et nécessaire) de distinguer différents niveaux d’écriture selon sa provenance et sa fonction dans le milieu, qu’elle soit machinique ou humaine, mais aussi qu’elle soit code, données, métadonnées, discours, etc.
Le milieu numérique est en effet régi par une succession d’écritures programmatives que l’on retrouve à différents niveaux de technicité dans les logiciels, les protocoles, ou encore les cartes imprimées et les puces électroniques. Ces écritures, structurelles ou architecturales, élaborent ensemble un espace d’action dont les traces sont elles-mêmes écriture.
Petit et Bouchardon souhaitent encore les distinguer et en proposent trois niveaux (Petit et Bouchardon 2017) : 1. l’écriture par la machine (implémentation) : c’est le niveau électronique et binaire, le seul qui s’incarne matériellement. 2. l’écriture pour les machines (manifestation) : c’est le niveau logiciel et fonctionnel, il s’agit du code informatique qui comprend les différentes couches logicielles de la machine, jusqu’aux formats 3. l’écriture avec les machines (interaction) : c’est le niveau visible des interfaces, celui de l’utilisateur-scripteur qui agit.
Ce distinguo est essentiel, car s’il réitère que tout est écriture et insiste sur le fait que toutes les écritures ne sont pas de même nature.
La métaphore trompeuse de la liquidité
Or la dissolution du symbole et sa manipulabilité attribueraient au texte numérique une nature liquide. Cette métaphore de la liquidité, largement répandue et analysée comme telle (Bernardot 2018), vient illustrer l’instabilité de l’inscription numérique, par essence altérable et modifiable à tout moment, que ce soit du fait d’une action humaine ou d’une opération informatique. Tout un chacun (humain ou machine) ayant le contrôle sur le processus d’écriture peut éditer, au sens de modifier, un texte numérique. Cette liquidité est certes une métaphore féconde pour partager, « par une sorte de conductivité symbolique » (Bernardot 2018), la vision d’un espace numérique qui justement ne se laisse pas saisir aisément. Mais elle doit être nuancée pour plusieurs raisons.
D’une part, comme on l’a vu avec les écritures protocolaires ou structurales, certaines couches du numérique sont au contraire extrêmement rigides et formalisées. Ainsi, si le texte présente une variabilitéComme le rappellent Petit et Bachimont : « De cette manipulabilité découle la variabilité de l’écriture numérique. La variabilité, c’est d’abord celle du code informatique, qui repose sur des variables intégrées dans des programmes ; c’est ensuite celle de l’espace d’affichage, et c’est enfin la variabilité d’un contenu dans le temps (entraînée par la variabilité des dispositifs techniques), qui incite à une réinvention et à l’écriture de variantes. Ces trois dimensions de la variabilité sont articulées : dans la mesure où le code comprend des éléments auxquels on peut attribuer différentes valeurs (variables), l’écriture est conçue de façon à pouvoir connaître des variations (en tant que procédé de composition) et est effectivement sujette à variations dans le temps (variantes). » (Petit et Bouchardon 2017, sur Hypothesis)
effectivement en rupture avec la graphosphère, le milieu numérique tient sur une structure multi-couches très peu liquide. C’est justement ce type de structure qui permet par exemple aux dispositifs d’écriture (éditeurs, traitements de texte, CMS) de contraindre les droits et accès en écriture à certaines inscriptions, malgré la nature variable du texte numérique. Car si le support de mémoire numérique est effectivement réinscriptible à volonté, il n’en demeure pas moins qu’il est strictement contrôlé et maîtrisé par des couches logicielles qui s’assurent que les données soient correctement manipulées, et en premier lieu qu’elles soient conservées de manière intègre.
D’autre part, la manipulabilité du support qui détermine sa variabilité détermine aussi sa fiabilité, c’est-à-dire la capacité d’un système à garder trace des variations (on parlera de « variantes » pour le texte discursif). Là où la mécanique des fluides ne distingue plus les particules élémentaires et peut appréhender un liquide comme un tout aux propriétés spécifiques au tout, la mécanique informatique de son côté n’en perd aucune goutte ni aucun bit. Aussi fine soit-elle, la granularité informationnelle de l’informatique ne verse pas dans la continuité aqueuse mais bien dans la discrétisation solide.
De l’invariant textuel à la variabilité du texte numérique
On peut par ailleurs avancer que l’invariant textuel (de Biasi 1997) qu’assurait le support papier au texte demeure d’une certaine façon dans l’environnement numérique. Il n’est certes plus assuré par le support lui-même, mais par le dispositif, c’est-à-dire par tous les mécanismes garantissant le traçage des accès au texte notamment en écriture. Ce transfert fonctionnel est sans doute l’une des clés de l’épistémé numérique tant il porte à conséquence sur la fonction d’autorité du texte et par extension de son.ses auteur.s. et des institutions qui en sont responsables. Car dans la graphosphère, c’est sur la base de cette stabilité du support (le papier), que pouvait exister la stabilité du dispositif (le livre), sur laquelle reposait la stabilité de l’institution (la bibliothèque), et finalement tout le régime de sens depuis l’imprimerie, d’après de Biasi (1997). Dans l’environnement numérique, les repères de stabilité (ou encore les signes d’autorité) se sont radicalement déplacés, produisant de fait une impression d’instabilité du texte, érodant la notion même de référence et avec lui tout le système bibliographique qui s’est mis en place pour l’institutionnaliser. Or, cette référence et son institutionnalisation sont les conditions du partage d’un socle commun de connaissances au sein d’une communauté de savoir. La possibilité de s’y référer procure au texte stabilisé une autorité et une authenticité nécessaires à une réflexion commune.
Une autre approche pour questionner cette apparente liquidité est de la considérer comme une accélération des processus d’écriture et de réécriture. Cette accélération est permise par le calcul, et c’est par le calcul que se résout également la complexité de manipulation du texte et de ses états successifs. Il est en effet possible de mettre en place des dispositifs et des protocoles associés capables de tracer et de maîtriser cette variabilité du texte numérique, pour recréer des conditions de stabilité, ou tout du moins pour abaisser la complexité native à une complexité appréhendable par la cognition humaine, qu’elle soit individuelle ou collective.
Depuis les instructions informatiques élémentaires de gestion de fichiers, avec son nommage, son extension, son encodage, sa date de création ou de modification, etc., les dispositifs d’édition et de publication n’ont cessé d’améliorer leur gestion du texte numérique et de reproduire un tant soit peu une certaine stabilité, jusqu’à assurer aujourd’hui une panoplie de fonctions qui n’étaient pas envisageables avec le support papier, telles que le versionning, le multi-auteur (asynchrone), le collaboratif (synchrone), l’annotation, etc.
Le cas du wiki, donnant accès à toutes les versions antérieures du texte et aux modifications successives par auteur, en est l’exemple le plus emblématique. Git propose un protocole de contribution alternatif à partir duquel émergent des dispositifs d’écriture collaborativeVoir notamment l’outil Penflip.
(Burton). On peut également citer le principe de la blockchainVoir sur Wikipedia la notice Chaîne de blocs.
, conçue comme un registre distribué assurant la comptabilité des écritures et de leurs auteurs (machines et humains).
Ces exemples montrent bien qu’il serait possible, en théorie, de reconstruire un système bibliographique, c’est-à-dire un système fiable de référence, dans le sens d’un modèle épistémologique embrassant pleinement cette variabilité du texte. Or on voit bien que les différentes fonctions traditionnellement assurées par l’institution, le dispositif ou le support (respectivement la bibliothèque, le livre ou le papier), ne sont plus distinctes et séparées, mais sont parfois transférées à d’autres entités, ou distribuées entre elles, autrement dit assumées par un milieu tout à la fois support, dispositif et institution.
Du fragment au cristal : la nouvelle granularité de la connaissance
C’est dans ce contexte que s’est développée la culture numérique marquée par une explosion des formes éditoriales et plus largement de formes d’écriture. Cas d’école de remédiation, le courriel, la newsletter, le blogue, ou encore le micro-blogging, n’en ont pas moins instauré des pratiques communicationnelles inédites.
La culture du fragment
Le contexte est celui de la “convergence culture”, théorisée par Henry Jenkins (2006), qui se caractérise notamment par un processus de convergence des environnements techniques et culturels : communiquer, partager, s’informer, écouter de la musique, jouer, regarder des programmes télévisés, consommer, créer, écrire, rechercher, travailler, etc. Toutes ces activités quotidiennes se tiennent désormais dans le même espace d’information, le Web. Par ailleurs leurs dispositifs d’accès ou d’action se concentrent et se réduisent principalement au téléphone intelligent, à la tablette tactile ou au micro-ordinateur, entraînant logiquement une fragmentation de l’attention, sollicitée par une multitude de contenus rivaux au sein d’un même dispositif. Une conséquence de cette convergence radicale est ce qu’on a appelé l’économie de l’attention où sont rentrés en concurrence les médias traditionnels avec de nouveaux modes de consommation personnelle mais aussi l’ensemble des activités sociales ou personnelles. Comme pour s’adapter à cet engorgement attentionnel, les contenus se sont faits plus courts, réduisant toujours plus l’unité éditoriale susceptible d’être consommée, jusqu’aux fameux 140 caractères de la plateforme de micro-blogging TwitterEn 2017, Twitter a étendu la longueur des tweets à 280 caractères.
. Les GIFs animés, caractéristiques de la culture numérique et du « mème Internet », sont emblématiques de cette abréviation des contenus. Véhiculant souvent une seule idée, le GIF concentre en quelques frames visuelles selon une grammaire bien particulière un extrait de culture populaire ou une mini-animation, dont le succès se joue sur son expressivité.
En réponse à la fragmentation de l’attention, ces contenus courts témoignent de la fragmentation des contenus en circulation. Dans ce contexte, Roger Chartier estime qu’un nouveau régime textuel cohabite avec l’ancien, basé sur l’imprimé. Il identifie ainsi « des modes de lecture discontinus, segmentés, fragmentés, qui procèdent analytiquement à partir de mots-clés, de rubriques thématiques pour s’emparer d’un article dans un périodique électronique, d’un passage dans un livre, d’une information dans un site » (Chartier 2014). Ce régime de lecture rejoint la pratique anthologique caractérisant la culture numérique selon Milad Douhei. Chartier va en fait plus loin et pointe « la structure anthologique de la textualité électronique » avec pour effet « une immédiateté du fragment sans que soit ni nécessaire ni désirable la relation entre le fragment et la totalité discursive de laquelle il est un fragment ». Dans sa conférence, Chartier semble déplorer la perte de « l’immédiateté » et de « la corporalité » de la relation entre le fragment et sa source qu’imposait la matérialité d’un numéro de revue ou d’un livre imprimé. Je soutiens pour ma part que cette immédiateté s’est déplacée de la source vers le texte anthologique. Car dans ce raisonnement, la nouveauté n’est pas le fragment, qui existe par exemple sous forme de citation dans l’édition savante ; la nouveauté est le lien maintenu du fragment à sa source. Dans l’imprimé, la relation « immédiate » entre fragment et totalité n’existe qu’à la source puisqu’une fois extrait, le fragment n’y est relié que par une mention bibliographique, sans autre matérialité ou opérationnalité. Dans le numérique par contre, le fragment peut conserver son lien opérationnel à la source en lui donnant un accès immédiat et de manière bien plus précise et pertinente pour le lecteur. Certes, avec la fragmentation des contenus, le chercheur-scripteur du texte anthologique a pu délaisser dans son travail de composition un certain mode de lecture contextualisé, mais au profit de son propre lecteur à qui le lien à la source donne les moyens opérationnels de recontextualiser les fragments.
Que signifie ce déplacement dans le régime d’autorité du milieu numérique ? Il suggère en fait un autre déplacement, celui d’une redistribution de certaines fonctions auctoriales et éditoriales dans les mains du lecteur, ou plus exactement à la communauté des lecteurs. Je pense par exemple à la fonction interprétative, facilitée par la nature hypertextuelle des contenus qui multiplie les opportunités d’association et de réinterprétation des fragments en circulation.
Dans l’écosystème numérique, le fragment acquiert une nouvelle valeur. Mais ces fragments, qui peuvent être une ressource, une donnée, un tweet, une annotation, ne sont pas des extraits éparts. Là où les formats plus longs et plus classiques tirent leur richesse de leur contenu lui-même, la valeur du fragment au contraire réside essentiellement dans les informations qui le caractérisent : les métadonnées. Ce sont ces dernières qui le situent dans le cyberespace et lui octroient une viabilité. Sans ces informations le documentant, la plupart de ces fragments seraient négligeables et insignifiants, noyés dans le flux informationnel et sans aucun intérêt intrinsèque. C’est effectivement leur contexte qui les rend signifiants et viables en tant que contenu culturel. Le contexte est d’abord celui de leur production, qui génère un certain nombre de métadonnées initiales, auquel s’ajoute leur contexte d’usage, qui insère et dispose le fragment parmi d’autres, suite à une requête, une géolocalisation, une collection, etc.
Le site networkeffect.io de Jonathan HarrisJonathan Harris est artiste et designer. Ses créations web d’une grande inventivité présentent depuis 2002 des formes esthétiques et expressives exploitant pleinement les potentialités du Web. Voir ses différents travaux sur son site number27.org.
exemplifie parfaitement la fragmentation de la production culturelle. Son interface affiche un flux de données filtré selon plusieurs facettes de requête venant agréger en temps réel des ressources et des fragments issus de différents silos informationnels. Présenté dans un flux visuel et sonore aléatoire, le résultat est saisissant tant semble vibrer devant nous le pouls de l’activité humaine sur le Web. Chaque mot-clé opère dans le flux une coupe franche, en extrait une tranche d’humanité, à la manière d’un Tuner FM venant capter l’écho d’une bande de fréquences. Avec cette création, Jonathan Harris exploite merveilleusement le principe du fragment qui ne prend sens que rééditorialisé dans un tout, unique et éphémère.
Cette conception du fragment n’est pas sans rappeler la « ruine » dans la pensée de Walter Benjamin. La ruine est cet éclat d’idée, susceptible de vérité lorsqu’elle s’entrechoque dans un éclair avec une autre ruine. Cette conception mystique du fragment et de l’association est inspirante pour envisager avec Benjamin un régime de vérité alternatif fonctionnant sur l’allégorie et l’évocation, révélées dès lors que les ruines s’agencent en « constellation » (Makarius 2020). Nous verrons comment cette idée puissante, éclat très benjaminien de vérité, entérine la suite de ma réflexion sur la conversation.
Du fragment au cristal
Non loin de l’image de la constellation, une autre notion peut nous aider à concevoir le fragment et sa fonction, notamment dans le contexte de la production de connaissance en lien avec mon étude. Dans un article en forme d’échange de courriels – une conversation justement – Jean-Claude Guédon et Thomas Jensen, directeur de revue, débattent de ce que devrait être une revue scientifique aujourd’hui (Stern, Guédon, et Jensen 2015). Pour Jensen, le format de l’article est nécessaire, sur le plan institutionnel d’une part, mais aussi sur le plan scientifique, car il procède à une fixation du discours scientifique essentielle à la recherche. Pour Guédon, il faut au contraire remettre en question l’article et tendre vers des formats plus petits, afin de fluidifier « la Grande Conversation [scientifique] » tel qu’elle s’est institutionnalisée dans le format éditorial de l’article. Pour visualiser sa pensée, Jean-Claude Guédon introduit le concept de « cristal de connaissance », une forme éditoriale dynamique et éphémère, résultant de l’agrégation de formes courtes.
« Let us transmute the “frozen moments” that were brought up earlier in the text into a slightly more material metaphor, that of “Crystals of knowledge”. Crystals of knowledge should be an important part of how to frame the Great Conversation. Multi-carat crystals are quite acceptable, of course. In fact, defining the range of these “crystals” will be important, and it will require empirical testing. » (Stern, Guédon, et Jensen 2015)
Dans cette citation, on remarque la tension entre les différentes temporalités et matérialités, celles d’un article scientifique au processus long et au format institutionnalisé et celles de formes d’écriture alternatives – le tchat, le courriel, l’annotation, la lecture critique d’un article, etc. – aux formats et aux modalités de publication plus libres. Il imagine ainsi que des fragments de connaissance soient entraînés dans un processus de cristallisation similaire à la fixation du discours scientifique, mais de manière temporaire ou transitoire. Associés ensemble de manière synchrone ou asynchrone, les fragments rentrent en conversation entre eux, pour produire autour d’une problématique donnée de nouveaux éléments de connaissance.
Pour Guédon, le cristal peut ainsi devenir le lieu même de la conversation scientifique. Jaillissant d’une controverse, il viendrait cristalliser des pistes, spatialiser les dissensus, ou refléter un consensus. Finalement, il s’agit de « [créer un] mode maîtrisé, réglé de flux de conversations » (Guédon et Loute 2017) dont la dimension temporelle du flux s’articule avec la dimension spatiale de la synthèse.
On retrouve avec l’image de la cristallisation celle du « précipité » utilisée par Vittu lorsqu’il analyse les modalités des premiers périodiques scientifiques sur la production du savoir :
« Les savoirs publiés dans les périodiques savants sont ainsi comme des précipités prêts à se recomposer sous la plume d’auteurs variés. Les travaux sont régulièrement réactualisés ou remis en question. » (Peiffer et Vittu 2008, 297)
Il y a déjà dans cette citation à propos de l’article scientifique et du périodique savant les ingrédients de la conversation, ou en tout cas de la réécriture interprétative, si déterminante dans le modèle que je vais dessiner.
La notion de cristal, dont une des propriétés serait son caractère métastable, susceptible alternativement de cristallisation et de dissolution, engage le fragment dans une certaine performativité. La notion exprime également très justement le processus d’éditorialisation tel qu’il a été théorisé ces dernières années.
Performativité de l’écriture : l’apport de la théorie de l’éditorialisation
Les facettes de la performativité
Le mouvement continu qui se dessine entre le cristal et le fragment relève en effet de la performativité, selon l’acceptation véhiculée dans les Performative Studies à la suite des travaux de John Austin, John Searle, Judith Butler, ou encore Andrew Parker et Eve Kosofsky Sedgwick. Or il se trouve que les études médiatiques ont elles aussi entamé un tournant performatif, dont se réclame notamment l’intermédialitéElisabeth Routhier parle de « tropisme performatif » pour rassembler la « pensée collective » autour des notions de performance, de performatif ou de performativité. L’auteure explicite notamment l’importance de ce tropisme dans la pensée intermédiale, dans laquelle « chaque acte de médiation performe une identité médiale » : « Autrement dit, dans la pensée performative où l’action précède l’essence – cette dernière se voyant pour sa part glisser vers le processus, le devenir et la multiplicité, chaque acte de médiation participe à la trajectoire d’une médialité.» (Routhier 2017, 68‑69)
(Routhier 2017) pour interpréter de la remédiation.
À l’encontre du texte imprimé et publié auquel on attribue traditionnellement une inertie matérielle, le fragment mis en conversation suggère des formes éditoriales mouvantes, en édition continue, basées sur un référentiel bien différent de celui de l’imprimé, ou plus largement des artefacts éditoriaux classiques. Peut-on envisager la remédiation de la revue scientifique dans une perspective performative ? Comment penser la performativité d’une publication ?
Sans prétendre à ce que la revue devienne un espace théâtral, qui constitue un média « fédérateur » et hypermédia par excellence selon Larrue (2015, 41), on peut en effet conceptualiser la production de connaissance comme un acte performatif et la revue un espace performatif. Une problématique majeure de cette proposition sera alors de vérifier si une performance scripturale est soluble dans un format éditorial susceptible à la fois de mémoire et de reenactment. Je développerai cette problématique dans la partie suivante à partir de l’hypothèse d’un modèle éditorial conversationnel.
Dans la perspective de la remédiation de la revue media, la performativité se jouerait aussi dans le processus permanent de transformation et d’évolution dans lequel elle est entraînée. Larrue rappelle ainsi que le modèle de la remédiation de Bolter et Grusin « inscrit [le média] dans un mouvement perpétuel », confirmant « l’idée […] selon laquelle l’intermédialité » – au sens où le média est le produit et non la source des relations intermédiales, « serait la forme la plus radicale de performativité » (Larrue 2015, 34‑35). Et l’auteur d’ajouter que cette conception de la performativité donne raison à Alexander R. Galloway dans son injonction “Not media, but mediation” (Galloway, s. d., 36), appelant à se défaire de la pensée technocentriste focalisée sur le media et le dispositif, pour mieux se préoccuper du processus de médiation. Pour revenir à notre objet d’étude, la question se pose alors ainsi : de quoi la revue scientifique est-elle la médiation ? Sans s’arrêter à l’« article » qui serait le degré zéro, on peut considérer que la revue remédie des connaissances, des idées, des prises de position, des interprétations, ou bien, selon la hauteur de perspective que l’on adopte, que la revue est le lieu de la médiation du partage, de la conversation scientifique, ou encore de la communauté scientifique.
Témoignant de la prolificité du concept performatif dans les théories médiatiques, la notion de « publication performative » a été explorée et expérimentée par Christopher P. Long et reprise par Janneke Adema pour qualifier le projet éditorial en ligne à partir de son article The political nature of the book. On artist’s books and radical open access (Adema et Hall 2013). Pour Long, la publication performative se définit par son « mode de publication » lorsque celui-ci « performe une des idées principales que le texte lui-même cherche à articuler et à explorer » (Long 2013, sur Hypothesis). Adema rapproche cette idée du concept de « techno-texte » de Katherine Hayles qui désigne un texte interrogeant la technologie d’inscription qui le produit. Hayles explore en effet la relation conceptuelle entre un texte et son support, tandis que la publication performative produit une réflexivité entre le texte et ses modalités de production, de dissémination et de consultation du texte, en examinant l’influence de ces modalités sur le contenu du texte, sa signification et son interprétation. Il ne s’agit pas de « questionner la matérialité de la publication, mais de la performer activement » (Adema, s. d., sur Hypothesis). Cette idée me semble particulièrement porteuse et utile pour qualifier les expérimentations éditoriales dont je rends compte dans cette étude. En particulier, elle laisse entrevoir la propriété de récursivité que je développerai au dernier chapitre, soutenant l’idée d’une écriture performative sur son milieu.
En inscrivant pour ma part la remédiation de la revue scientifique dans un faisceau de propriétés du milieu numérique, à savoir du fragment au « cristal de connaissances », et de la variabilité du texte numérique à son régime de référence, je localiserai la performativité à la fois dans les processus d’écriture et dans la réflexivité du support sur les contenus qui s’y inscrivent. Le cristal de connaissance, avec son principe d’agencement de fragments, est ainsi plus proche de la théorie de l’éditorialisation qui constitue pour mon étude une approche théorique significative.
Le prisme de l’éditorialisation
La théorie de l’éditorialisation, stabilisée en particulier par Marcello Vitali-Rosati, fournit un cadre pertinent pour poser des bases théoriques à la remédiation des revues scientifiques dans l’écosystème numérique. Théorie relativement récente, cette pensée s’est construite dans une dialectique entre pratique et théorie, où la formulation du concept d’éditorialisation s’est nourrie de l’observation des pratiques et du discours des praticiens.
C’est dans cette même dialectique que j’ai inscrit ma réflexion et ma pratique de l’éditorialisation, dont je présenterai les principaux éléments dans le dernier chapitre.
Dans l’ouvrage On Editorialization: Structuring Space and Authority in the Digital Age (2018a), Vitali-Rosati déroule son raisonnement pour forger le concept d’éditorialisation à travers trois définitions successives. Je retiendrai principalement la définition liminaire, sur laquelle se sont appuyés les premières réflexions et usages autour de la notionEn particulier au sein du séminaire Écritures numériques et éditorialisation (2009-2019) dont j’ai été le co-organisateur avec Marcello Vitali-Rosati.
, ainsi que la troisième qui nous intéresse pour sa portée sur la question de l’autorité. La seconde qui définit l’éditorialisation comme « la production du réel » [p.65] est ambitieuse sur le plan philosophique mais se révèle au dire de l’auteur trop large pour être opérationnelle, notamment sur mon sujet.
Editorialization is a set of technical devices (networks, servers, platforms, CMS, search engine algorithms), structures (hypertext, multimedia, metadata), and practices (annotation, comments, recommendations via social networks) that produces, organizes, and enables the circulation of content on the web. In other words, editorialization is the process of producing and diffusing content in a digital environment. [p.63]
Editorialization is the set of dynamics that produce and structure digital space. These dynamics can be understood as the interactions of individual and collective actions within a particular digital environment. [p.66]
De la première définition, outre la multiplicité des acteurs et la pluralité de leur nature, je retiens en particulier le fait que l’éditorialisation est un processus. Cette notion est importante, car elle marque une rupture avec l’édition. On pourrait également qualifier les diverses opérations d’édition d’un ouvrage ou d’une revue imprimée de processus, mais ce dernier, dans le monde de l’imprimé, prend fin dès lors que l’épreuve est validée et que l’imprimeur a obtenu le fameux BAT (bon à tirer). Nous verrons au contraire que l’éditorialisation est un processus continu et ouvert. Je retiendrai encore les notions de production et de diffusion, mais peut-être plus significativement pour moi la notion de circulation, particulièrement appropriée au fragment discuté précédemment.
La seconde définition citée élargit considérablement la première et délaisse en quelque sorte l’aspect “métier” de l’édition ou de la production de contenu pour investir les notions d’espace, d’action et d’interaction, ou encore d’individu et de collectif. Le geste théorique consiste en fait à déplacer l’éditorialisation depuis les artefacts (« ce que [les acteurs] font ») vers les modalités de l’action (« comment ces actions sont formées et orientées »)“These actions are shaped by the digital environment in which they take place, and so editorialization, just as the first definition makes clear, is not only about what people do but also how their actions are shaped and oriented by a particular environment.” (Vitali-Rosati 2018a, 65)
, suggérant alors un processus de l’entre spécifiquement intermédial. Par ailleurs, ce déplacement sur l’action et ses modalités nous permet de renouer avec la performativité précédemment abordée. Enfin, Vitali-Rosati insiste sur la spatialité de l’éditorisalisation en cela que les actions, leurs modalités et leurs interrelations produisent et structurent notre espace compris au sens littéral, c’est-à-dire le monde que l’on habite“A space is a particular dynamic set of relationships between objects. These relationships can be of different kinds, including of distance, visibility, and position. Structuring a relationship between objects also means determining certain values. […] The relationships are always something written, and there is a deep link between inhabiting a space, reading it, and writing it.” (2018a, 7)
. Or la production d’espace est étroitement liée à la production de l’autorité, comme le rappelle l’auteur :
Thesis 1: Each authority is the result of a particular spatial structure. A space is a configuration that generates the possibility of trust. Trust is the result of the particular structure of the relationships between objects. Changing space means also changing the kind of authority we can trust. (Vitali-Rosati 2018a, 7)
La définition de l’éditorialisation s’étoffe de cinq caractéristiques comme cinq facettes de sa « nature », que l’auteur applique en fait « aux autorités » de l’espace numérique : les autorités sont processuelles, performatives, ontologiques (ou non-représentationnelles), multiples et collectives. Processus continu et ouvert, collectif, opérationnel (c’est-à-dire agissant sur l’espace), non-représentationnel (soit produisant le réel plutôt que de le représenter), l’éditorialisation pose un cadre conceptuel au milieu numérique que d’aucuns pourront juger trop abstrait. Une citation me semble particulièrement parlante pour comprendre l’intérêt de cette abstraction :
Editorialization is a performative act in the sense that it tends to operate on reality rather than represent it. We read and we write in digital space – and in particular on the web – but most of the time this reading and writing has a precise operational purpose. This is the reason why editorialization in not a way of organizing knowledge – an architecture of information – but more precisely a way of organizing the world itself – an architecture of being. (2018a, 71)
Les pistes déjà identifiées dans les éléments que j’ai développés précédemment s’articulent aisément avec la notion d’éditorialisation et ses cinq caractéristiques, que ce soit la circulation du fragment, la structure spatiale du cristal, ou la performativité de l’écriture numérique.
Ce cadre conceptuel doit maintenant atterrir et se confronter aux situations localisées. À l’aune d’un corpus, d’un dispositif ou d’une expérimentation éditoriale, le concept d’éditorialisation s’éclaire en révélant ses trois « dimensions » technique, culturelle et pratique. C’est que je propose de faire dans la prochaine partie en considérant ce que Louise Merzeau a qualifié de « dispositif d’éditorialisation », où la théorie pourra s’actualiser dans l’analyse de ses mécanismes. Cette démarche (antérieure à la théorie de l’éditorialisation dont les premières expressions sont publiées à partir de 2015) est celle dans laquelle je poursuivrai mes réflexions tout au long de la présente thèse.
Vers une herméneutique collective
Jusqu’à présent, j’ai dessiné un paysage théorique du milieu numérique d’écriture et de communication dans lequel la revue scientifique se remédie. Dans cette partie, il s’agira de confronter ce cadre conceptuel au terrain pratique, celui d’une première expérimentation que l’on pourrait qualifier aujourd’hui d’éditoriale, au sens où elle a mobilisé une organisation complexe d’écritures multiples.
En marge de la conférence Les Entretiens du nouveau monde industriel 2012 (ENMI12) a été mis en place un dispositif de captation et de documentation de la conférence. Comme je le détaillerai ci-dessous, la contribution des participants à la conférence a occupé une place centrale dans la conception du dispositif, en s’appuyant sur une série de services et de plateformes en ligne. Ces applications, jouant des rôles différents dans la documentation de l’événement, ont été le lieu, lors des deux jours de conférence, d’une intense activité d’écriture au sens d’une production de données et de ressources de différentes natures.
Louise Merzeau a vécu l’expérimentation en tant que participante aux ENMI12 et contributrice de ces écritures. L’année suivante, elle publie un article analysant « l’éditorialisation collaborative d’un évenement » et le dispositif mis en place (Merzeau 2013). Dans cet article qui apparaît comme un jalon important de la « feuille de route »Je reviendrai sur l’agenda médiologique de Louise Merzeau dans le chapitre 3 en examinant son usage de la notion de milieu.
qu’elle s’était précédemment donnée (Merzeau 2007), Louise Merzeau identifie des pistes de réflexion valides pour penser un nouveau régime documentaire propre à l’environnement numérique et à la fragmentation des écrits. La problématique que l’auteure poursuit alors est celle d’une connaissance dynamique caractérisée par un double processus de production documentaire (constitution de corpus) et d’une production mémorielle (remobilisation de ces corpus).
Cette analyse est importante dans mon parcours, car elle constitue le point de départ de l’hypothèse que je n’ai eu de cesse d’explorer lors du doctorat, à savoir la faisabilité et la pertinence d’un format conversationnel de communication scientifique. Le dispositif des ENMI12 semblait en effet adresser un certain nombre d’enjeux liés à la problématique de l’édition scientifique en contexte numérique. Dans cette partie, je passe tout d’abord en revue les différents éléments théoriques de l’analyse de Louise Merzeau pour introduire ensuite l’hypothèse du modèle conversationnel d’édition scientifique et la tentative de formalisation du modèle pour la revue Sens public. Il ne s’agira pas de résoudre dès à présent ma problématique, évidemment, mais plutôt de la préciser et de la resituer dans un terrain qui est très tôt venu ajouter à un questionnement théorique un ensemble de défis pratiques.
Régime documentaire en environnement numérique
le dispositif d’éditorialisation ENMI12 : contexte et contours
En décembre 2012, s’est tenue la 6ème conférence des Entretiens du nouveau monde industriel (ENMI12). Organisée par l’Institut de recherche et d’innovation du Centre Pompidou (IRI) et présidée par Bernard Stiegler, cette conférence adresse les mutations du monde dans toutes ses dimensions avec une approche interdisciplinaire. Ambitieux sur le plan intellectuel, les ENMI ont cette réputation d’être particulièrement denses avec plus de 12 interventions par jour organisées dans 3 ou 4 sessions pendant 2 jours. Autant dire que les pauses sont rares, et les temps d’échanges et de questions sont réduits au minimum, pour la plus grande frustration des deux à trois cents participants au rendez-vous.
C’est dans l’intention de créer un espace d’échange alternatif que l’association Knowtex et l’IRI se sont rapprochées en se fixant l’objectif de mettre en place la « couverture en temps réel » des ENMI12. Les premiers ateliers de travail réunissent Nicolas Loubet, au titre de fondateur de Knowtex qui fournira certains services en ligne et ouvrira un réseau de partenaires et de contributeurs, Sylvia Fredriksson qui intervient à titre de designeuse et enseignante au BTS Multimédia du Lycée Jacques Prévert dont elle va mobiliser une trentaine d’étudiants, et moi-même à titre d’ingénieur et chef de projet à l’IRI.
Ensemble, nous définissons les premiers contours d’un dispositif de couverture en temps réelVoir en annexe le document de présentation revenant sur le dispositif ENMI12 (PDF).
, que Louise Merzeau théorisera quelques mois plus tard comme un « dispositif d’éditorialisation d’événement ». Pour ce dispositif, trois espaces s’agencent : deux espaces physiques, la salle de conférence et la salle de rédaction ou newsroom, dans laquelle est rassemblée l’équipe des étudiants et des éditeurs, et un espace numérique sur lequel interagissent les participants des deux salles.
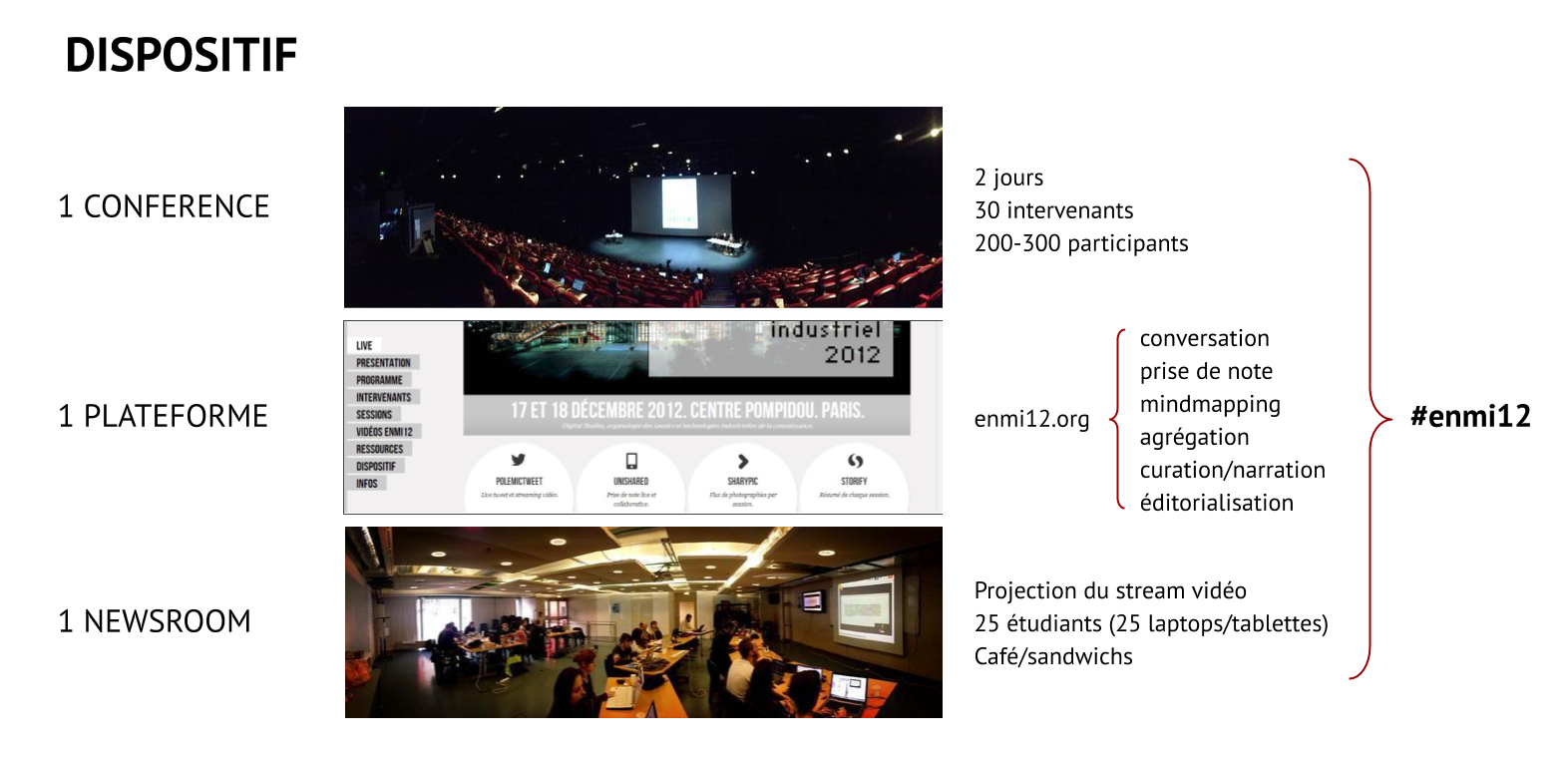
Le choix qui est fait du dispositif numérique est celui d’un éclatement des activités sur différentes plateformes et services en accès libre afin de remplir différentes fonctions Les fonctions du dispositif numérique
Les fonctions du dispositif numérique
: captation et streaming vidéo, prise de note, illustration (captation photographique), visualisation, conversation, narration, agrégation, curation, archive et « éditorialisation ». Cette dernière fonction est comprise à ce moment-là comme l’agencement de l’ensemble des ressources produites à travers un site dont l’objectif est de proposer une porte d’entrée unique et organisée à « l’archipel » de plateforme.
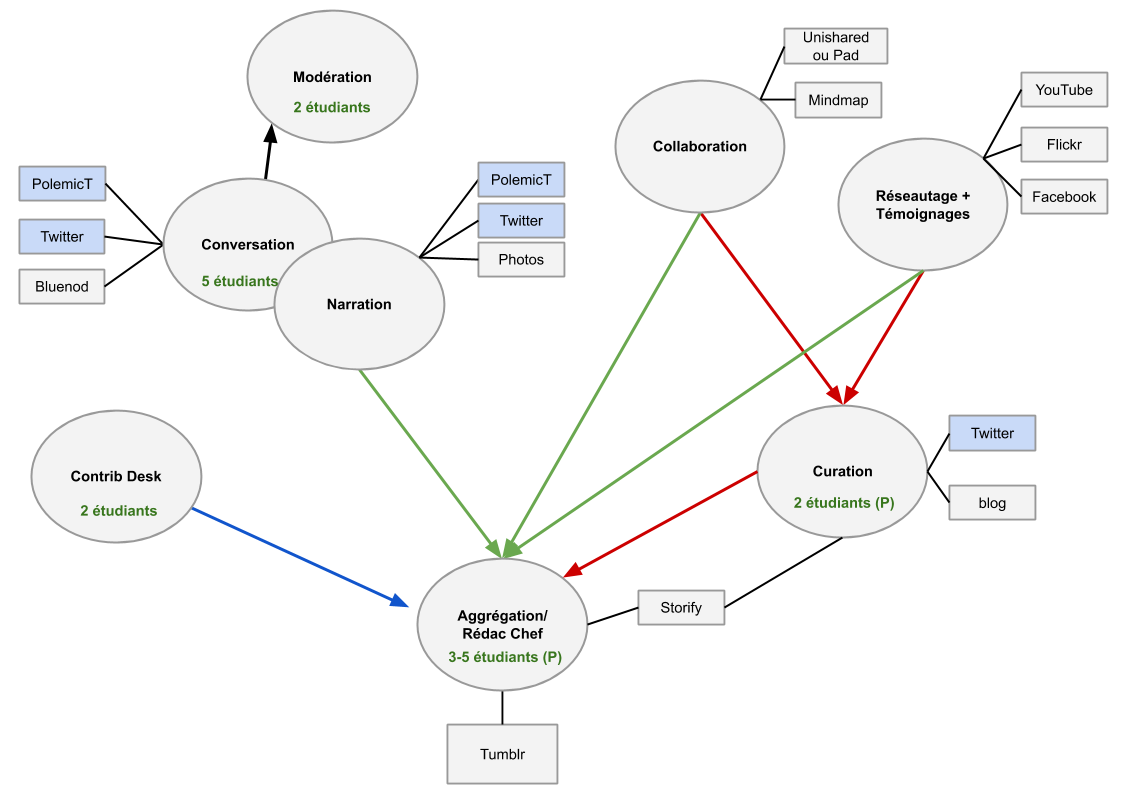
Cette première esquisse du dispositif va évoluer pendant les trois mois de préparation, notamment sous l’impulsion de l’équipe d’étudiants dirigés par Sylvia Fredriksson. Les étudiants imaginent de nouveaux agencements, développent des outils ad hoc, en particulier un glossaire interdisciplinaire présentant pour chaque concept des notices différenciées selon les auteurs ou les courants de pensée.
La newsroom Vues de la newsroom disposée pour les ENMI12
Vues de la newsroom disposée pour les ENMI12
est disposée en trois postes pour traiter trois temporalités distinctes : le temps réel, en prise avec la retransmission live de la conférence, un temps légèrement différé en prise avec les ressources produites en temps réel, et le temps long en prise avec l’après, ou plus exactement avec la structuration d’une archive. Le premier poste est chargé de la prise de note collaborative et d’un “Live Tweet”, le second s’occupe de l’agrégation des ressources produites et de sa mise en narration, enfin le troisième poste prend en charge l’éditorialisation de l’ensemble et la centralisation sur le site vitrine, plateforme vers l’archipel des contenus et premier élément d’archive.
De l’événement à l’analyse : vers la théorisation du dispositif
Une heure avant le lancement de l’événement, la newsroom vibre d’excitation. Tout le monde est en place, mais personne ne sait comment les choses vont se passer. Le succès repose notamment sur la contribution active des participants hors de la newsroom, qu’ils se trouvent en présentiel en conférence ou en ligne, assistant à la retransmission en direct, ou simplement attirés par le bruitLe hashtag #enmi12 de l’événement jouera un rôle essentiel pour la visibilité de l’événement en ligne et pour la circulation des contenus.
. Or, pendant deux jours, la dynamique dépasse tous les espoirs et surprend les organisateurs par l’intensité de la conversation et la qualité des échanges et de la documentation en temps réel. On observe progressivement une véritable production de contenus, dessinant un ensemble éclaté, entre documentation et énoncé critique, et élaborant une cohérence étonnante au regard du nombre de participants et de la granularité des contributions.
Présente à la conférence, Louise Merzeau fait l’expérience du dispositif et contribue activement aux échanges en ligne. Intriguée, elle visite la newsroom le premier jour. À la suite de la conférence, elle entame une série d’entretiens en vue de la rédaction de son article Éditorialisation collaborative d’un événement : L’exemple des Entretiens du nouveau monde industriel 2012 (Merzeau 2013), publié l’année suivante et qui sera le premier d’une série de textes ancrés dans cette même réflexion.
Pour Louise Merzeau, ce dispositif d’éditorialisation serait susceptible d’apporter une réponse aux inquiétudes soulevées dans plusieurs études du régime attentionnel en contexte Web et numérique. Que ce soit Carr (2008) qui considère que le « médium » Internet amenuise les capacités de concentration et de réflexion, ou Cardon (2010) qui s’inquiète de la prédominance de la logique affinitaire dans la recommandation des contenus, ou encore Rouvroy et Berns (2013) pour qui la gouvernementalité algorithmique réduit la subjectivité des individus (et leur devenir) à des profils prédictifs, les travaux ne manquent pas pour analyser un régime de communication condamnant « toute possibilité d’aménager des espaces communs de la mémoire et de la connaissance » (Merzeau 2013, 116).
Louise Merzeau livre ici une analyse fondée sur un cas particulier d’éditorialisation, permettant de jeter un regard nouveau sur le concept d’éditorialisation, et de mieux en comprendre les mécanismes. À la recherche des processus de production, de circulation et de légitimation des connaissances, et surtout des variations de processus entre les environnements pré-numérique et numérique, l’article identifie bien la succession et la superposition des opérations à l’œuvre qui constituent ensemble le processus d’éditorialisation. Il y aurait donc dans ce texte quelques éléments de réponse sur les modalités de production de connaissances en environnement numérique, éléments susceptibles de nous orienter dans la conception de nouveaux formats éditoriaux. Autrement dit, de cette expérience et de ce prototype (qui n’a été que très partiellement reproduit lors des conférences suivantes), peut-on envisager la construction d’un modèle générique, d’un modèle éditorial propre à l’environnement du web ?
L’hypothèse avancée par Merzeau, et qu’elle ne cessera d’affiner progressivement (Merzeau 2014, 2016), est celle d’un dispositif d’éditorialisation collaborative qui, en générant un processus vertueux de circulation et de réécriture, permet du même coup un processus mémoriel reposant « sur une production documentaire affranchie des logiques affinitaires au sein d’un même espace contributif » (Merzeau 2013, 116).
L’hypothèse d’une herméneutique collective
Nous portons l’hypothèse plus loin : selon nous, le processus qu’elle décrit et analyse comme celui d’une redocumentarisation collective, pose en fait les fondements d’une dynamique interprétative, autrement dit d’une herméneutique collective.
L’analyse de Louise Merzeau fait en effet ressortir quatre propriétés constitutives de ce dispositif d’éditorialisation : 1) sa bienveillance, 2) sa réflexivité, 3) son appropriabilité et 4) sa distance. Ces quatre éléments assurent respectivement les fonctions 1) d’établir entre les individus et le dispositif la confiance nécessaire à tout engagement, condition pour ouvrir un espace où penser collectivement, 2) d’établir par la visualisation les conditions de l’élaboration d’une finalité commune, 3) de favoriser la circulation et la redocumentarisation des contenus catalysant des associations nouvelles, 4) d’aménager à l’interstice de ces associations « une glose critique et documentaire », lieu même de l’interprétation.
De l’appropriation à l’interprétation, il n’y a qu’un pas. Et si l’appropriation se matérialise par des écritures et des réécritures, alors le dispositif conversationnel peut prétendre relever d’une activité herméneutique.
La question devient alors : comment profiter de cette dynamique herméneutique pour produire des connaissances, ou encore, comment formaliser ces réécritures dans un format éditorial favorisant à la fois la conversation et son archivage ? Autrement dit, comment réconcilier le régime social et conversationnel du dispositif avec un régime documentaire ?
Bienveillance
Louise Merzeau emprunte à Belin la notion de « bienveillance » pour caractériser le dispositif analysé. Chez Belin (1999), la notion relève d’un espace transitionnel entre le dehors et le dedans, espace où l’individu se reconnaît et dans lequel il peut placer sa confiance. Pour Belin, le dispositif est cet espace dit « potentiel », et « repose moins sur l’édition d’une loi que sur la mise en place de conditions » : conditions d’un possible.
Louise Merzeau reprend le concept de bienveillance dispositive à son compte, insistant sur le caractère environnemental du dispositif, ou de sa dimension spatiale en lien avec « l’habiter »Ce rapprochement est également employé par Belin qui l’emprunte à « l’habiter » de Bachelard (Bachelard, Gaston, La poétique de l’espace, Paris, Presses Universitaires de France, 1957, p. 202-203.).
déjà évoqué.
« Pour négocier l’hétérogénéité des sollicitations extérieures, nous avons besoin de les rendre commensurables avec nos compétences mobilisables. C’est à cet arrangement d’un milieu transitionnel que concourt la médiation des dispositifs. Celle-ci autorise en effet “ une suspension temporaire de la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, frontière qui se trouve remplacée par une relation de rappel, d’assortiment ou de reconnaissance ” (Belin, 1999, p. 256). Condition de l’habiter, cet accommodement avec l’environnement suppose que l’outil soit moins vécu comme instrument que comme augmentation prothétique. » (Merzeau 2013, sur Hypothesis)
La bienveillance du dispositif relève alors de son appropriabilité, voire de son incorporabilité (jusqu’à la prothèse), à moins que ce ne soit le milieu dispositif qui incorpore l’usage.
Enfin, comme condition du possible, Louise Merzeau rapproche la bienveillance dispositive à la contrainte créative, c’est-à-dire propice à la création, telle que pratiquée dans la littérature « oulipienne » :
En ce sens, si le dispositif n’est plus à entendre ici dans le sens coercitif que lui donnait Foucault (1977), il désigne encore une contrainte. Moins panoptique que pragmatique, celle-ci instrumente l’autonomie des participants, comme une contrainte poétique guide et libère la créativité du poète. (Merzeau 2013, sur Hypothesis)
Réflexivité
Louise Merzeau rapproche le régime attentionnel du dispositif analysé du régime attentionnel de la co-création, que l’on retrouve par exemple dans les espaces de coworking, les hackathons, et finalement dans toute approche de co-design. Il s’agit de maintenir un niveau d’engagement général suffisamment élevé pour atteindre collectivement un objectif. Ce régime fonctionne sur un premier principe de fragmentation des tâches selon les compétences et appétences des participants, respectant également les temporalités et les degrés de participations de chacun. La modularité est en effet une des caractéristiques du dispositif tel que Louise Merzeau le décrit :
« Chaque application privilégie un outil, une temporalité (avant, pendant, après), une forme sémiotique (image, texte, oralité) et une modalité participative spécifique (commentaire, annotation, documentation, témoignage, archivage…), sans chercher à les écraser sous une même logique ou les ordonner dans une arborescence unique. »
Bien entendu, le risque d’un tel régime est de verser dans un néo-fordisme, et de générer finalement une prolétarisation (Fauré 2009) des individus. Louise Merzeau montre que le dispositif évite cet écueil de deux manières :
- par la déhiérarchisation des processus, propre aux approches design.
- par la capacité du dispositif à offrir des visualisations de son propre processus, jouant le rôle « de boussole et de régie ».
Autrement dit, ces visualisations permettent aux individus de conserver une vision d’ensemble, de se repérer, se positionner, « se régler » sur les actions des autres. Elles donnent à voir et à lire les temporalités à l’œuvre, la communauté (« sociabilité »), et finalement la finalité de l’ensemble.
Ce don de données revient à rétablir une certaine symétrie entre la communauté productrice et les plateformes détentrices. Une symétrie dans le sens d’un rééquilibrage (relatif) de pouvoir.
Ces visualisations sont identifiées par Louise Merzeau comme un pivot essentiel du dispositif. D’une part, elles garantissent aux individus un accès et une maîtrise de la finalité partagée par la communauté, et d’autre part, puisqu’élaborées (calculées) par la machine sur la base des traces produites par les participants, elles permettent aux participants d’acquérir une réflexivité sur ces mêmes traces, première condition vers leur interprétation.
Finalement, ces visualisations sont vectrices à la fois d’engagement (le moyen) et d’interprétation (la fin). L’interprétation fonctionne ici à la fois sur la synthèse visuelle, vectrice réflexive par excellence, et sur l’association de fragments ou de ressources, dans l’interstice de laquelle elle peut se nicher.
Appropriation
Si la réflexivité constitue un premier vecteur herméneutique relativement classique, l’analyse de Louise Merzeau en fait ressortir un second, celui de l’appropriation. Cette dernière se concrétise dans le dispositif analysé à travers les « actions dispositives » des individus lorsqu’ils sélectionnent, organisent et réécrivent les ressources, autrement dit lorsqu’ils les « éditorialisent » (Merzeau 2013, p111). On le voit, ces actions s’emparent des fonctions éditoriales classiques : la sélection et la structuration des ressources constitutives d’un processus de légitimation ascendant. Les réécritures sont à proprement parler une forme d’appropriation.
En annonçant vouloir « interroger les réseaux sociaux [en tant que dispositifs conversationnels] comme agents d’une évolution de la fonction éditoriale et pas seulement comme moyens de socialisation », Louise Merzeau anticipait en fait, sans que ce soit explicite dans le texte, cette fonction d’appropriation ou d’appropriabilisation. Ce néologisme peut sembler barbare, il est pourtant relativement opérant pour désigner le processus de mise à disposition en vue d’une appropriation. Aux fonctions éditoriales traditionnelles de sélection, de mise en forme et de diffusion (Vitali-Rosati et Epron 2017) s’ajoute cette fonction d’appropriation consistant pour les institutions et les éditeurs numériques à créer les conditions de possibilité de l’appropriationJ’étends ici aux éditeurs – ou plus exactement à la fonction éditoriale – l’idée émise par Silvère Mercier à propos de la mission des bibliothèques. Voir notamment cet entretien, mené par Sylvia Fredriksson.
, c’est-à-dire à élaborer les dispositifs d’éditorialisation prédisposant les ressources à leur appropriation.
Pour Louise Merzeau, le succès du dispositif analysé en termes d’engagement des contributeurs s’explique précisément par le fait qu’il a pleinement assuré cette fonction d’appropriation. C’est l’un des enjeux à poursuivre dans la mise en œuvre de la conversation en tant que dispositif d’éditorialisation.
Distance
Louise Merzeau nous montre que, dans le milieu architectural qu’est le numérique (Vitali-Rosati 2018a, 38), l’espace est régi par « des repères, des références, des normes (lexicales) et des règles d’intelligibilité ». Le dispositif instaure en effet un « protocole » éditorial précis qui conditionne les réécritures.
Cette capacité des participants à suivre, ou plus exactement à jouer de ce protocole, constitue pour Louise Merzeau le « savoir-lire-et-écrire numérique », ou encore la translittératie. « En jouer », tant les actions dispositives sont indissociablement des écritures dans le dispositif (éditorialisation des ressources), que des écritures du dispositif (éditorialisation du dispositif). Un autre indice de translittératie transparaît dans le fait que les principaux participants aient également contribué à la conception même du dispositif, dans un processus en amont de « médiation ».
Écritures et réécritures forment ensemble une « glose », contrainte vertueusement selon des normes et des règles (le protocole). Si la glose consiste par définition en une production de sens constitutive d’une herméneutique, Louise Merzeau cherche encore à mieux la caractériser, à la rattacher au milieu numérique d’où elle émane, afin sans doute de ne pas complètement l’amalgamer à la glose manuscrite. Négociation nécessaire pour penser le numérique entre rupture et continuité. Elle invoque ainsi la culture anthologique (Doueihi 2008) pour préciser la nature particulière de cette glose, fonctionnant en effet par associations sans cesse reconfigurées de fragments et de ressources :
« Au centre de la « compétence numérique » (2008), il faut placer l’aptitude à extraire, transférer et recomposer des contenus au sein d’agencements collectifs. Dans ce « partage anthologique […], sélection subreptice de fragments pour les diffuser sous forme de recueils signifiants […], le sens dérive largement d’une association des contenus : au lieu d’être nécessairement lié à des auteurs, avec leur identité ou leurs intentions, il l’est plutôt à une catégorisation flexible » (Ibid., p. 70). Alors que dans la culture littérale, l’ordonnancement des unités s’opère dans des milieux homogènes (texte, livre, bibliothèque), il s’effectue dans la culture translittérale à l’intersection de systèmes hétérogènes interopérables. »
Ces intersections sont des zones potentielles d’association, où deux unités en produiront une troisième (1+1=3). Mais l’association n’est pas fusion, et entre les fragments de sens se loge toujours un espace interstitiel, matérialisant à la fois le rapprochement, nécessaire à l’interrogation, et la distance, propice à la critique. Finalement, ces interstices sont les lieux mêmes de l’interprétation. Cette distance joue le rôle de coupe-circuit, inhibant les comportements réflexes et réhabilitant nos capacités cognitives et interprétatives court-circuitées par les logiques affinitaires, algorithmiques et probabilistes des réseaux sociaux :
« Cette inquiétude n’est pas tant celle de l’accélération que de l’écrasement des distances sur des proximités toujours plus étroites : proximité affinitaire, promue au rang de principe d’autorité par les réseaux sociaux, proximité algorithmique, ramenant tous les contenus au stade de données statistiquement corrélables, proximité probabiliste, évacuant tout écart d’incertitude au profit d’une prédictibilité des comportements. » (Merzeau 2013, 115)
De ce point de vue, Louise Merzeau nous livre une critique fine des dispositifs conversationnels des grandes plateformes algorithmiques dont elle pointe elle aussi « l’aliénation attentionnelle ». À nouveau, loin de s’arrêter au constat largement consensuel (Morozov 2013; Cardon 2010; Ertzscheid 2014), elle nous confie les clés d’un horizon dépassant l’état de fait que nous imposent les GAFAM.
Design de la conversation : les défis du format conversationnel
Les pistes ouvertes par les analyses de Louise Merzeau laissent entrevoir la possibilité de « [ré]aménager un espace commun […] de connaissance » dans l’environnement numérique, porteur de ce que j’ai appelé une herméneutique collective. Cet horizon est celui que j’ai poursuivi pour imaginer un format éditorial conversationnel pour la revue Sens Public. Terrain de pratique et d’expérimentation pour l’équipe de la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques (CRC-EN), l’équipe éditoriale de la revue Sens Public s’est lancée dans la conception d’un format dont l’objectif était de réunir un régime documentaire et un régime social dans un même objet de communication scientifique. Ce design de la conversation, pensé comme un vecteur de circulation de connaissances, relevait ainsi de la conception d’un espace collectif, réconciliant critique et synthèse dans un même processus d’éditorialisation.
Or, repenser des formes de communication savante en phase avec les pratiques numériques d’écritures des chercheurs suppose de prendre en compte le régime attentionnel du Web dans lequel ces pratiques se sont développées. Pour l’expérimentation au sein de Sens public, il s’agissait d’imaginer un format et un dispositif d’éditorialisation favorisant la dynamique conversationnelle tout en produisant des connaissances mobilisables.
Le dispositif et le contexte de l’expérimentation réalisée ici diffèrent du dispositif ENMI12, mais en reprennent certains aspects. À la fois format et dispositif éditorial, la conversation cherchait en effet à mobiliser la communauté (les éditeurs, les auteurs, les lecteurs-contributeurs) et les ressources internes ou externes à la revue, à travers des actions de réécritures relevant de l’appropriation, de l’association, et finalement de l’interprétation.
En résumé, la conversation imaginée consistait tout à la fois en un processus, un dispositif et un format.
- un processus : celui de la dynamique d’écriture, de réécriture, d’interprétation, de controverse, on pourrait parler d’une herméneutique collective,
- un dispositif : les différents procédés opérationnels qui sont mis à disposition et mis en espace dans une interface pour écrire, lire et réécrire,
- un format : c’est la modélisation de la conversation basée sur l’hybridation de plusieurs modèles : le microblogging (Twitter), l’agrégation de ressources (Storify), la recommandation communautaire (Reddit ou Stackoverflow).
Disons-le immédiatement : la réflexion, débutée en 2017, n’a pas abouti sur un prototype de dispositif ou de format comme prévu. L’expérimentation aura notamment buté sur le calendrier de réalisation des autres chantiers de la revue. Mais les premiers éléments de la conception ont cependant permis de réorienter la réflexion sur la conversation, marquant une inflexion dans mes recherches, et de reformuler ma problématique à la lumière de défis pratiques.
La revue comme espace public
En tant qu’espace public, la revue scientifique constitue un lieu de prédilection pour penser et implémenter un tel design de la conversation. Revue nativement numérique fondée en 2003, et soucieuse d’adresser le monde contemporain dans toute sa complexité (Wormser 2004), Sens public a porté une vision particulière dans le paysage de l’édition et des sciences humaines. La revue est en effet positionnée à la croisée des milieux académique et intellectuel, avec une ligne éditoriale et un protocole relativement émancipés des pratiques institutionnalisées. Elle s’est engagée dès l’origine à faire dialoguer une communauté active d’auteurs et de lecteurs aux perspectives disciplinaires et géographiques plurielles.
Sens Public porte par ailleurs une « conception particulière de la production et de la circulation du savoir dans l’espace public à l’ère numérique ». Aussi, l’expérimentation d’un nouveau canal de communication scientifique s’inscrivait très naturellement dans son ADN. Les acteurs de la revue y voyaient l’occasion de revitaliser le rôle des revues en se consacrant pleinement à leur mission première d’élargir et d’améliorer les conditions de la conversation scientifique. L’expérimentation poursuivait ainsi le projet politique de la revue d’ouvrir un espace public et de publication à l’intérieur duquel la communauté scientifique peut s’ériger en « réseau d’intelligence » (Vitali-Rosati 2014).
Le chantier de la Conversation s’est nourri des autres chantiers dans lesquels était engagée la revue : transformation et pérennisation des archives (2003-2017), mise en place d’une nouvelle chaîne éditoriale, conception et implémentation d’un éditeur de texte intégrant la chaîne éditoriale, réalisation d’un nouveau site pour la revue. Les multiples réflexions, modélisations et tests effectués dans le cadre de ces travaux ont largement bénéficié au design de la Conversation. En particulier, ces travaux ont été utiles pour penser son articulation avec les autres éléments éditoriaux.
Concrètement, l’espace de la revue devait se scinder en deux, l’un documentaire, structuré autour des articles et des dossiers, et l’autre conversationnel, structuré autour des « Conversations ». La Conversation constituait donc à la fois une nouvelle entrée éditoriale au sein de la revue, au même titre que les dossiers ou les articles, et un format éditorial, lui-même réconciliant dans un même objet de communication scientifique le régime documentaire de l’édition scientifique avec le régime social des pratiques d’écritures numériques. Dans cette démarche, l’ambition affichée était de rejouer le processus qui avait vu, avec l’apparition des journaux savants au 17ème siècle, la formalisation des pratiques épistolaires dans le format éditorial de l’article scientifique. La Conversation au sein de Sens public relevait en quelque sorte d’un processus de formalisation et d’institutionnalisation de pratiques existantes.
Modélisation et spatialisation de la conversation
Dans un premier temps, nous avons modélisé la Conversation comme l’agrégation de ressources autour d’une problématique ouverte par l’équipe éditoriale ou par la communauté. Une première modélisation, très simple, caractérise la conversation en quelques éléments :
- un titre en forme de problématique.
- des mots-clés
- des ressources inférées sur les mots-clés, et en particulier :
- annotations d’articles et fils de discussion associés
- références documentaires et extraits de références
- ressources externes
- un ou plusieurs fils de discussion associés
Une conversation revient ainsi 1) à l’agrégation d’un ensemble de ressources : des écrits courts organisés en fils de discussion, des annotations d’articles, des articles, des extraits de documents, des ressources externes ; 2) à un réseau d’individus participants à la conversation, qu’ils soient auteurs des ressources mobilisées ou contributeurs aux fils de discussion.
La première modélisation d’ordre informationnel nous a permis de cerner un objet et d’apercevoir les contours documentaires de la conversation. Une seconde modélisation d’ordre communicationnel a consisté à identifier les primitives de l’activité herméneutique, c’est-à-dire les actions unitaires récurrentes constitutives de la pratique conversationnelle en ligne, en vue de les formaliser dans un format.
À titre d’exemple et en s’inspirant de pratiques déjà bien installées dans les dispositifs conversationnels, nous avons établi une première liste (non exhaustive) des différentes actions de la conversation :
- ajouter une ressource – référence, fragment (citation), annotation d’article, élément d’une conversation
- répondre à un commentaire
- ouvrir un sujet
- commenter une ressource
- taguer un élément
- catégoriser un élément
- voter sur un élément
- associer une ressource à commentaire
- ajouter des sections – découpage du flux, établissant une narration minimale des étapes de la conversation
- établir des collections – sélection et réorganisation d’éléments
On identifie aisément à travers ces actions les modalités de la conversation, qui, ramenées à leur plus petit dénominateur commun, se résume à ce qu’on pourrait considérer comme les primitives de l’activité herméneutique en milieu numérique : lire, écrire, associer, évaluer, structurer.
Or ces actions unitaires sont difficilement formalisables. Il y a là une tension particulière entre format et usage, en particulier pour des pratiques conversationnelles. Les actions de lecture, d’écriture, d’association tendent avec le temps à se formaliser par l’usage (et à devenir des pratiques), mais nécessitent pour subsister une liberté d’évolution. La formalisation par l’usage ne relève pas de la même contrainte que la formalisation par un format. Par exemple, la grammatisation des langues vernaculaires (Auroux 1994) n’empêche ni des pratiques particulières ni leurs évolutions naturelles (on parle bien de langues vivantes). La grammatisation reste un processus ouvert, accompagnant les pratiques au fil de la mutation du langage. On pourrait discuter de la relation qu’entretiennent usage et format, langue et grammaire, et finalement l’homme et la technique (Leroi-Gourhan 1964). L’indissociabilité de ces couples ne peut être pensée en termes d’opposition, mais plutôt de coévolution dont la tension vertueuse fournit à l’un et à l’autre une dynamique vitale (Simondon 1994).
Le cas du hashtag sur la plateforme Twitter nous permet de saisir cette relation entre forme et usage, et d’identifier comment une primitive d’usage se formalise dans un modèle. Lorsque Twitter est lancé en mars 2006, les conventions de mention (« @ »), de hashtag (« # ») ou encore de retweet (« RT @ ») n’existent pas, ni dans les pratiques ni dans le système (Seward 2013). Hormis le retweet dont la pratique s’est développée sur Twitter, ces éléments de langage proviennent de pratiques plus anciennes sur les forums ou les salons de discussions. Ces pratiques vont progressivement émigrerJ’aurais simplement pu utiliser migrer, mais le terme émigrer me semble mieux rendre compte des territoires que sont les plateformes avec leurs repères, leurs usages et leurs utilisateurs. Sur l’usage du terme territoire, voir la conférence « Les enjeux du libre accès pour le Québec » [video] de Jean-Claude Guédon au colloque La publication savante en contexte numérique, 2017, ACFAS (U. Mc Gill)
sur Twitter pour devenir bientôt des « conventions » correspondant en fait à des actions unitaires ou des primitives de la conversation, respectivement : s’adresser à quelqu’un (souvent en réponse à un précédent message), signaler le sujet ou le point focal du message, relayer le message d’un tel.
While retweeting can simply be seen as the act of copying and rebroadcasting, the practice contributes to a conversational ecology in which conversations are composed of a public interplay of voices that give rise to an emotional sense of shared conversational context. (Boyd, Golder, et Lotan 2010)
Twitter les a implémentés dans le modèle de la plateforme par étapes : mai 2007 pour la mention, juillet 2009 pour le hashtag, novembre 2009 pour le retweet. L’implémentation de ces actions unitaires s’est matérialisée par des boutons d’action spécifiques, paratexte « pour l’action » remplaçant la frappe au clavier d’un ou deux caractère·s ou la succession des opérations d’un copier-coller, par un simple clic. Cette dialectique entre les éditeurs de la plateforme et ses usagers témoigne bien d’une co-conception du dispositif et des modalités de sa conversation. Les concepteurs et les éditeurs de Twitter ont en quelque sorte grammatisé (en partie) ce qu’est une conversation Twitter, tel que les utilisateurs la pratiquaient. Dans ce cas précis, une pratique massive ne pouvant être ignorée est venue déterminer de nouvelles fonctionnalités. On retrouve dans cet exemple le principe de la « bienveillance » introduit par Louise Merzeau pour qualifier certains dispositifs.
Les premières modélisations communicationnelle et informationnelle ont mis en évidence la tension entre la dimension temporelle de la conversation sociale et la dimension spatiale du régime documentaire. Si le flux de la discussion restait structurant dans la conception de l’interface du dispositif conversationnel, l’enjeu n’en demeurait pas moins de pouvoir réconcilier ce flux temporel avec la distribution spatiale des ressources agrégées, organisées par exemple selon des axes thématique, auctorial, ou pourquoi pas selon une position dans la controverse. Les enjeux de spatialisation et d’agencement se jouent d’un côté dans le format des inscriptions (la modélisation des données et l’encodage de la conversation), et de l’autre dans la capacité à représenter le flux de la conversation. De ce point de vue, le dispositif relevait bien d’un geste architectural censé agencer l’espace public de la revue.
Cette spatialisation a été envisagée de plusieurs manières :
- une série de visualisations synthétisant les éléments de la conversation : cartographie du réseau des participants inféré sur les échanges, sur les auteurs de ressources mobilisées (annotations, articles), sur les auteurs cités, cartographie des ressources mobilisées établie sur les liens de référence, et carte de connaissances établie sur les concepts et leurs relations sémantiques.
- l’agencement et la présentation des éléments dans le flux (contributeurs et ressources), de manière à favoriser une prise d’action constructive adaptée au niveau d’engagement des contributeurs et aux différentes temporalités.
- la structuration du flux à travers un chapitrage éditorial susceptible d’attribuer une certaine narrativité à la conversation.
- la redocumentarisation des ressources à travers des anthologies personnelles (des collections), que l’on peut considérer comme autant de points d’accès aux conversations et autant d’agents de dissémination dans des gestes critiques d’agrégation et de dés-agrégation.
Dans ces différentes spatialisations, qui n’ont jamais pu être mises en œuvre dans le temps de l’expérimentation, les écritures algorithmiques auraient cohabité avec les écritures individuelles. Elles auraient ainsi produit des formes intermédiaires (visualisations, synthèses, collections), supports de la concertation et du dialogue, favorisant l’émergence d’un collectif.
Le format au défi de la performativité
La réflexion sur le format conversationnel s’est donc orientée pour tenter de surmonter une nouvelle problématique : comment passer du modèle conversationnel au document ? Comment faire document ou faire archive à partir d’un processus collectif ?
Car au-delà de la modélisation des éléments documentaires, ou de leur spatialisation dans une interface pour l’action, le design de la conversation relève aussi du processus et du dispositif social. Élever la conversation comme modèle éditorial consiste effectivement à établir un espace d’expression et à le structurer autour d’un protocole éditorial précis conditionnant les écritures constitutives de la glose. Comme dans tout espace physique de rencontre et de discussion, il s’agit d’agencer du mieux possible les acteurs et les ressources de la conversation, en prédisposant de manière bienveillante (et non contraignante) les actions constitutives de la conversation.
En d’autres termes, la dimension performative de la conversation sociale doit être appréhendée dans sa mise en espace et sa mise en document. Que signifie la fixation d’un processus censé être en mouvement ? Que devient une conversation archivée ? L’intuition qui se dégage de ces questions serait que l’archive d’une conversation ne peut être intelligible et appréhendable que si la conversation peut-être rejouée, c’est-à-dire si les ressources et les éléments de la conversation sont à nouveau pris dans une dynamique d’éditorialisation.
En quelque sorte, la conversation n’atteindra un statut de forme éditoriale que si ses traces sont à même de restituer sa dynamiqueOn pense aux « documents pour l’action » introduit par Manuel Zacklad (2012).
: revivre l’expérience, éprouver les associations d’idées et apprécier les appropriations qui sont faites. La conversation éditorialisée doit donc permettre d’identifier les éléments critiques, de reparcourir les chemins d’interprétation, d’extraire les nouvelles hypothèses et les pistes de réflexion avancées par ses acteurs.
La question est cruciale : un dispositif conversationnel herméneutique peut-il intégrer une mise en document de sa propre dynamique, c’est-à-dire une inscription structurée et remobilisable de sa glose ?
C’est bien une question de modélisation par laquelle la conversation doit subir une formalisation de ses éléments constitutifs, des interrelations inhérentes à ces éléments, et de son caractère processuel (mais non procédural). Comme pour toute entreprise de modélisation, l’objectif poursuivi est déterminant (Meunier 2017). En ce qui nous concerne, l’objectif est double, reflétant les deux aspects du dispositif, à savoir permettre la désagrégation et la réagrégation du document, c’est-à-dire aussi son instabilité et sa stabilité. La désagrégation résulte de la transversalité et de la circulation continue des ressources d’un espace à l’autre, suscitant une dynamique associative et interprétative des ressources. La réagrégation vise à structurer ce processus de circulation dans des formes localisées et synthétiques en vue de le rendre intelligible et appropriable.
Remédier la revue, dépasser le format
Malheureusement, la modélisation du format et la spatialisation de la conversation n’en sont restées qu’au stade du projet, de la réflexion et de quelques maquettes. La modélisation documentaire a bien été implémentée dans un modèle de base de données en marge de la réalisation du site de Sens public, mais le cahier des charges de la conversation est resté un chantier ouvert, achoppant notamment sur la complexité applicative de l’interface et des interactions anticipées. Il faut bien dire aussi que la priorité a été donnée à ce moment-là à la finalisation du site de la revue, dans une version limitée aux éléments éditoriaux classiques. Mis de côté pour un temps, la Conversation dans Sens public a alors été abordée sous un autre jour, comme je le présenterai dans le troisième et dernier chapitre.
Ce revirement aura probablement été salutaire tant le dispositif qui se dessinait au fil des discussions prenait une tournure de plus en plus ambitieuse et à la faisabilité incertaine. Il semblait nécessaire de remettre les choses à plat et de revenir à des objets appréhendables.
Sur le plan communicationnel, l’approche par le format, c’est-à-dire de la formalisation de la conversation dans un nouvel artefact de communication scientifique, a fini par montrer ses limites. Mon hypothèse de départ suggérait en effet que la dynamique de conversation et de circulation se retrouve localisée et centralisée dans un espace sans doute trop restreint pour la susciter. Finalement cette approche consistait à vouloir recréer un media de toute pièce, avec des présupposés très essentialistes, là où une approche intermédiale nous conduit plutôt à considérer l’aspect pervasif de la conversation.
Du point de vue conceptuel, il est ainsi plus juste de considérer le media revue comme un espace d’échange, autant que de publication, et ce justement en multipliant les formes d’écritures et en en fluidifiant les protocoles. Or comment prendre en compte la pluralité de formes et de temporalités dans un seul format et dispositif ? De cette impasse s’est dégagée une piste de réflexion alternative dans la vision d’une multiplicité de dispositifs conversationnels, disséminant les lieux et les opportunités de la conversation. On pourrait alors notamment localiser celle-ci à plusieurs endroits et moments de la vie de la revue, concrétisés par des dispositifs précis :
- en marge d’un article, à travers les annotations d’article,
- lors des évaluations, qui pourraient prendre la forme d’un échange collectif plus ou moins ouvert (entre évaluateurs, entre le comité éditorial, avec l’auteur et·ou les auteurs d’un même dossier),
- au cours d’un travail rédactionnel que l’auteur pourrait rendre accessible et contributif,
- au cours d’un échange sur les réseaux sociaux, référençant spécifiquement un contenu de la revue,
- sur la page utilisateur, à travers des collections thématiques de ressources, un blogue personnel ouvert pour chaque utilisateur (lecteurs, auteurs, éditeurs),
- la catégorisation contributive des contenus,
- le vote et le commentaire sur les contenus de contribution.
On retrouve là l’un des enseignements du dispositif ENMI12, pour lequel la dynamique de la conversation prenait sa source dans les réécritures, consistant pour une ressource à être extraite de son contexte pour être recontextualisée ailleurs, selon le principe de redocumentarisation. Accompagnées ou non d’un commentaire, d’un mot-clé, d’un lien à une autre ressource, ces réécritures incarnent la circulation et fabriquent de l’interprétation.
Aussi, le design de la conversation passe avant tout par celui de la segmentation, de l’indexation et de la circulation, au sens de l’éditorialisation. Pour revenir à la notion de primitive d’action, je visualise un copier-coller outillé, pour lequel l’opération d’extraction d’un texte ou d’une ressource conserverait le lien à sa source. L’élément copié (segmentation) embarquerait avec lui les métadonnées documentant sa source (indexation), visibles et accessibles une fois l’élément collé dans un autre contexte (circulation). Le service d’annotation Hypothes.is remplit cette fonction dans le cas d’un texte publié en ligne. Le retweet (RT), commenté ou non, du service Twitter en est également un bon exemple. Également, le modèle de Storify, dont le service s’est arrêté en mai 2018, est inspirant car il intègre dans un même environnement les fonctions de recherche, de sélection, de copier-coller, de commentaire ou de narration, à partir de plusieurs types de ressources : tweets, posts instagram, etc.
En favorisant une circulation référencée, un tel dispositif de copier-coller constitue une brique architecturale non-négligeable pour la mise en place d’un espace conversationnel puisqu’il définit les modalités de la circulation et de la réécriture des connaissances. Ce n’est rien de moins que le régime de référence, essentiel dans la communication scientifique, qui se voit potentiellement redéfini.
Conclusion
Au terme de ce chapitre, quelques conclusions provisoires s’imposent. D’un côté l’hypothèse de la conversation comme vecteur de circulation et de communauté s’est précisée grâce aux pistes avancées par Louise Merzeau dans ses analyse des ENMI12. D’un autre côté l’approche théorique qui se dessine m’incite à sortir du champ d’étude traditionnel de la revue pour explorer notamment le milieu d’écriture dans lequel s’opère la remédiation de la revue. C’est ce que je ferai dans le troisième chapitre en présentant une série d’expérimentations éditoriales, d’écritures et de conversations collectives. Ces terrains seront source d’indices et de repères pour baliser la revue remédiée.
Une première marche a donc bien été gravie à la clôture de ce chapitre. Ce dernier a présenté une structure presque autonome, agençant ensemble une hypothèse, les contextes historique et actuel, un cadre conceptuel et méthodologique, et finalement une expérimentation et son analyse.
L’histoire de l’émergence des périodiques savants au 17ème indique que l’imprimerie a offert un contexte socio-technique favorable à la mécanisation de la pratique épistolaire et à l’institutionnalisation d’un nouvel artefact éditorial. En quelques années, la revue scientifique s’impose comme un nouvel instrument de travail des savants et des lettrés, et comme un rouage essentiel de la communication scientifique. Au regard de l’histoire de cette innovation éditoriale, et au regard du contexte actuel de déphasage éditorial et épistémologique de la revue scientifique avec les pratiques d’écriture et de lecture issues de la culture et du milieu numérique, il semble alors pertinent d’envisager un nouveau modèle éditorial pour un media en mal de rénovation. Dans l’avènement d’un nouveau milieu d’écriture et de communication, n’y a-t-il pas un moment similaire à celui qui a vu la création du format de l’article et de la revue ?
Quel serait alors le modèle éditorial susceptible d’embrasser pleinement les pratiques numériques d’écriture et de lecture ? Pour répondre à cette question, j’ai posé quelques bases théoriques sur lesquelles m’appuyer pour penser la revue numérique. En premier lieu, il s’agissait de considérer la revue comme un media enchassé dans un milieu particulier dont la rupture technique avec la graphosphère – ainsi que la médiologie désignait le milieu technique, culturel et épistémologique lié à l’imprimerie – laisse présager d’une rupture anthropologique profonde. Sans rentrer dans le débat anthropologique, j’ai proposé quelques éléments caractéristiques du milieu numérique, à travers la variabilité du texte numérique, la fragmentation des contenus et son corollaire, la forme anthologique. Cette dernière se précise pour l’édition scientifique avec l’image du « cristal de connaissances », portant en lui une double tendance à la stabilité et à l’instabilité. Cette dynamique rejoint en fait les propriétés qui définissent le concept d’éditorialisation, notion elle-même mouvante selon le côté de la dialectique par laquelle on l’aborde, entre théorie et pratique. Ces propriétés – processuelle, continue, performative, non-représentationnelle, multiple et collective, nous aident en premier lieu à caractériser l’écriture numérique, selon l’acceptation que j’en ferai. La portée du concept se déploie en fait jusqu’à décrire la production de l’espace numérique – et de l’espace en général tant les écritures numériques cartographient et positionnent chaque chose du réel, explicitant finalement les mécanismes de l’autorité dans l’espace numérique. Or la question de la légitimation est au coeur de ma problématique, pour laquelle la théorie de l’éditorialisation nous offre un cadre conceptuel qui ne demande qu’à être appliqué.
C’est ce que j’ai fait en confrontant ce cadre à l’étude d’un dispositif conçu pour couvrir et documenter un événement scientifique. L’analyse que Louise Merzeau propose de ce dispositif qu’elle qualifie « d’éditorialisation » et dont on retrouve en effet le caractère fragmentaire, processuel ou continu, m’ouvre un horizon intéressant. Merzeau y a entrevu en effet les conditions de possibilité d’un dispositif conversationnel réconciliant le régime social propre au milieu numérique d’écriture et le régime documentaire propre à la production de connaissance. L’héritage médiologique de Louise Merzeau m’incite à penser que sa proposition émise en 2013 et qu’elle n’aura de cesse d’affiner par la suite tente justement de porter sur le milieu numérique un regard médiologique nouveau. Je pourrai développer cette idée ultérieurement en reprenant ma réflexion sur le milieu.
Entre conversation et production de connaissances, le dispositif d’éditorialisation analysé conforte en quelque sorte l’hypothèse d’un format éditorial conversationnel en lui donnant une direction que j’ai souhaité exploiter. Au sein de la revue Sens public, j’ai ainsi entamé un travail de modélisation d’une conversation, imaginée comme un nouvel artefact éditorial. À ce titre, la conversation devait habiter l’espace de la revue au même titre qu’un article scientifique ou qu’un dossier scientifique. Mais la première approche par le format s’est révélée être une impasse. Le caractère performatif du processus conversationnel oblige à repenser la modélisation de la conversation au-delà de l’artefact et de son format, pour l’envisager dans toutes ses dimensions, en tant que processus, dispositif et format. Plus largement, ce revirement s’applique pleinement à la revue en tant que media. La théorie de l’intermédialité nous invite ici à désessentialiser le media et à considérer la remédiation de la revue scientifique à l’aune de ses fonctions de médiation d’une part – soit par-delà sa matérialité, et des « conjonctures médiatrices » qui la performent d’autre part.
La diversité de ces apports théoriques et méthodologiques ne les empêche pas de converger. Elle m’a permis notamment de reformuler la problématique initiale, et de clore le parcours de ce chapitre sur plusieurs ouvertures : l’idée de la revue comme espace conversationnel, le principe d’un media remédié par l’écriture numérique comme processus et milieu, l’objectif enfin d’une légitimation scientifique à réinventer.
Une fois la vision de la conversation comme mode de communication scientifique ainsi précisée, il est apparu nécessaire d’aller voir de plus près la fabrique éditoriale des revues, afin de mieux saisir la distance entre la pratique éditoriale institutionnalisée et les pratiques d’écriture émergentes. Cette fabrique a constitué mon terrain d’enquête, entamé auprès de plusieurs revues de lettres et sciences humaines, et dont je fais état dans le prochain chapitre.
À travers un questionnaire, une collecte de documents et une série d’entretiens avec des éditeurs et éditrices de revue, j’ai tenté de cerner comment les praticiens de l’édition scientifique abordaient les questions de l’autorité et de la légitimation, de la transition numérique des revues scientifiques, et finalement de la conversation. Parmi un panel diversifié de revues, j’ai pu extraire quelques constantes sur leurs valeurs et leurs pratiques, confirmant, on le verra, l’hypothèse de la conversation.
Bibliographie
Adema, Janneke. s. d. « Performative Publications ». Institutionnel. Disruptive Media.
Adema, Janneke, et Gary Hall. 2013. « The Political Nature of the Book: On Artists’ Books and Radical Open Access ». New Formations 78 (78): 138‑56. https://doi.org/doi:10.3898/NewF.78.07.2013.
Allouche, Elie. 2014. « Connecter humanités numériques et éducation ». Billet. Numérique et éducation.
Anderson, Chris. 2004. « The Long Tail. Why the Future of Business Is Selling Less of More. »
Auroux, Sylvain. 1994. La Révolution Technologique de La Grammatisation. Introduction à l’histoire Des Sciences Du Langage, Mardaga.
Bachimont, Bruno. 2007. « Nouvelles Tendances Applicatives : De l’indexation à l’éditorialisation ». In L’indexation Multimédia: Description et Recherche Automatiques. Paris, Lavoisier, Hermès Sciences, édité par Patrick Gros, Lavoisier, Hermès sciences. Paris.
Bardini, Thierry. 2016. « Entre archéologie et écologie. Une perspective sur la théorie médiatique. » Multitudes, nᵒ 62 (avril): 159‑68.
Baricco, Alessandro. 2014. Les barbares: essai sur la mutation. Traduit par Françoise Brun et Vincent Raynaud. Hors série Littérature. Gallimard.
Beaudry, Guylaine. 2010. « La communication scientifique directe : un nouveau champ éditorial, Direct scientific communication : a new publishing field ». Hermès, La Revue, nᵒ 57: 51‑57.
———. 2011. La communication scientifique et le numérique. Collection Traitement de l’information. Paris: Hermès science publications : Lavoisier.
Belin, Emmanuel. 1999. « De la bienveillance dispositive ». Hermès, La Revue, nᵒ 25 (décembre): 243‑59.
Bernardot, Marc. 2018. « Plongée dans les métaphores et représentations liquides de la société numérique ». Netcom. Réseaux, communication et territoires, nᵒˢ 32-1/2 (décembre): 29‑60. https://doi.org/10.4000/netcom.2886.
Bertrand, Paul. 2019a. « La fin nécessaire et heureuse des Humanités numériques #DHIHA8 ». MDVZ 3.
———. 2019b. « Pandora et la boîte fatale des Humanités numériques ». MDVZ 3.
Blanchard, Antoine. 2010. « Ce Que Le Blog Apporte à La Recherche ». In Read/Write Book : Le Livre Inscriptible, édité par Dacos Marin, 157‑66. Read/Write Book. Marseille: OpenEdition Press.
Bolter, Jay David, et Richard Grusin. 2000. Remediation: Understanding New Media. MIT Press.
Bourassa, Renée, Lucile Haute, et Gilles Rouffineau. 2018. « Devenirs numériques de l’édition ». Sciences du Design n 8 (2): 27‑33.
Bourdieu, Pierre. 1976. « Le champ scientifique ». Actes de la recherche en sciences sociales 2 (2): 88‑104. https://doi.org/10.3406/arss.1976.3454.
Boyd, Danah, Scott Golder, et Gilad Lotan. 2010. « Tweet, Tweet, Retweet: Conversational Aspects of Retweeting on Twitter ». In System Sciences (HICSS), 2010 43rd Hawaii International Conference On, 1‑10. IEEE.
Broudoux, Evelyne, Philippe Bootz, Jean Clément, Sylvie Grésillaud, Hervé Le Crosnier, Véronika Lux-Pogodalla, Jean-Hugues Réty, Estrella Rojas, et Geneviève Vidal. 2007. « Auctorialité : production, réception et publication de documents numériques ». In La redocumentarisation du monde, Cepadues, p183‑204.
Cardon, Dominique. 2010. La Démocratie Internet : Promesses et Limites. La République Des Idées. Seuil.
Carr, Nicholas. 2008. « Is Google Making Us Stupid? » Yearbook of the National Society for the Study of Education 107 (2): 89‑94.
Carr, Nicholas G. 2011. Internet Rend-Il Bête ? Robert Laffont.
Chartier, Roger. 2014. « Crise de l’édition en sciences sociales et publication numérique ». EHESS: Direction de l’Image et de l’Audiovisuel de l’EHESS.
———. 2016. « L’imprimé et Ses Pouvoirs (XVe-XVIIIe Siècles) ». In L’imprimé et Ses Pouvoirs Dans Les Langues Romanes, édité par Ricardo Saez, 21‑37. Interférences. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
Citton, Yves. 2015. « Humanités numériques. Une médiapolitique des savoirs encore à inventer ». Multitudes n 59 (2): 169‑80. https://doi.org/10.3917/mult.059.0169.
Cotte, Dominique. 2004. « Écrits de réseaux, écrits en strates ». Hermes, La Revue n 39 (2): 109‑15.
Davallon, Jean, Marie Després-Lonnet, Yves Jeanneret, Le MarecJoëlle, et Emmanuël Souchier. s. d. Lire, écrire, récrire : Objets, signes et pratiques des médias informatisés. Lire, écrire, récrire : Objets, signes et pratiques des médias informatisés. Études et recherche. Paris: Éditions de la Bibliothèque publique d’information.
de Biasi, Pierre-Marc. 1997. « Le papier, fragile support de l’essentiel ». Les cahiers de médiologie 4 (2): 7‑17. https://doi.org/10.3917/cdm.004.0007.
Desmurget, Michel. 2019. La Fabrique du crétin digital : Les dangers des écrans pour nos enfants. Sciences humaines. Seuil.
Doueihi, Milad. 2008. La Grande Conversion Numérique. Le seuil. La Librairie Du XXIe Siècle.
Drucker, Johanna. 2014. Graphesis: Visual Forms of Knowledge Production. Harvard University Press.
Ducourtieux, Christine. 1998. « L’usage de l’Internet En Lettres et En Sciences Humaines à l’École Normale Supérieure ». Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Dumont, Richard. 2015. « Les universitaires étranglés par les éditeurs commerciaux ». Site institutionnel. Udem Nouvelles.
Ertzscheid, Olivier. 2014. « Entre Utopie et Dystopie : Une Histoire Du Web ». In Lire+Écrire, publie.net.
———. 2016. « Pourquoi je ne publie(rai) plus (jamais) dans des revues scientifiques ». affordance.info.
Fauchié, Antoine, et Thomas Parisot. 2018. « Repenser les chaînes de publication par l’intégration des pratiques du développement logiciel ». Sciences du Design n 8 (2): 45‑56.
Fauré, Christian. 2009. « La prolétarisation dans les sociétés informatiques ». Hypomnemata : supports de mémoire.
Galloway, Alexander R. s. d. The Interface Effect. Polity.
Garfield, Eugene. 1955. « Citation Indexes for Science ». Science 122 (3159): 108‑11.
———. 2007. « The Evolution of the Science Citation Index ». International Microbiology, nᵒ 10: 65‑69. https://doi.org/10.2436/20.1501.01.10.
Giffard, Alain. 2011. « Critique de la lecture numérique ». Bulletin des bibliothèques de France, nᵒ 5 (janvier): 71‑73.
Giffard, Alain, Bernard Stiegler, Alain Giffard, et Christian Fauré. 2009. « Des Lectures Industrielles ». In Pour En Finir Avec La Mécroissance. Flammarion.
Goody, Jack. 1979. La Raison Graphique. La Domestication de La Pensée Sauvage. Le Sens Commun. Les Editions de Minuit.
Granjon, Fabien, et Christophe Magis. 2016. « Critique et humanités numériques ». Variations. Revue internationale de théorie critique, nᵒ 19 (avril). https://doi.org/10.4000/variations.748.
Guédon, Jean-Claude. 2014. « Le Libre Accès et La Grande Conversation Scientifique ». In Pratiques de l’édition Numérique, édité par E. SinatraMichael et Marcello Vitali-Rosati, 111‑26. Parcours Numériques. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal.
Guédon, Jean-Claude, et Alain Loute. 2017. « L’histoire de la forme revue au prisme de l’histoire de la grande conversation scientifique . Entretien avec Jean-Claude Guédon réalisé par Alain Loute, préparé avec l’aide de Caroline Glorie, Thomas Franck et Andrea Cavazzini. » Cahiers du GRM. publiés par le Groupe de Recherches Matérialistes Association, nᵒ 12 (décembre). https://doi.org/10.4000/grm.912.
Guichard, Eric. 2002. « L’internet: Mesures Des Appropriations d’une Technique Intellectuelle ». Thèse de doctorat.
Jacob, Christian. 2014. Qu’est-Ce Qu’un Lieu de Savoir ? Open Editions Press. Encyclopédie Numérique. Marseille.
Jenkins, Henry. 2006. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press.
Kauffmann, Alexis. 2010. « Le Libre Accès Ou Le Retour de La Grande Conversation Par Jean-Claude Guédon ». Framablog. https://framablog.org/2010/08/22/libre-acces-science-grande-conversation-guedon/.
Kembellec, Gérald. 2013. « La médiation technologique autour des pratiques rédactionnelles et bibliographiques en milieu universitaire français ». Documentaliste-Sciences de l’Information Vol. 50 (1): 62‑69.
———. 2017. « Réflexions Sur Le Fragment Dans Les Pratiques Scientifiques En Ligne : Entre Matérialité Documentaire et Péricope ». In CIDE 20. Villeurbanne, France.
Kittler, Friedrich. s. d. « Le Logiciel n’existe Pas ». In Mode Protégé, Les presses du réel, 29‑45. Labex.
Larivière, Vincent, Stefanie Haustein, et Philippe Mongeon. 2015. « The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era ». PLOS ONE 10 (6): e0127502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502.
Larrue, Jean-Marc. 2015. « Du média à la médiation : les trente ans de la pensée intermédiale et la résistance théâtrale ». In Théâtre et intermédialité, édité par Jean-Marc Larrue, 27‑56. Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.8158.
Larrue, Jean-Marc, Marcello Vitali-Rosati, John Detre, et Beth Kearney. 2019. Media Do Not Exist: Performativity and Mediating Conjunctures. Theory on Demand 31. Amsterdam: Institute of Network Cultures.
Lebrun, Monique. 2015. « Former des enseignants de français pour les nouvelles humanités numériques : enjeux épistémologiques et empiriques ». Tréma, nᵒ 43 (mai): 68‑77. https://doi.org/10.4000/trema.3319.
Leroi-Gourhan, André. 1964. Le Geste et La Parole. Albin-Michel. Vol. 2.
Long, Christopher. 2013. « Performative Publication ». Christopher P. Long.
Makarius, Michel. 2020. « Dans La Constellation Des Ruines Avec Walter Benjamin ». In La Ruine et Le Geste Architectural, édité par Pierre Hyppolite, 211‑19. Littérature Française. Nanterre: Presses universitaires de Paris Nanterre.
Merzeau, Louise. 2007. « Une nouvelle feuille de route ». Médium, nᵒ 13: 3‑15. https://doi.org/10.3917/mediu.013.0003.
———. 2013. « Éditorialisation collaborative d’un événement ». Communication et organisation, nᵒ 43 (juin): 105‑22. https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.4158.
———. 2014. « Entre Événement et Document : Vers l’environnement-Support ». Les Cahiers de la SFSIC, nᵒ 9 (janvier): 230‑33.
———. 2016. « Le profil : une rhétorique dispositive ». Itinéraires. Littérature, textes, cultures, nᵒˢ 2015-3 (juin). https://doi.org/10.4000/itineraires.3056.
Meunier, Jean-Guy. 2017. « Humanités Numériques et Modélisation Scientifique ». Questions de communication, nᵒ 31 (juillet).
Morozov, Evgeny. 2013. To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. First Trade Paper Edition. PublicAffairs.
Mounier, Pierre, et Marin Dacos. 2011. « Édition électronique ». Communications n 88 (1): 47‑55.
Mourat, Robin de. 2018. « Le design fantomatique des communautés savantes : enjeux phénoménologiques, sociaux et politiques de trois formats de données en usage dans l’édition scientifique contemporaine ». Sciences du Design n 8 (2): 34‑44.
Moureau, François, et Robert Darnton. 2006. La Plume et Le Plomb: Espaces de l’imprimé et Du Manuscrit Au Siècle Des Lumières. Presses Paris Sorbonne.
Oswald, Séverine. 2015. « Formes et enjeux de la sociabilité dans les équipes de recherche en sciences humaines et sociales ». Thèse de doctorat, Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON.
Peiffer, Jeanne, et Jean-Pierre Vittu. 2008. « Les journaux savants, formes de la communication et agents de la construction des savoirs (17e-18e siècles) ». Dix-huitième siècle, nᵒ 40 (septembre): 281‑300.
Petit, Victor, et Serge Bouchardon. 2017. « L’écriture numérique ou l’écriture selon les machines. Enjeux philosophiques et pédagogiques ». Communication & langages, nᵒ 191 (décembre): 129‑48. https://doi.org/10.4074/S0336150017011097.
Pédauque, Roger T. 2011. Le Document à La Lumière Du Numérique : Forme, Texte, Médium : Comprendre Le Rôle Du Document Numérique Dans l’émergence d’une Nouvelle Modernité.
Rifkin, Jeremy, et Marc Saint-Upéry. 2000. L’âge de l’accès: La Révolution de La Nouvelle Économie. Vol. 6. La Découverte Paris.
Routhier, Élisabeth. 2017. « Perspective intermédiale sur le motif de la disparition : enjeux d’une poétique de la remédiation chez Perec, Modiano et Nolan ». Thèse de doctorat, Montréal: Université de Montréal.
Rouvroy, Antoinette, et Thomas Berns. 2013. « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation ». Réseaux n 177 (1): 163‑96.
Ruiz, Émilien. 2019. « #DHIHA8 Nous sommes à la croisée des chemins ! » Billet. Devenir historien-ne.
Schmitt, Jason. 2014. « Academic Journals: The Most Profitable Obsolete Technology in History ». HuffPost, décembre.
Schnapp, Jeffrey. 2013. « Knowledge Design Incubating New Knowledge Forms / Genres / Spaces in the Laboratory of the Digital Humanities ». Lecture. Hannover.
Seward, Zachary. 2013. « The First-Ever Hashtag, @-Reply and Retweet, as Twitter Users Invented Them ». Quartz. https://qz.com/135149/the-first-ever-hashtag-reply-and-retweet-as-twitter-users-invented-them/.
Simondon, Gilbert. 1994. Gilbert Simondon: une pensée de l’individuation et de la technique. Bibliothèque du Collège International de Philosophie. Albin Michel.
Souchier, Emmanuël. 1996. « L’écrit d’écran, pratiques d’écriture & informatique ». Communication & Langages 107 (1): 105‑19. https://doi.org/10.3406/colan.1996.2662.
Steiner, Pierre. 2010. « Philosophie, technologie et cognition. Etats des lieux et perspectives ». https://doi.org/https://isidore.science/document/10.3406/intel.2010.1176.
Stern, Niels, Jean-Claude Guédon, et Thomas Wiben Jensen. 2015. « Crystals of Knowledge Production. An Intercontinental Conversation about Open Science and the Humanities ». Nordic Perspectives on Open Science 1 (0): 1‑24. https://doi.org/10.7557/11.3619.
Stiegler, Bernard. 2016. Dans La Disruption. Comment Ne Pas Devenir Fou? Paris: Les Liens qui libèrent.
Veillette-Péclet, Camille. 2019a. « Annulation de Scopus ». Site institutionnel. Université de Montréal - Les bibliothèques.
———. 2019b. « Annulations d’abonnements de périodiques Springer ». Site institutionnel. Université de Montréal - Les bibliothèques.
———. 2019c. « Annulations d’abonnements de périodiques Taylor and Francis ». Site institutionnel. Université de Montréal - Les bibliothèques.
Vitali-Rosati, Marcello. 2014. « Les revues littéraires en ligne : entre éditorialisation et réseaux d’intelligences ». Études françaises 50 (3): p.83‑104. https://doi.org/10.7202/1027191ar.
———. 2015. « Éditeurs, arrêtez de prendre en otage la connaissance ! (1e catilinaire) ». The Conversation, octobre.
———. 2016. « Édition GAFAM et Édition Savante : Une Bataille En Cours ? » The Conversation. http://theconversation.com/edition-gafam-et-edition-savante-une-bataille-en-cours-68754.
———. 2018a. On Editorialization: Structuring Space and Authority in the Digital Age. Institute of Network Cultures. Theory on Demand 26.
———. 2018b. « Qu’est-ce que l’écriture numérique ? » Sens public, novembre.
———. s. d. « Qu’est-ce que l’écriture numérique ? » Corela.
Vitali-Rosati, Marcello, et Benoît Epron. 2017. L’édition à l’époque Du Numérique. Editions La découverte. Repères.
Vittu, Jean-Pierre. 2001. « Qu’est-ce qu’un article au Journal des Savants de 1665 à 1714 ? » in Revue Française d’Histoire du Livre, nᵒˢ 112-113: p.129‑148.
———. 2002a. « La formation d’une institution scientifique : le Journal des Savants de 1665 à 1714 [Premier article : d’une entreprise privée à une semi-institution] ». Journal des savants 1 (1): 179‑203. https://doi.org/10.3406/jds.2002.1653.
———. 2002b. « La formation d’une institution scientifique : le Journal des Savants de 1665 à 1714 [Second article. L’instrument central de la République des Lettres ] ». Journal des savants 2 (1): 349‑77. https://doi.org/10.3406/jds.2002.1659.
Volpe, Tony, et Joachim Schopfel. 2013. « Dissemination of Knowledge and Copyright: An Historical Case Study ». Journal of Information, Communication and Ethics in Society 11 (3): 144‑55. https://doi.org/10.1108/JICES-06-2013-0018.
Wormser, Gérard. 2004. « Sens-Public : Editorial N1 ». Revue En Ligne. Sens Public (archive). https://web.archive.org/web/20040811094758/http://www.sens-public.org:80/article.php3?id_article=68.
Zacklad, Manuel. 2012. « Organisation et architecture des connaissances dans un contexte de transmédia documentaire : les enjeux de la pervasivité ». Études de communication. langages, information, médiations, nᵒ 39 (décembre): 41‑63. https://doi.org/10.4000/edc.4017.
———. 2019. « Le design de l’information : textualisation, documentarisation, auctorialisation ». Communication langages N 199 (1): 37‑64.
