Pour les habitants autour de Fukushima, « il y a une injonction à être des contaminés satisfaits »
Basta ! : Votre ouvrage, Contre la résilience - À Fukushima et ailleurs, analyse le concept de résilience, omniprésent dans notre société, et largement convoqué suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, qui a commencé il y a 10 ans, le 11 mars 2011. Pour vous, si elle semble aider les victimes à faire face, la résilience les invite surtout à s’accommoder de la catastrophe. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Thierry Ribault [1] : La résilience est un concept adulé dans nos sociétés, notamment pour administrer les désastres, c’est-à-dire non seulement pour les gérer mais aussi pour les transformer en remèdes aux dégâts qu’ils génèrent. On peut comprendre cet engouement étant donné que nous sommes de plus en plus confrontés à des catastrophes impossibles à maîtriser. La résilience apparaît comme une formule magique car elle prétend clore cette impossibilité, et en faire une source d’inspiration et de rebond vers un soi-disant « monde d’après ». En fait, plus on connaît les causes des désastres, plus les réponses que l’on fournit sont concentrées sur leurs conséquences, et sur la meilleure façon dont on peut en tirer parti, rendant ainsi les causes de plus en plus désastreuses. C’est un principe de base de la résilience que l’on pourrait définir comme « l’art de s’adapter au pire ».
Dans le cas d’une catastrophe nucléaire comme celle de Fukushima, mais c’est aussi vrai ailleurs, la résilience est promue au rang de technique thérapeutique pour faire face au désastre. On va individualiser le problème et amener les gens à faire fi de leur impuissance face aux dégâts pour, au contraire, leur donner l’impression d’être puissants et agissants. Chacun est exhorté à « rebondir », à « vivre avec ». Les victimes sont amenées à cogérer le désastre, en participant à la « décontamination » ou en surveillant la radioactivité ambiante. L’objectif des apôtres de la résilience (autorités étatiques, associations locales, experts internationaux), c’est d’amener chacun à cesser de s’inquiéter « inutilement » d’avoir fatalement à vivre avec la contamination. Personne n’ose dire que l’on va « vivre comme avant » mais on parle de « situation post-normale », qui est en fait une situation de survie. Les gens doivent apprendre à se contenter d’un bonheur palliatif, où règne le « trop peu », considéré comme éternel et indiscutable : « trop peu » de santé, « trop peu » de liberté, « trop peu » de peur, « trop peu » de refus, « trop peu » de vie.
Cette injonction à « vivre avec » permet aux autorités de « faire ravaler leur colère aux gens », dites-vous. Pourquoi ? Et comment ce refoulement de la colère opère-t-il ?
 Dans toutes les catastrophes, il y a un pilotage des sentiments, notamment de l’impuissance, et on peut le comprendre, car l’impuissance révolte les gens. Elle fait naître en eux un sentiment terrible de colère. La résilience permet de refouler cela. Au départ, à Fukushima, les gens étaient très vindicatifs face à la gestion de l’accident nucléaire par les autorités. Mais en peu de temps, ils ont endossé le discours selon lequel il faut « dépasser la colère », ce qui revient à gommer la gravité de la situation. Cette amnésie collective s’appuie sur divers moyens, à commencer par la réévaluation du seuil d’« inacceptabilité » des radiations, euphémisé en « niveau de référence », et qui est passé de 1 à 20 mSv par an. Les habitants sont encouragés à prendre part aux programmes de décontamination, pour – leur disent les autorités – « évacuer leur peur » car « c’est la peur qui tue » et non pas l’exposition aux particules radioactives. Des associations locales sont créées pour remonter le moral des habitants. Dès 2012, le gouvernement a nommé un ministre responsable de la « construction de la résilience nationale ».
Dans toutes les catastrophes, il y a un pilotage des sentiments, notamment de l’impuissance, et on peut le comprendre, car l’impuissance révolte les gens. Elle fait naître en eux un sentiment terrible de colère. La résilience permet de refouler cela. Au départ, à Fukushima, les gens étaient très vindicatifs face à la gestion de l’accident nucléaire par les autorités. Mais en peu de temps, ils ont endossé le discours selon lequel il faut « dépasser la colère », ce qui revient à gommer la gravité de la situation. Cette amnésie collective s’appuie sur divers moyens, à commencer par la réévaluation du seuil d’« inacceptabilité » des radiations, euphémisé en « niveau de référence », et qui est passé de 1 à 20 mSv par an. Les habitants sont encouragés à prendre part aux programmes de décontamination, pour – leur disent les autorités – « évacuer leur peur » car « c’est la peur qui tue » et non pas l’exposition aux particules radioactives. Des associations locales sont créées pour remonter le moral des habitants. Dès 2012, le gouvernement a nommé un ministre responsable de la « construction de la résilience nationale ».
Le leitmotiv c’est que l’on peut vivre en territoire contaminé. Simplement, il faut prendre quelques précautions. Dès lors, les victimes sortent de leur passivité face à l’agression, elles deviennent actrices. C’est rassurant, et elles finissent pas basculer dans la « positivation » de leur malheur : les gens renouent avec l’espoir car les actions de décontamination collective, ou de production de science citoyenne avec les relevés individuels de radioactivité, mobilisent la solidarité et la capacité individuelle à surmonter une épreuve. Tout cela va jusqu’à conduire certains à affirmer que « c’est merveilleux de vivre à Fukushima », ou encore que « l’histoire de Fukushima est un cadeau pour le futur ».
« On est baigné depuis la révolution industrielle dans cette idée que le désastre est source de progrès et la résilience contribue à la consolidation de cette idée »
« On est baigné depuis la révolution industrielle dans cette idée que le désastre est source de progrès et la résilience contribue à la consolidation de cette idée »
Comme à Tchernobyl, où a été expérimenté in vivo pour la première fois ce concept du « vivre avec » la contamination radioactive, on retrouve des influenceurs-experts français qui viennent surfer sur le désespoir des gens, en organisant des pseudo-dialogues et des pseudo-rencontres démocratiques où les gens viennent apprendre à « calmer leur anxiété ». Il y a cette conviction que le problème, ce n’est pas la contamination, mais la peur que les gens éprouvent. On fait glisser le curseur de l’analyse vers la psychologie et la capacité de réception et d’adaptation, au lieu de se concentrer sur le problème principal, à savoir les causes qui mènent à être contraint de s’adapter au pire.
Pour inciter les japonais à se conformer à cette vision d’une catastrophe « pas si grave », il y a aussi la « politique du retour », qui réduit les possibilités de survivre hors de la zone contaminée...
Bien sûr. Peu à peu, le gouvernement a réduit ou supprimé les subventions versées aux réfugiés, et a rendu difficile l’accès à des logements de substitution ailleurs que dans le département de Fukushima. Il y a aussi des reconstructions d’écoles dans les villages contaminés, ou des incitations, par décret, à consommer des produits locaux dans les cantines scolaires. Tout cela joue en faveur d’un basculement psychologique favorable au « vivre avec ». Ajoutons le discrédit jeté sur toute forme de contestation et de crainte, avec une culpabilisation de ceux qui rechignent à vivre en zone contaminée et qui ont l’impression d’abandonner ceux qui y restent. Toutes les émotions susceptibles de soutenir un questionnement sur le bien fondé de l’accommodation sont appréhendées comme des maladies nécessitant d’être soignées. On a ainsi parlé des « cervelles irradiées » des mères inquiètes pour la santé de leur enfant. Il y a réellement une injonction à être des contaminés satisfaits.
Cette gestion très individualisée de la catastrophe ne revêt-elle pas aussi un caractère néolibéral ?
En partie, avec la disparition du social au profit de l’individu, la sur-responsabilisation, la valorisation de l’auto-organisation, etc. Mais la résilience est plus que cela. C’est une technologie du consentement qui précède historiquement le néolibéralisme. Elle s’est développée en même temps que la société industrielle car il s’agit de trouver de bonnes raisons à la traversée de la catastrophe. On est baigné depuis la révolution industrielle dans cette idée que le désastre est source de progrès et la résilience contribue à la consolidation de cette idée. J’affirme au contraire que le désastre n’est pas une source de progrès, et que le malheur n’est pas une source de bonheur. Il est ce qu’il est, point. En faire un simple moment que l’on peut positiver à tout crin est extrêmement dangereux, car cela revient à le légitimer.
Aux origines idéologiques de la résilience, on trouve également des affinités avec un eugénisme doux. Au Japon, la Nippon Foundation, encore appelée Fondation Sasakawa, ouvertement d’extrême droite, a financé nombre d’initiatives encourageant les gens à « vivre avec » la radioactivité. On peut ajouter que la propagande sur la reconquête et le « repeuplement » des territoires contaminées a des relents fascisants, particulièrement lorsqu’elle considère les femmes comme des « machines à faire des enfants » (sic). En Europe, en France notamment, il y a des affinités politiques entre les gens qui promeuvent et construisent les programmes de réhabilitation à Tchernobyl et Fukushima et les mouvements d’extrême droite religieux pro-vie. On retrouve cette idée que toutes les formes de vie sont belles même si elles sont dures. Idées que les résiliomaniaques n’hésitent pas à mobiliser dans des assertions du type « la catastrophe est un crible qui élimine le faible et renforce le fort : c’est la vie », ou encore « l’expérience du camp de la mort est vécue comme un chemin initiatique procurant une force de vie ». Il ne s’agit pas de dire que recourir au concept de résilience équivaut à être fasciste. Mais il faut réfléchir à ces affinités idéologiques réelles pour comprendre ce qui se joue au détriment des populations.
Vous évoquez aussi la production d’ignorance, qui ne relève pas nécessairement du pur mensonge, mais plutôt de ce que les historiens des sciences nomment « la science non faite ». On ne cherche pas, ou peu (d’éléments radioactifs par exemple), et par conséquent, il n’y a rien, ou peu à craindre…
La science post-catastrophe est obnubilée par le fait de rassurer les populations au plus vite et au moindre coût. C’est pourquoi il n’y a pas eu de réelles enquêtes sur la dose reçue par les habitants dans les premiers jours de la catastrophe, au prétexte que cela aurait fait naître de l’anxiété. Il ne s’agit pas tant, par cette production d’ignorance organisée, de cacher ou d’obstruer le savoir que d’instiller, dans les esprits comme dans les pratiques, cette idée qu’avec moins ou peu de connaissances, on peut finalement s’en tirer et sans doute mieux qu’avec trop. On va par exemple se focaliser sur un nombre de particules très réduit – le césium ou l’iode – alors que plus d’une centaine ont été disséminées. Les zones d’étude prises en comptes sont rétrécies. Les enquêtes sur la contamination interne sont marginales... À force de restreindre le champ des recherches, on finit par se dire que l’on va pouvoir vivre dans ce milieu qui nous menace, et que l’on va même pouvoir y vivre « en toute plénitude », en en sachant de plus en plus sur de moins en moins.
Ce que vous affirmez, c’est que la résilience aboutit à une banalisation de la menace, au fait de voir la catastrophe comme un mal nécessaire, auquel il faudrait simplement se préparer, puis s’accommoder. Pourquoi ?
La résilience prête main forte au paradigme du risque et érige une adhésion absolue au caractère inévitable du désastre qu’il se charge de probabiliser. On sait désormais que, pour des raisons économiques (le coût de l’évacuation) et politico-stratégiques (la pérennité à tout prix du nucléaire), l’État, en situation de catastrophe nucléaire, restreint les possibilités offertes aux populations de choisir de partir, puis celles de choisir de ne pas revenir. Il faut donc inculquer aux populations qu’en cas de catastrophe nucléaire, l’évacuation est impossible, dangereuse, inutile. La solution, par conséquent, c’est de fournir aux gens la capacité de gérer leur dose au quotidien. Cette idée est au cœur de ce que l’on appelle « la culture pratique du risque radiologique », et elle est désormais au centre de toutes les politiques de gestion d’une catastrophe nucléaire ou pas, y compris en France.
« La résilience apparaît ici comme un puissant outil de résistance au changement. Elle transforme l’humain en machine à encaisser les coups pour mieux repartir au combat »
« La résilience apparaît ici comme un puissant outil de résistance au changement. Elle transforme l’humain en machine à encaisser les coups pour mieux repartir au combat »
Cette doctrine, qui a d’abord été mise en application à Tchernobyl, puis à Fukushima de manière plus sophistiquée, est un tournant majeur dans la pensée de ceux et celles qui défendent le nucléaire. Au départ, les nucléaristes purs et durs ne voulaient pas entendre parler de la cogestion de la contamination, parce que cela allait faire peur aux gens. Mais finalement, ils se sont ralliés à l’idée selon laquelle il faut que les populations prennent une part active à la gestion de la catastrophe. Cette évolution est liée à la nouvelle prémisse selon laquelle le risque zéro n’existe pas. D’inexistant, le risque est devenu inévitable. Mais sans que cela ne pose réellement de problème. Il s’agirait plutôt du prix à payer pour avoir la chance de vivre le confort du progrès technologique. On est clairement, avec ce discours, dans la préparation à la catastrophe, la prochaine.
Pour vous, l’un des problèmes de ces discours sur l’accommodation à la catastrophe, c’est qu’ils font l’économie de se demander comment on en est arrivé là, et rendent toute révolte impossible.
Le principe de la résilience, c’est de préparer les gens au pire sans jamais élucider les raisons de ce pire. La résilience interdit de s’interroger sur le fait que les catastrophes industrielles sont liées à notre mode de production économique capitaliste, qu’elles sont le résultat d’une société technologique se voulant sans limite. Il s’agit en fait de combattre le cancer, le dérèglement climatique ou le Covid-19, sans combattre le monde qui les fait émerger. La résilience est toujours tournée vers l’avenir. La question, devient simplement : comment le malheur d’aujourd’hui va-t-il nous conduire vers le bonheur de demain ? Il y a un gommage du passé, qui ôte aux populations toute perspective de prise de conscience de leur situation et de révolte par rapport à elle. La résilience apparaît ici comme un puissant outil de résistance au changement. Elle fait du malheur une ressource au service de la perpétuation de ce qui existe déjà, et transforme l’humain en machine à encaisser les coups pour mieux repartir au combat.
« L’investissement dans l’exaltation de la souffrance et du sacrifice en situation de catastrophe est inversement proportionnel aux efforts déployés pour en être épargnés »
« L’investissement dans l’exaltation de la souffrance et du sacrifice en situation de catastrophe est inversement proportionnel aux efforts déployés pour en être épargnés »
L’alternative est de considérer réellement le malheur, de le nommer et non pas de lui donner un sens pour mieux l’évacuer, et de faire advenir à la conscience la dureté de ce que l’on vit, conscience indispensable pour aller ensuite vers des formes de vie sociale radicalement différentes, plutôt que se résigner aux rapports sociaux et à leurs nuisibles sous-produits tels qu’ils sont. On ne traverse pas les épreuves, on est traversés par elles. La conscience de la gravité d’une situation et la peur qu’elle inspire (elle aussi prohibée par la résilience au nom de l’impératif de dépassement), sont des moment cruciaux pour nous amener à nous questionner individuellement et collectivement sur les causes réelles qui mènent à ces situations de catastrophes devenues conditions du progrès. Avec la résilience, selon laquelle on ne souffre jamais en vain, on est dans un refoulement sans fin de cette conscience. L’investissement dans l’exaltation de la souffrance et du sacrifice en situation de catastrophe est inversement proportionnel aux efforts déployés pour en être épargnés. Efforts que l’on pourrait consacrer à réfléchir et construire des sociétés dans lesquelles est vivifié le désir de prendre distance vis-à-vis de la condition de survivant, condition à laquelle la résilience nous somme de prendre part citoyennement.
Propos recueillis par Nolwenn Weiler
Photo : experts de l’AIEA à Fukushima, avril 2013. CC Greg Webb /AIEA.
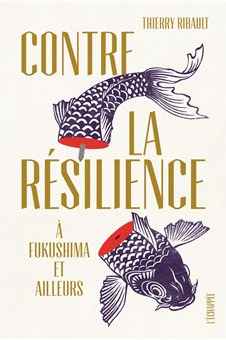 Contre la résilience - À Fukushima et ailleurs, de Thierry Ribault. Éditions de L’échappée, collection « Pour en finir avec ». 368 pages. 22 euros.
Contre la résilience - À Fukushima et ailleurs, de Thierry Ribault. Éditions de L’échappée, collection « Pour en finir avec ». 368 pages. 22 euros.